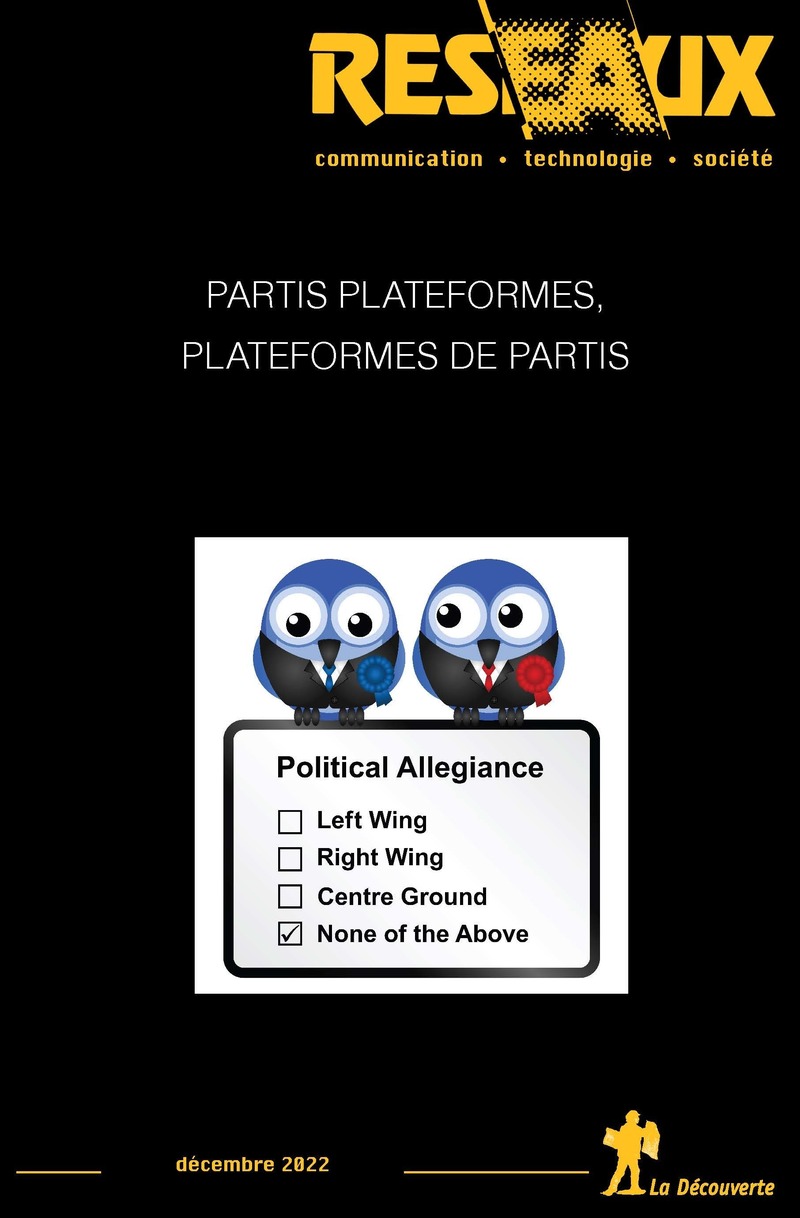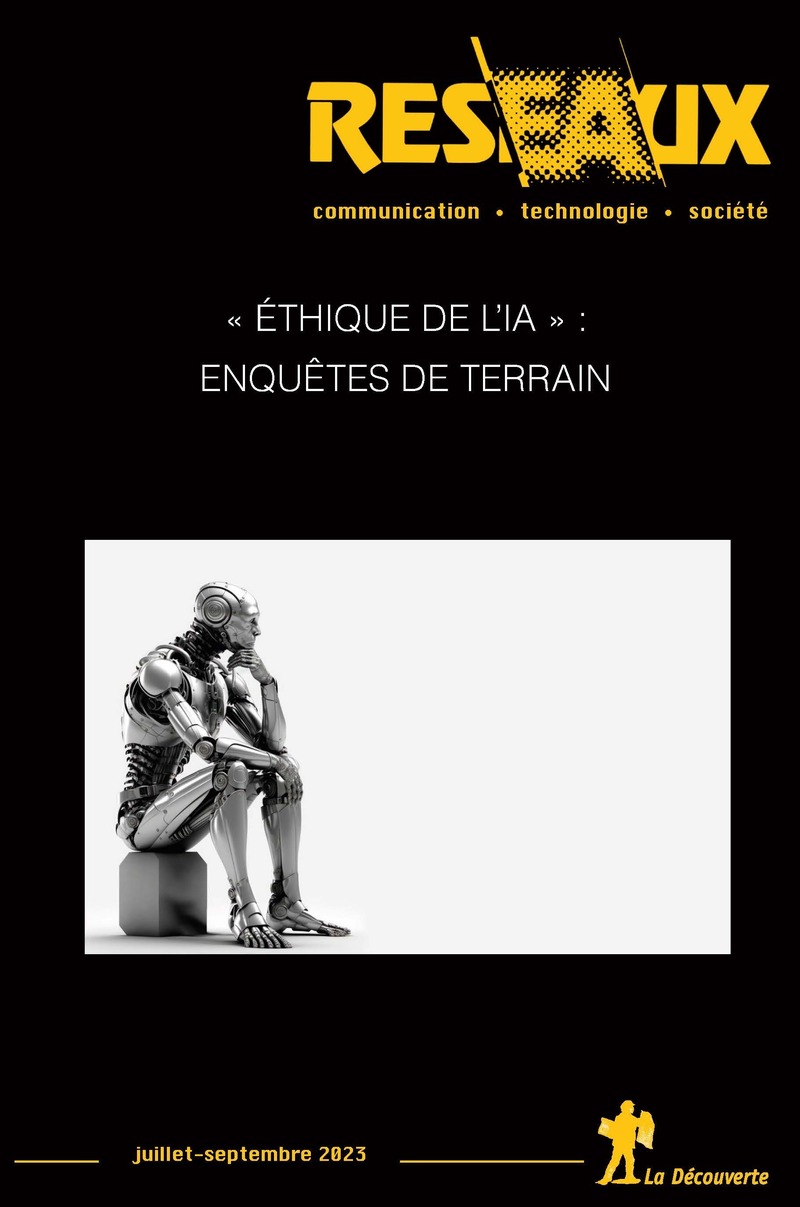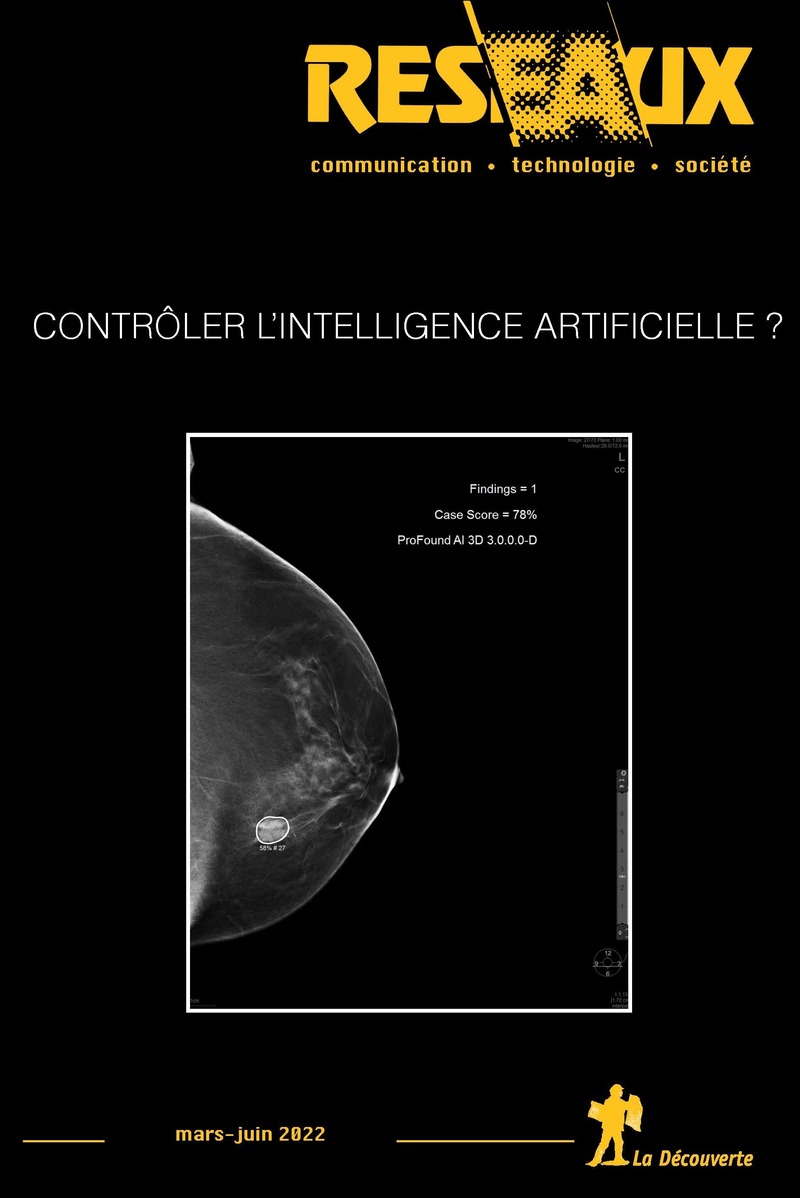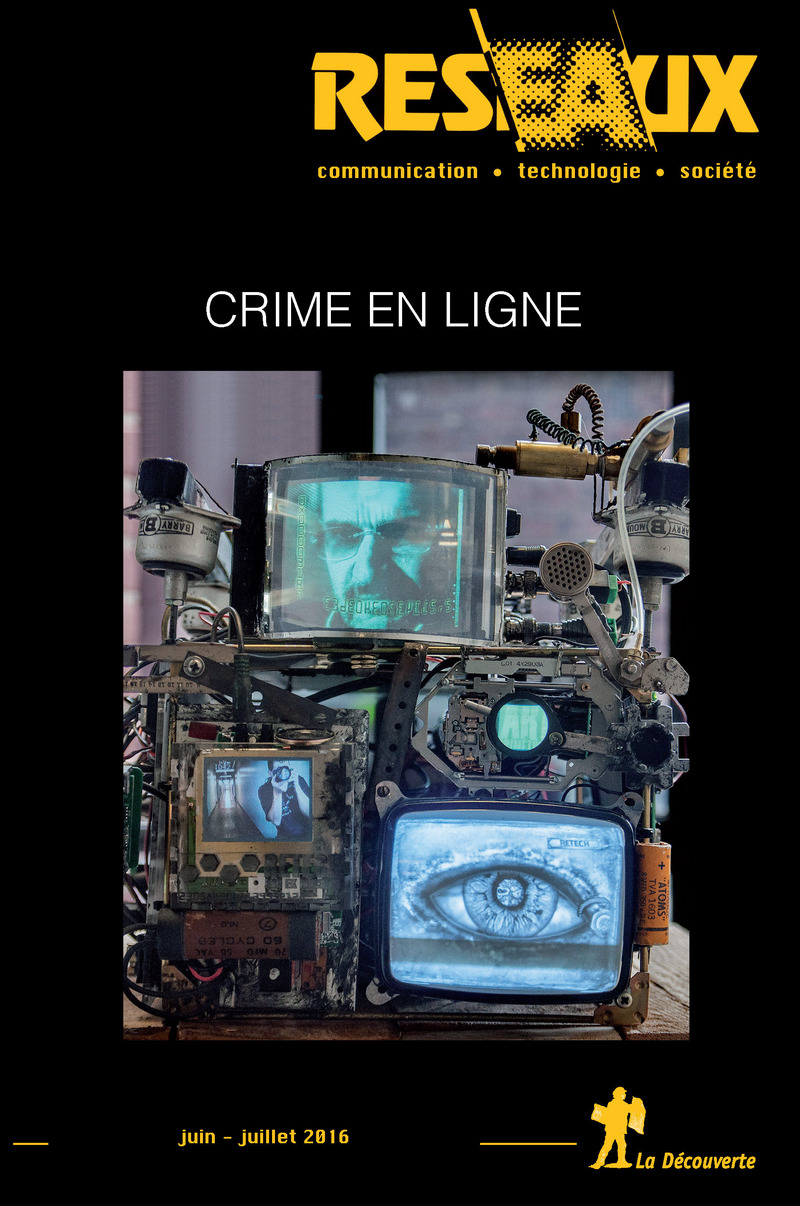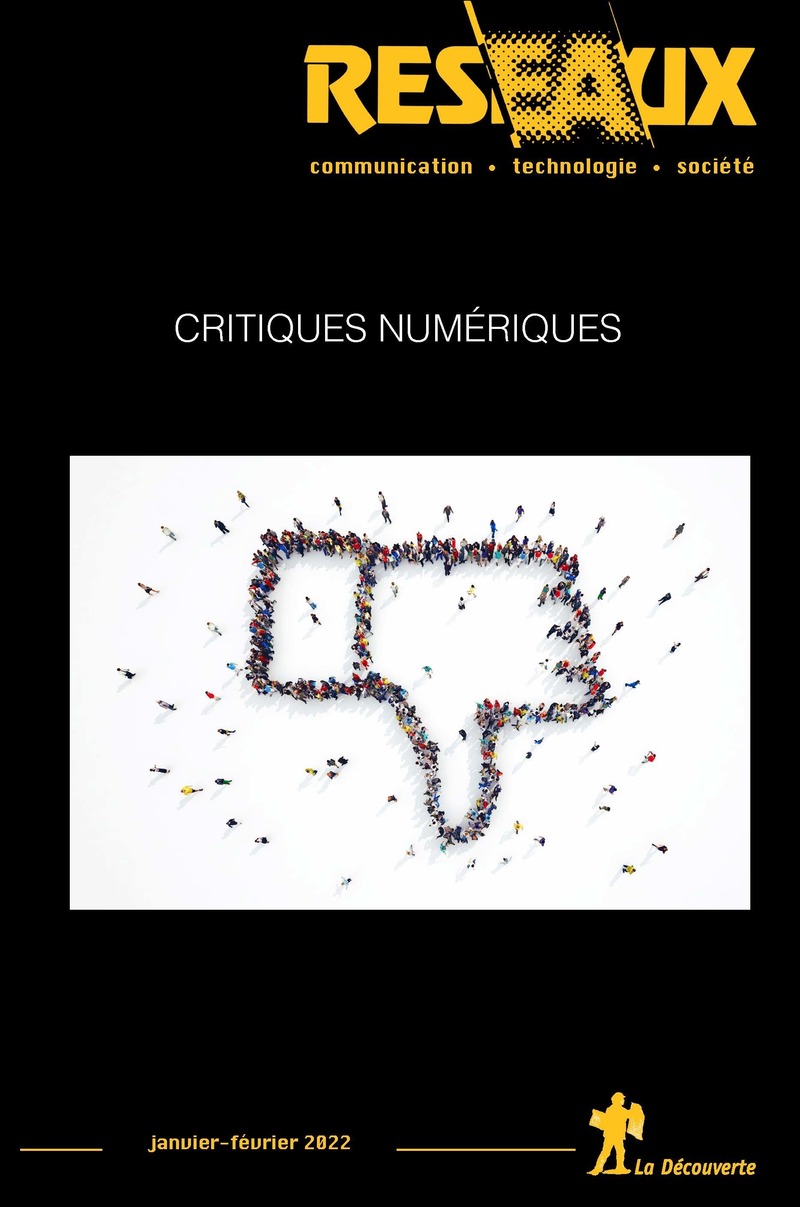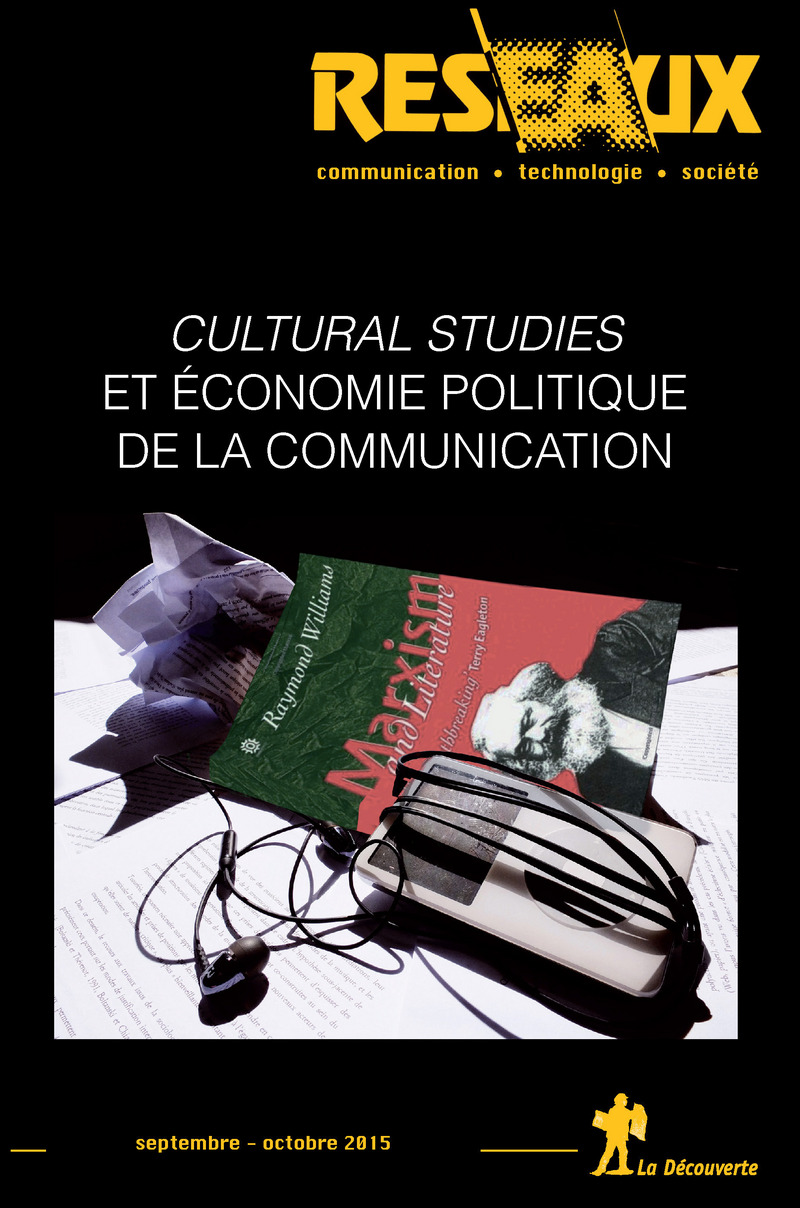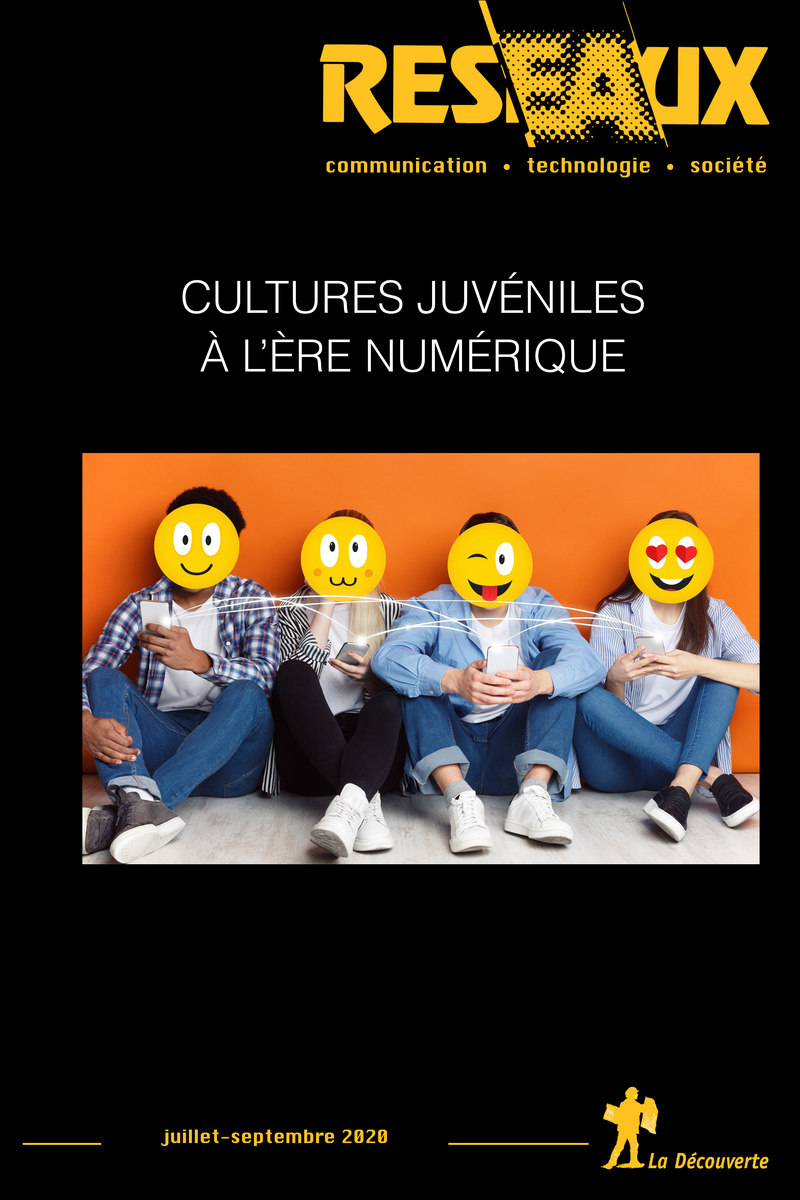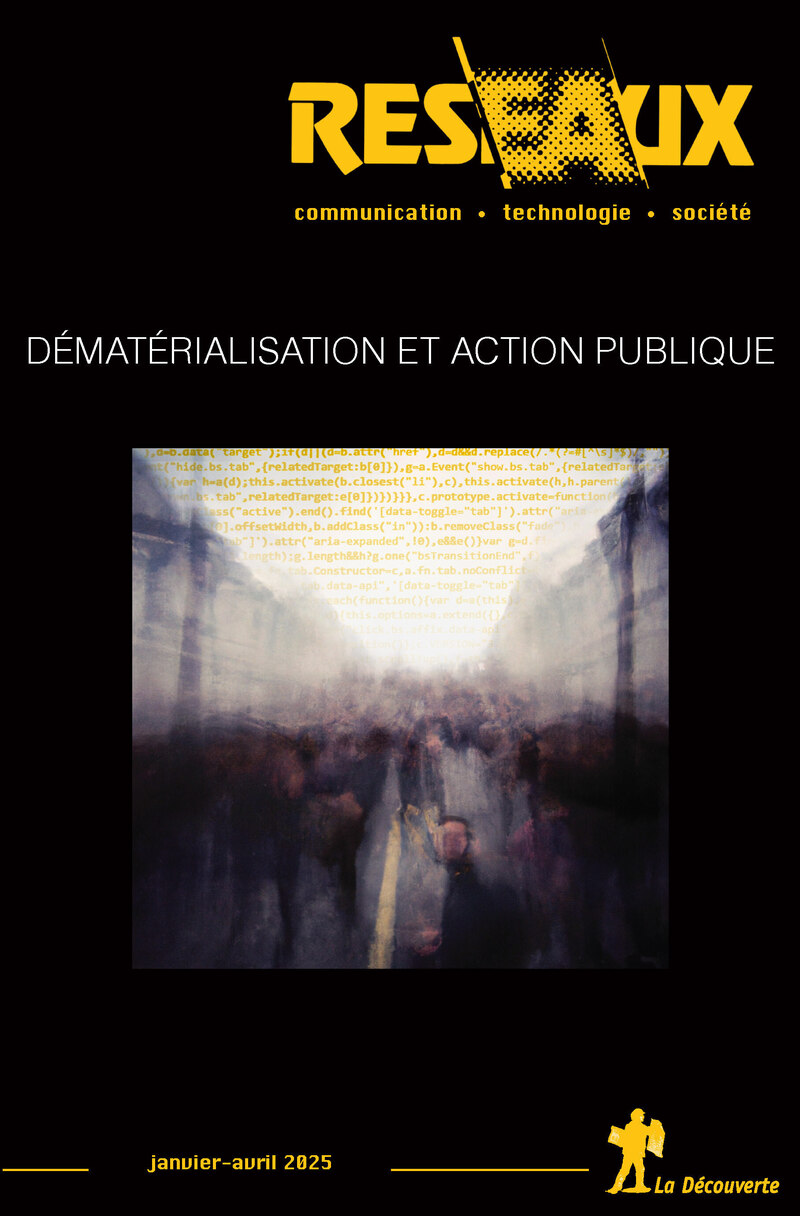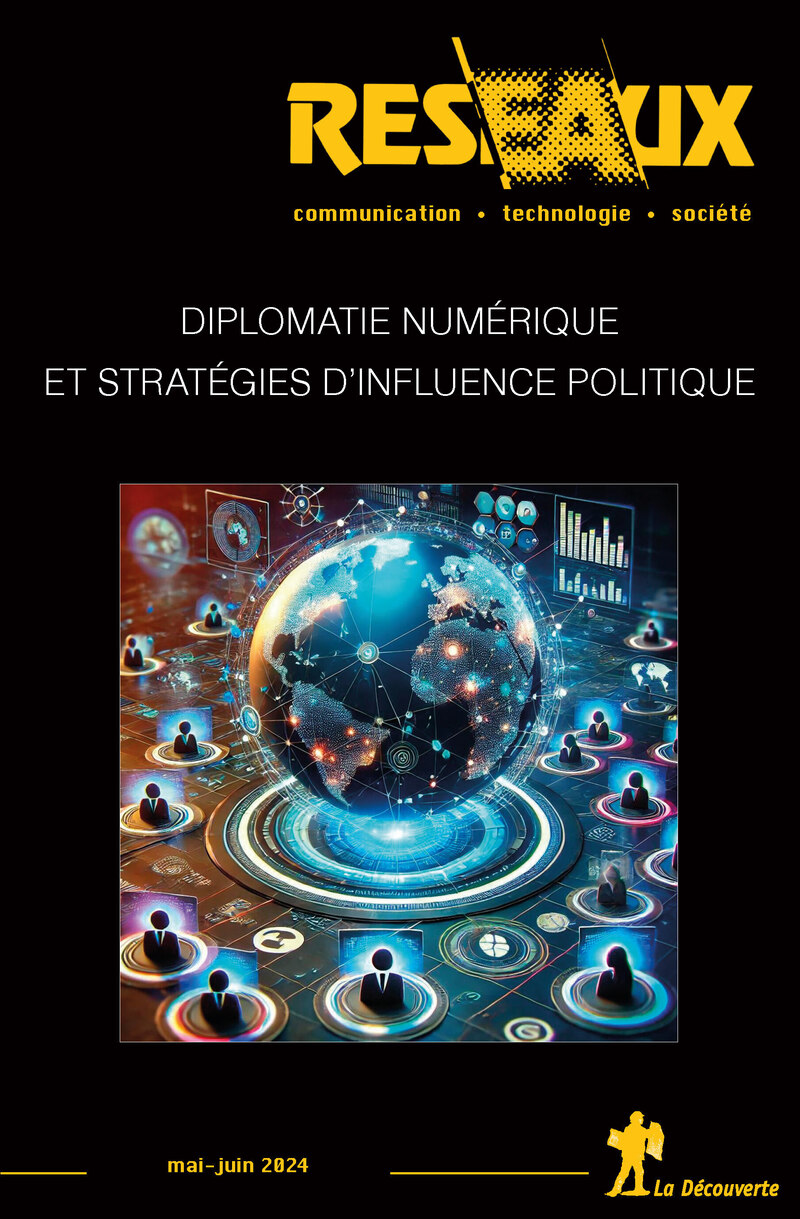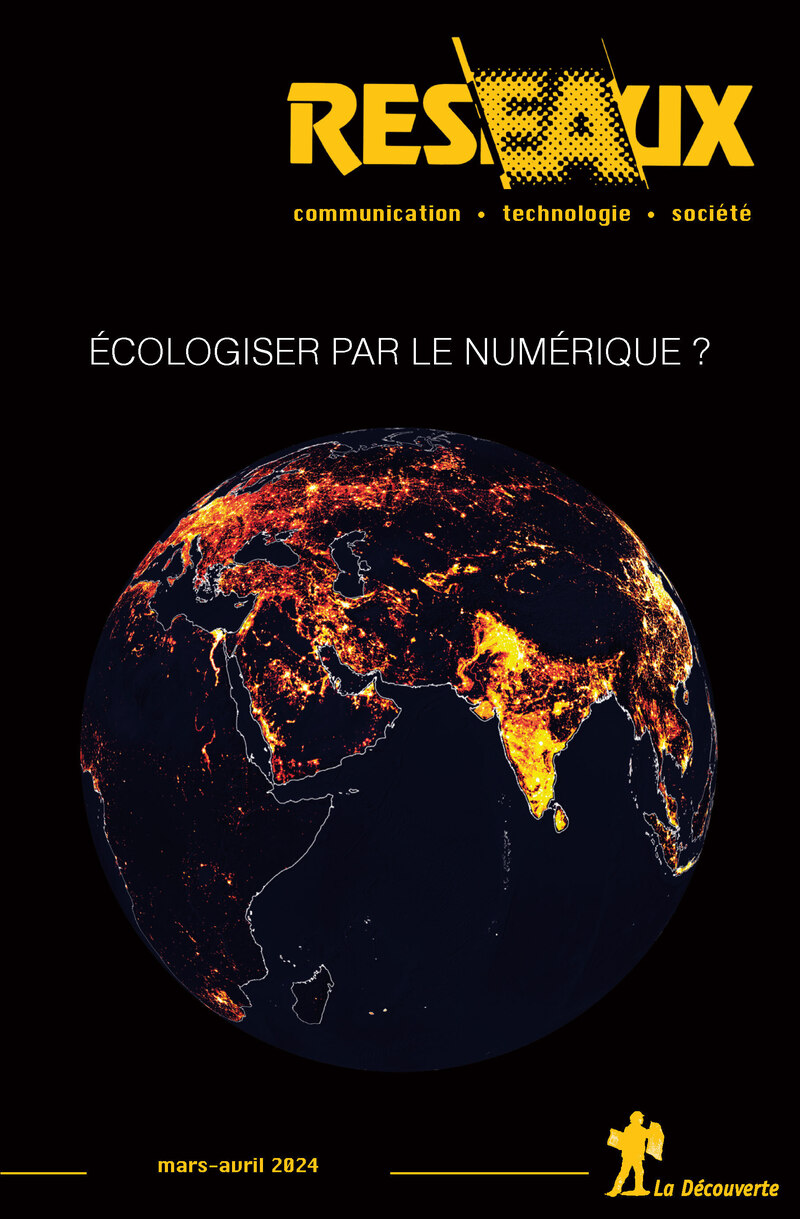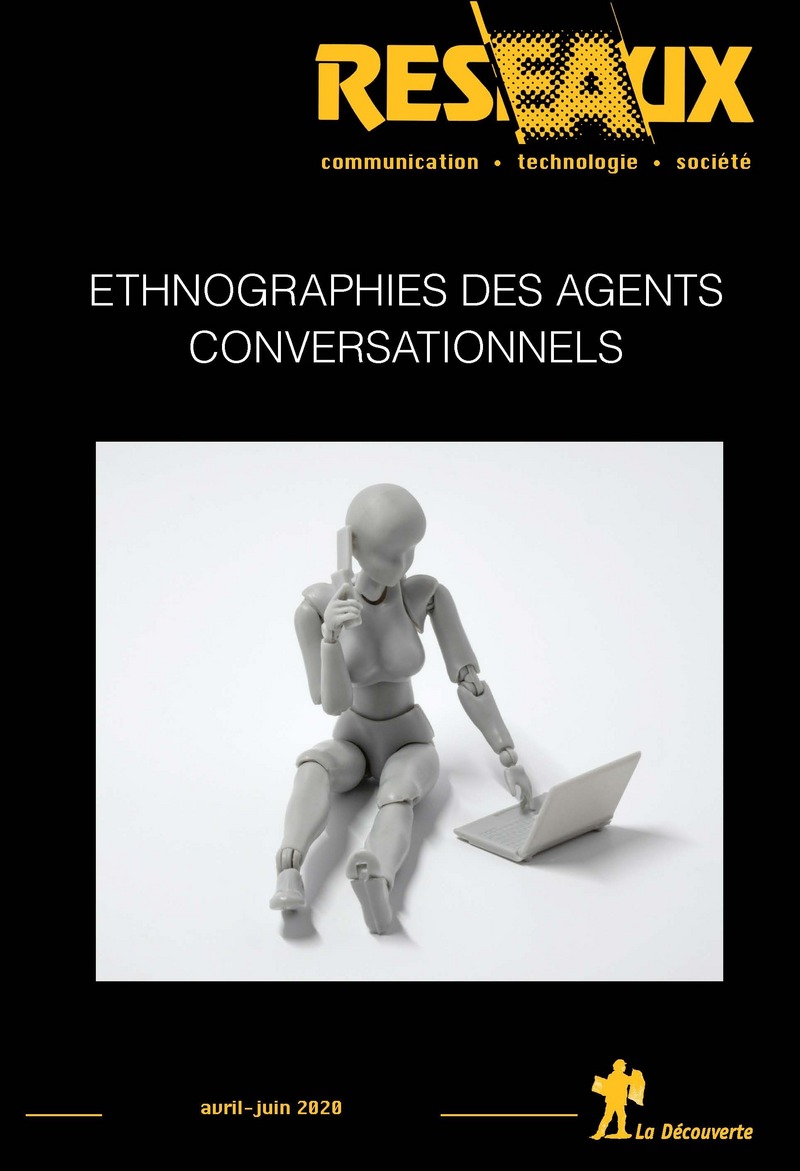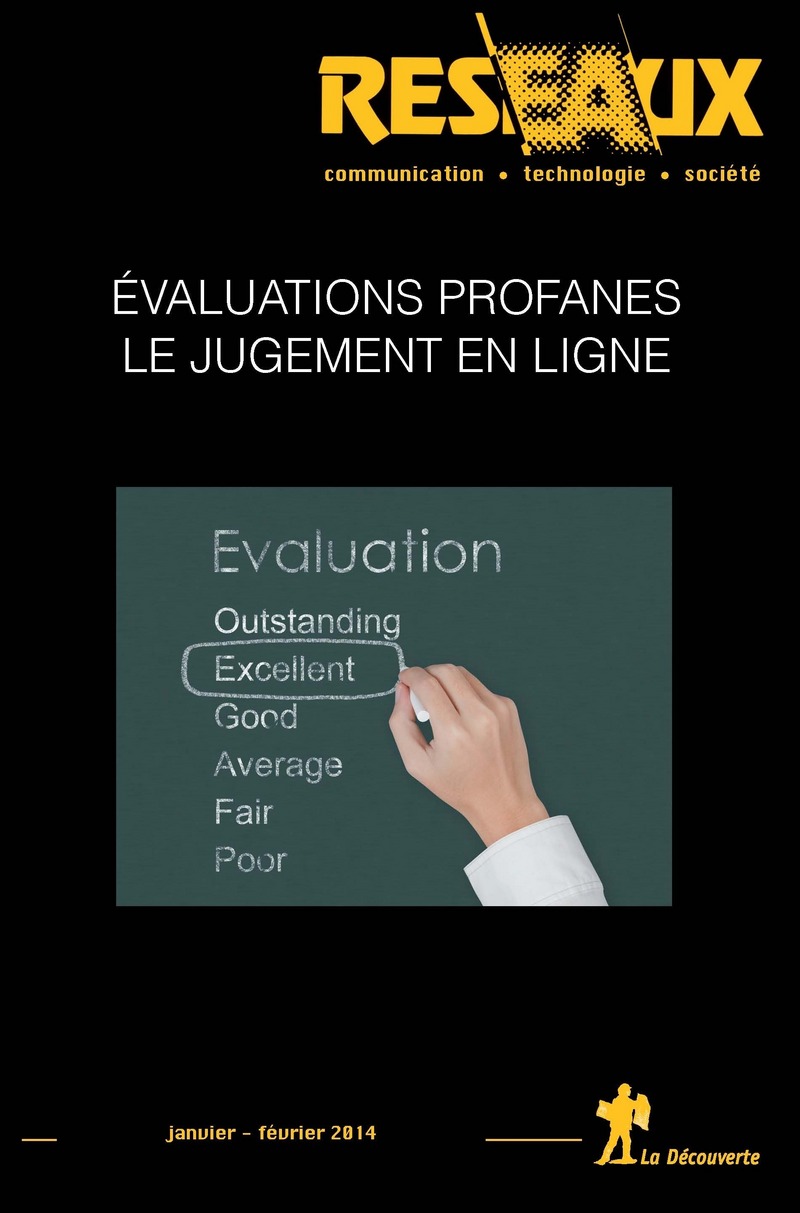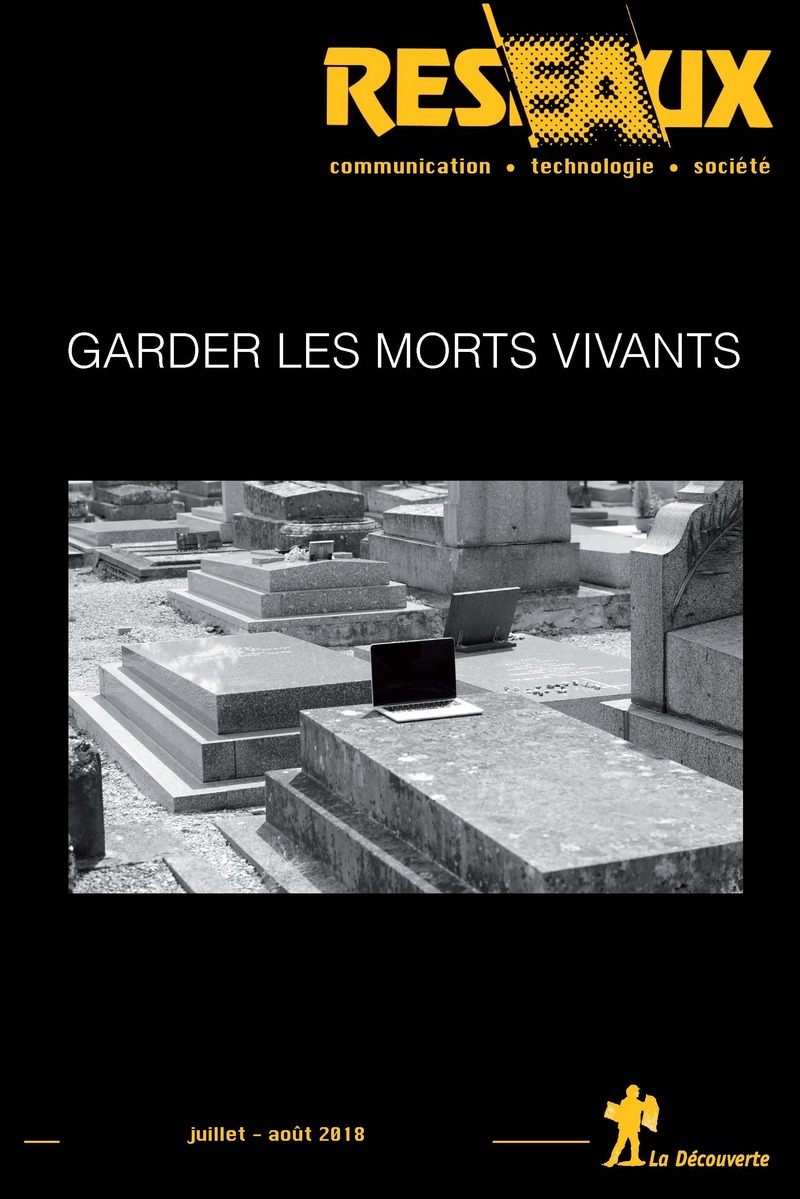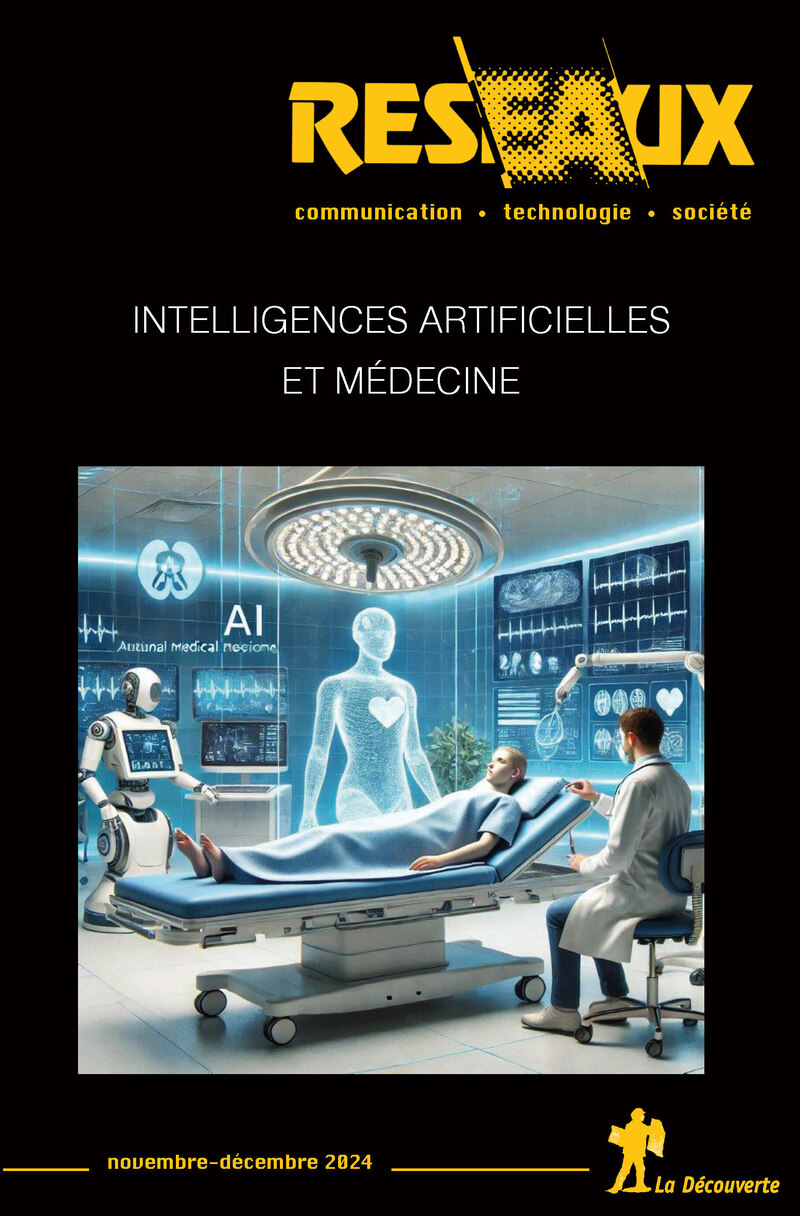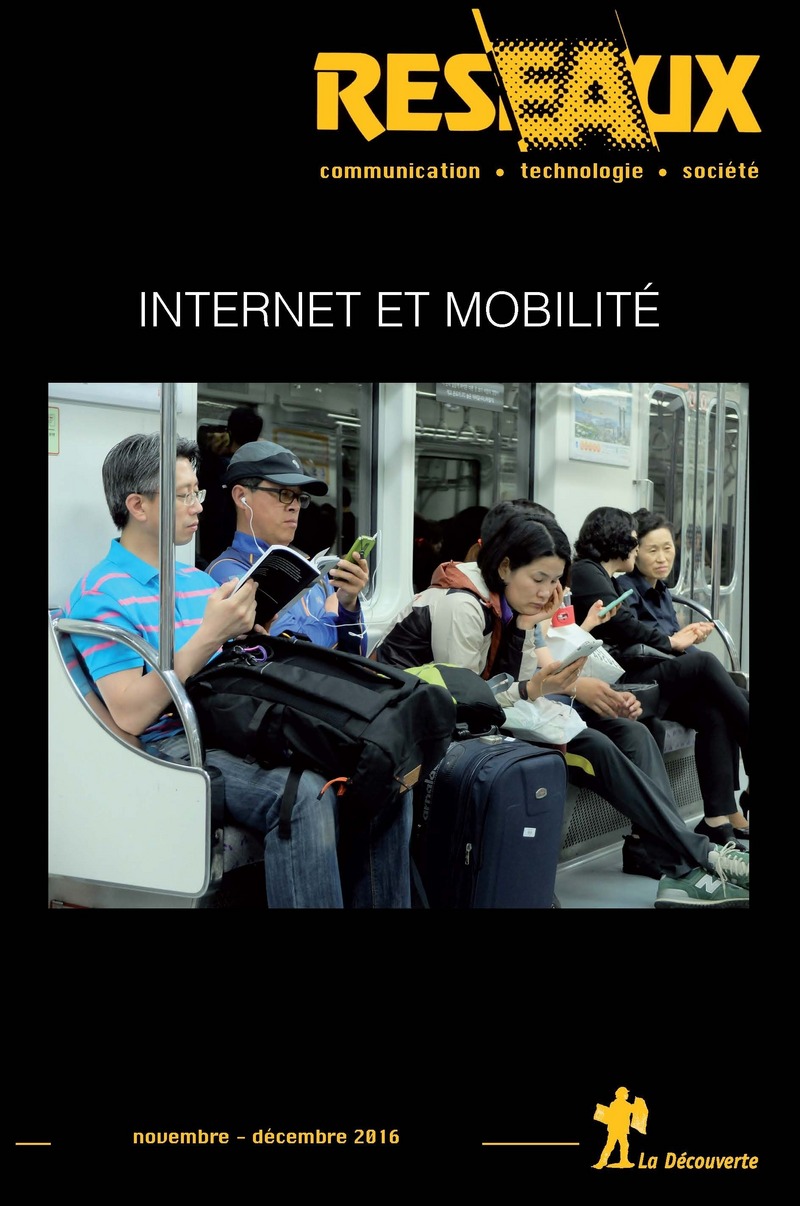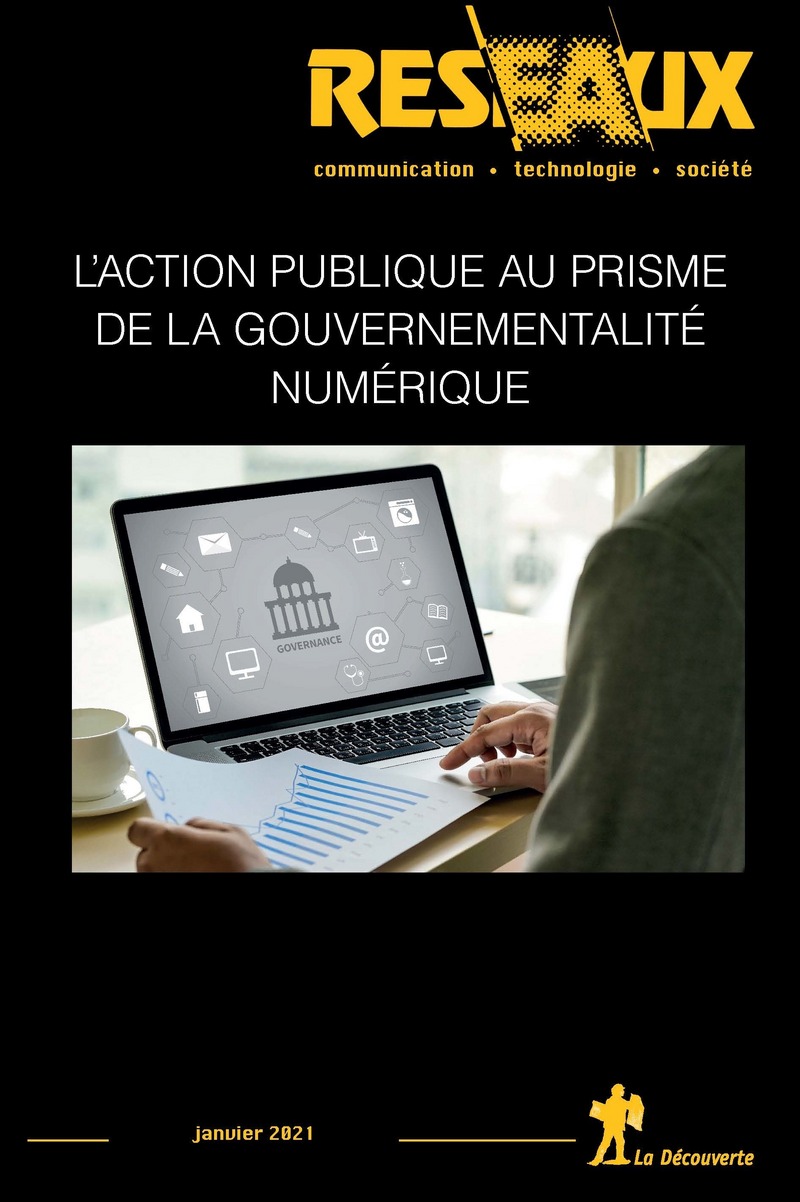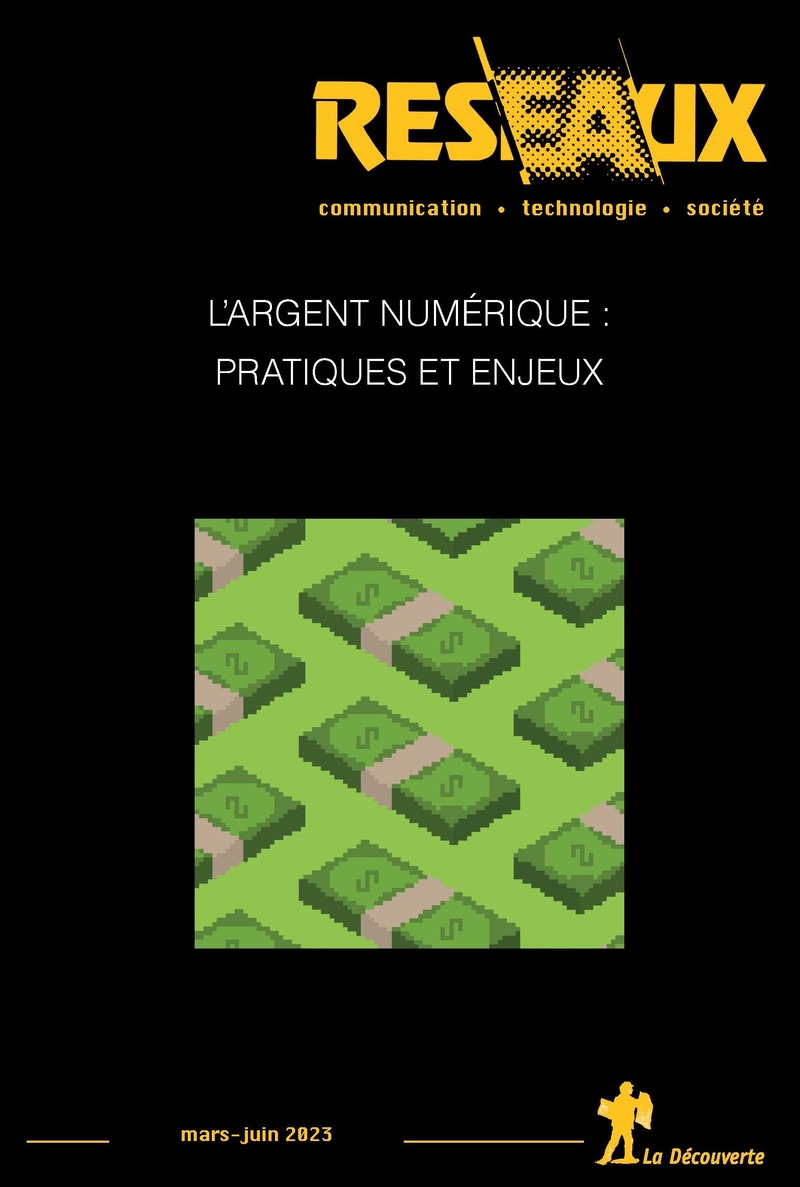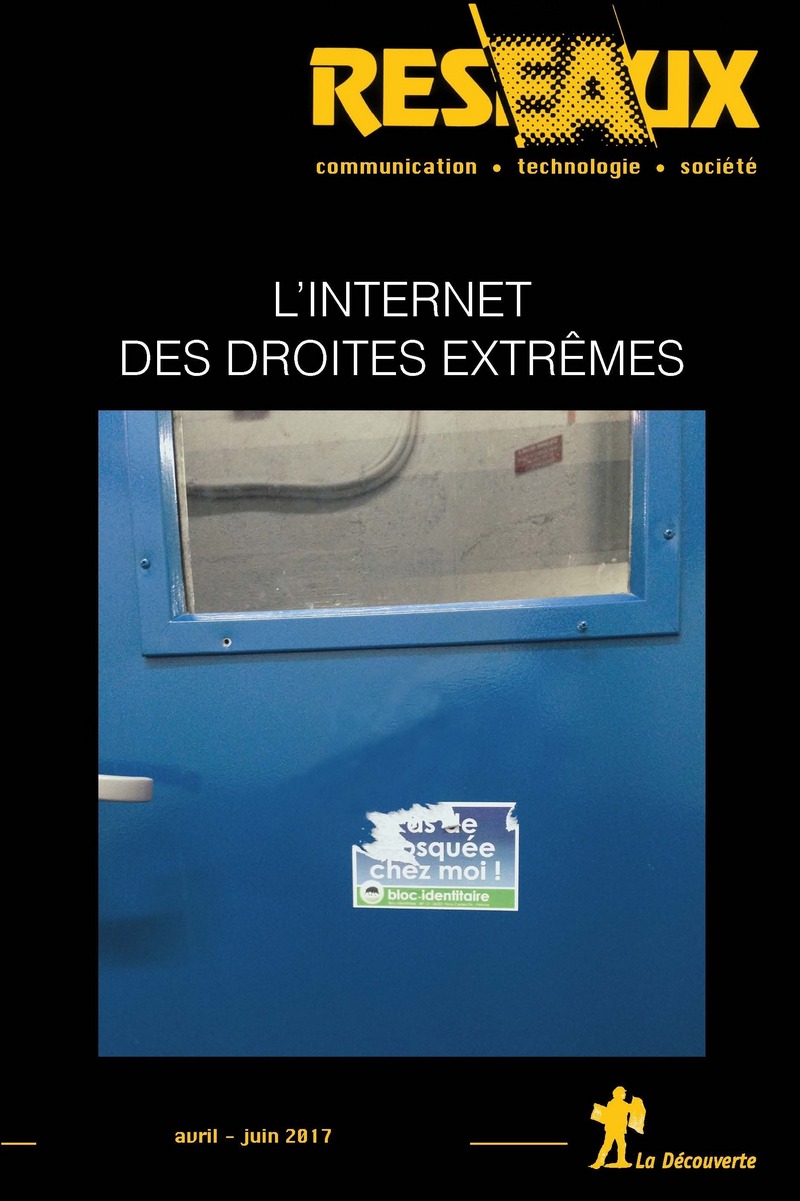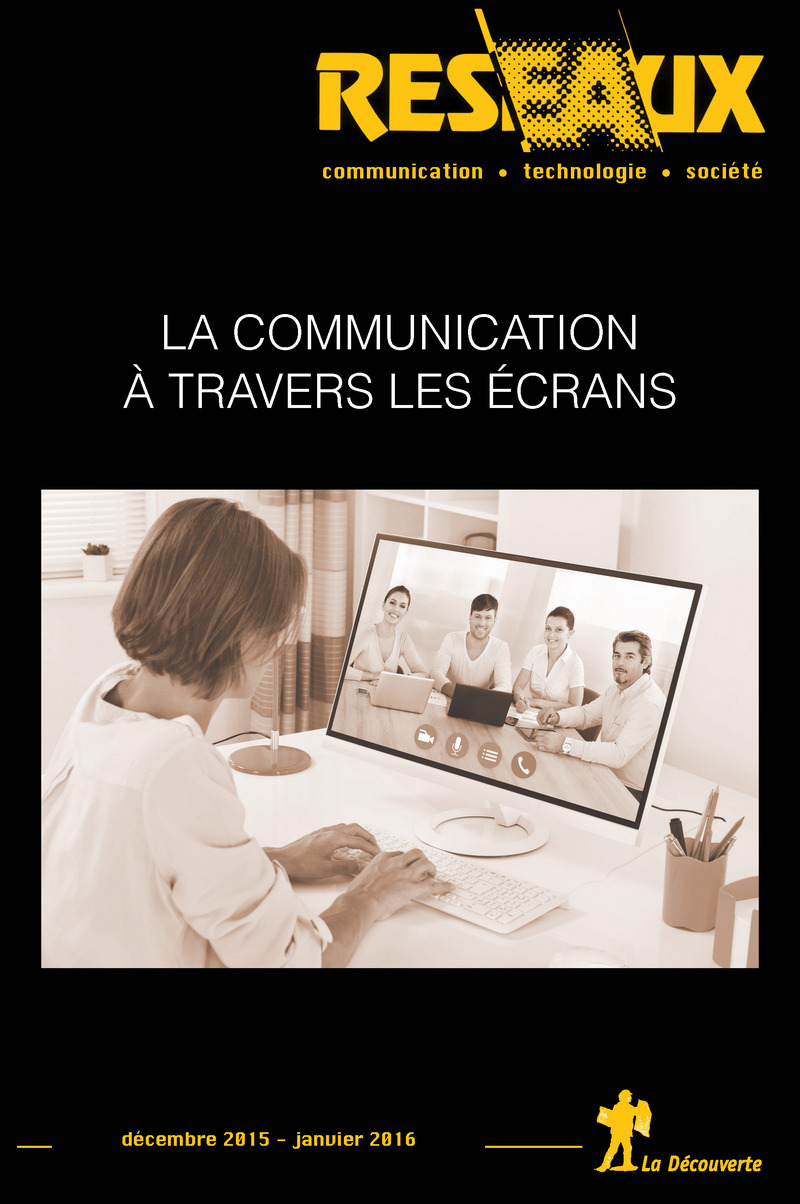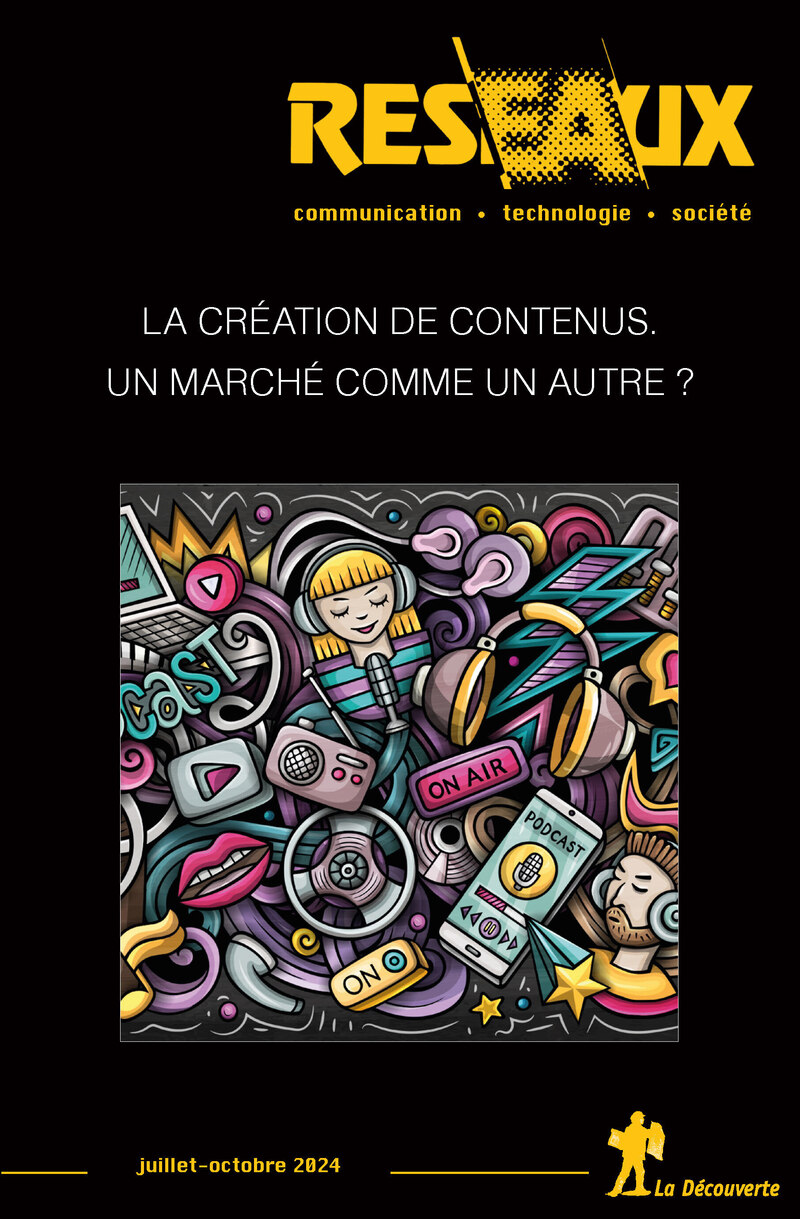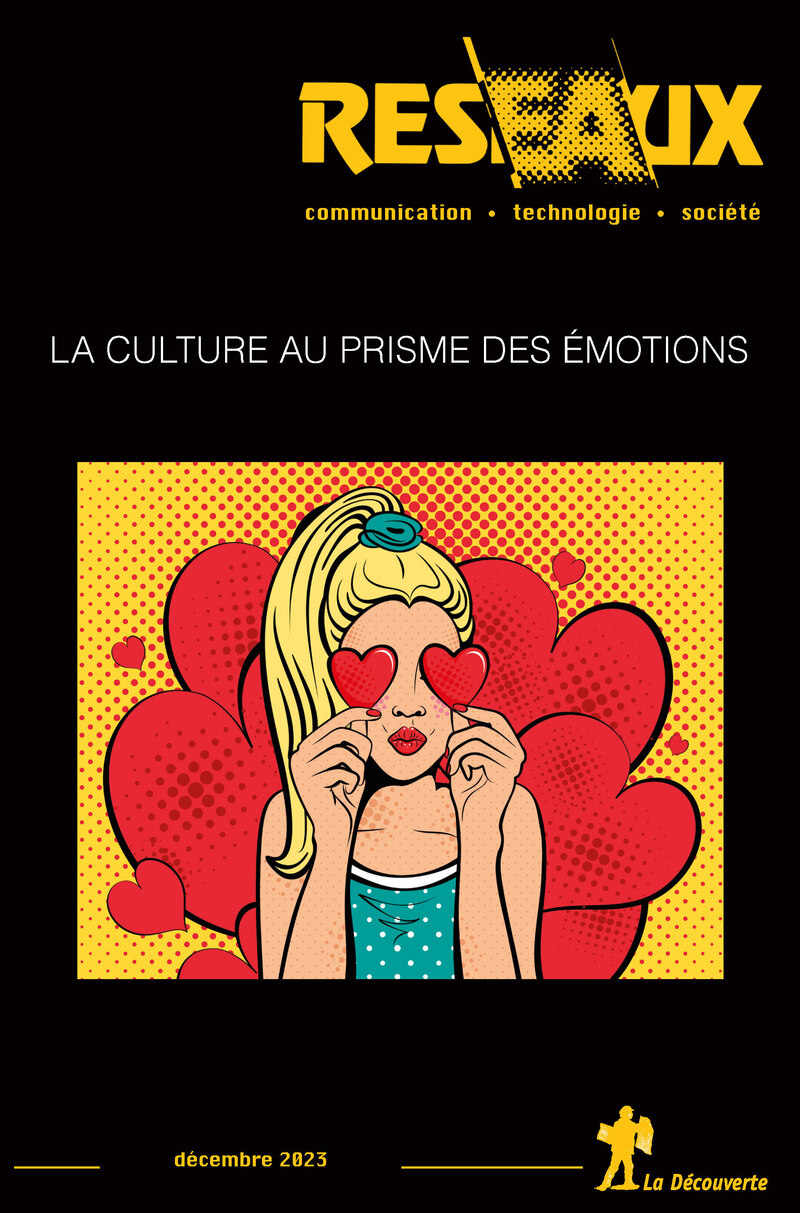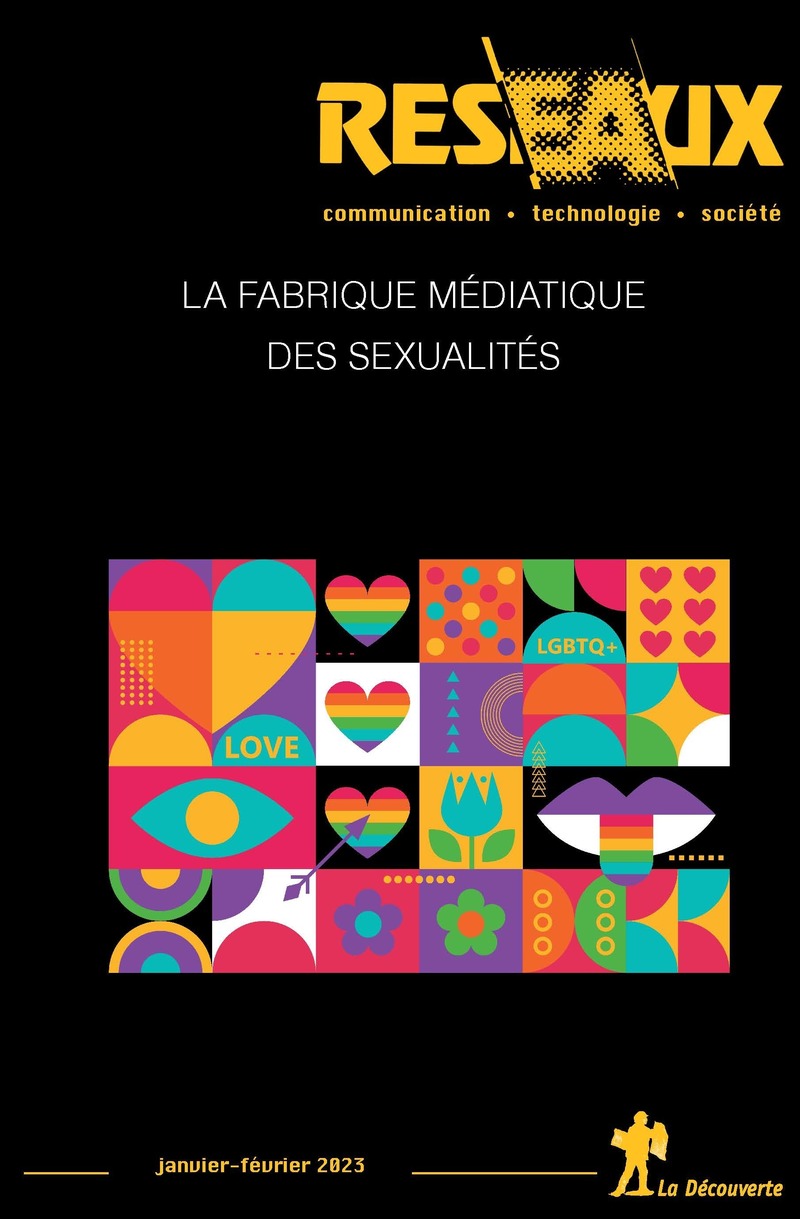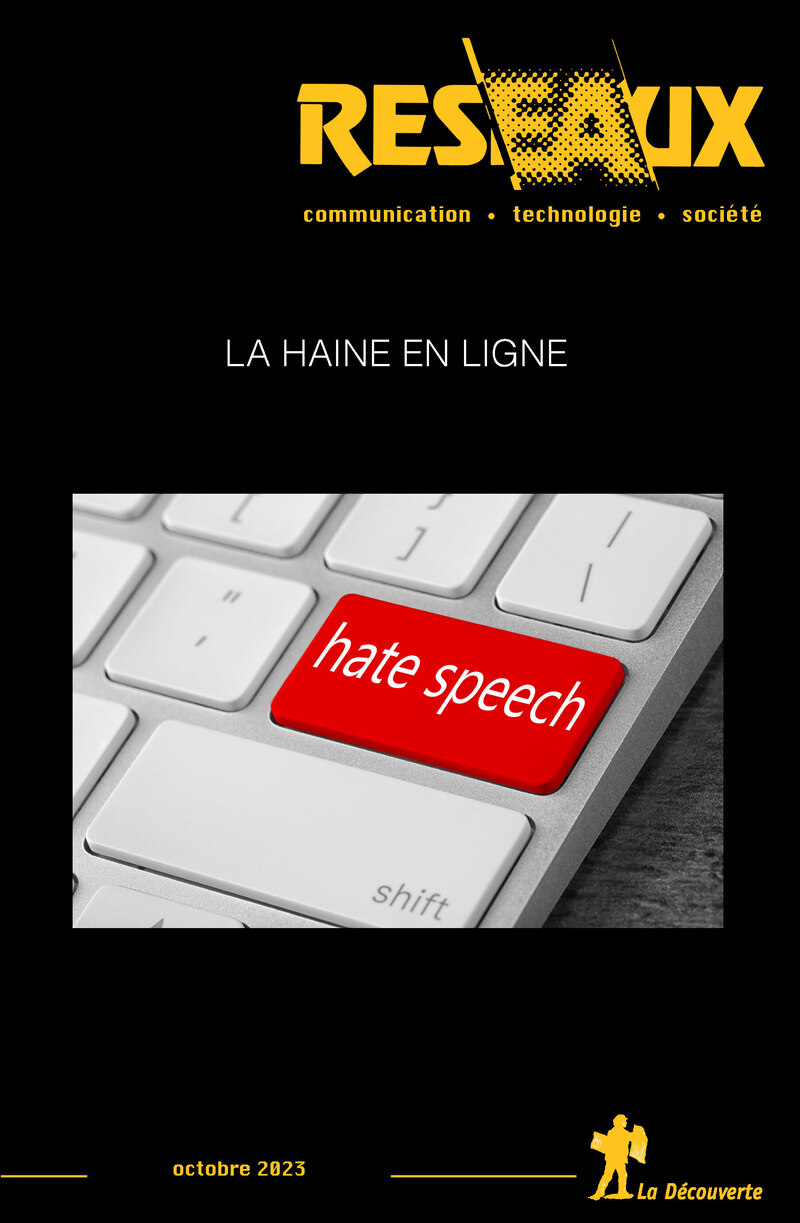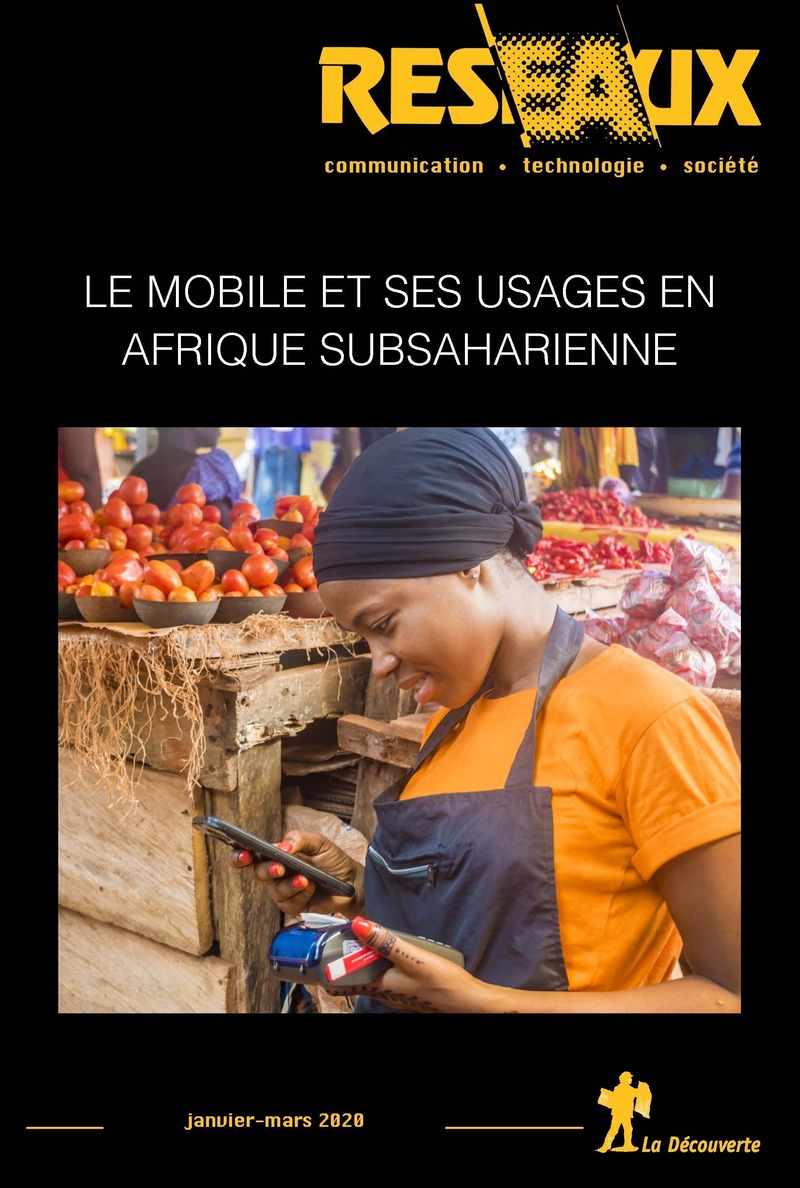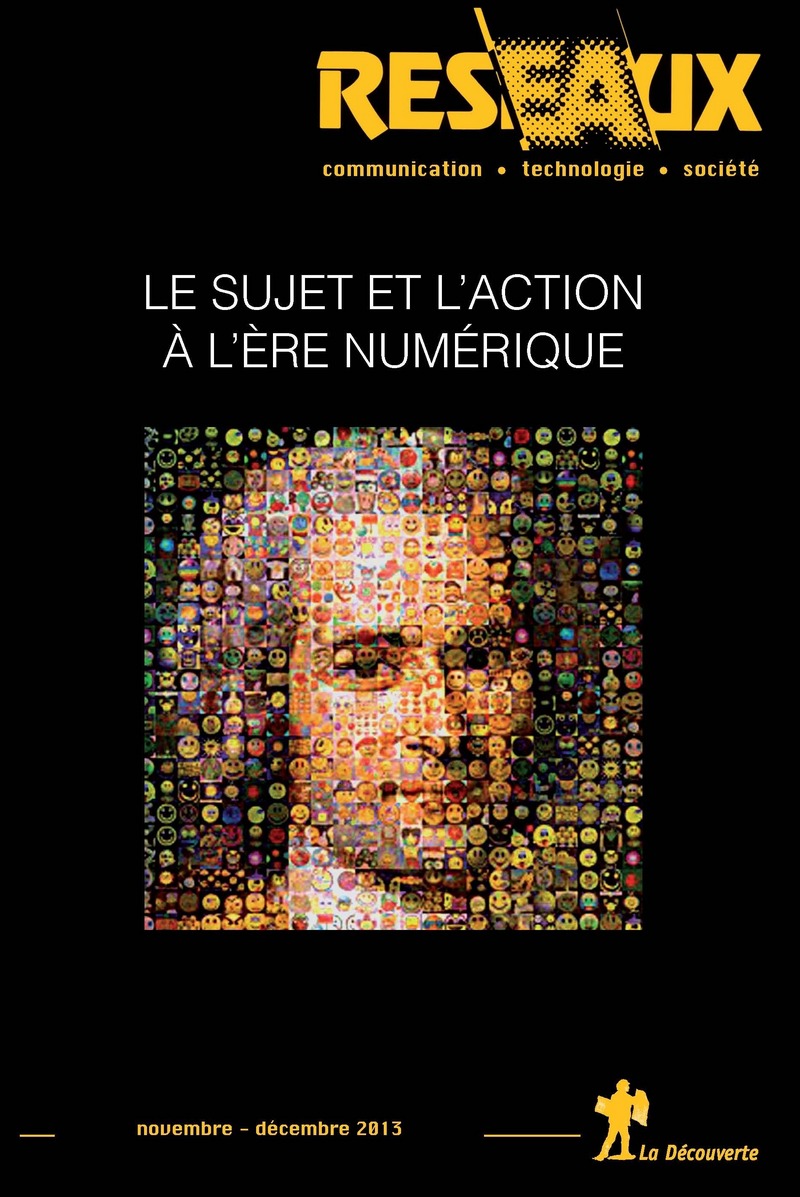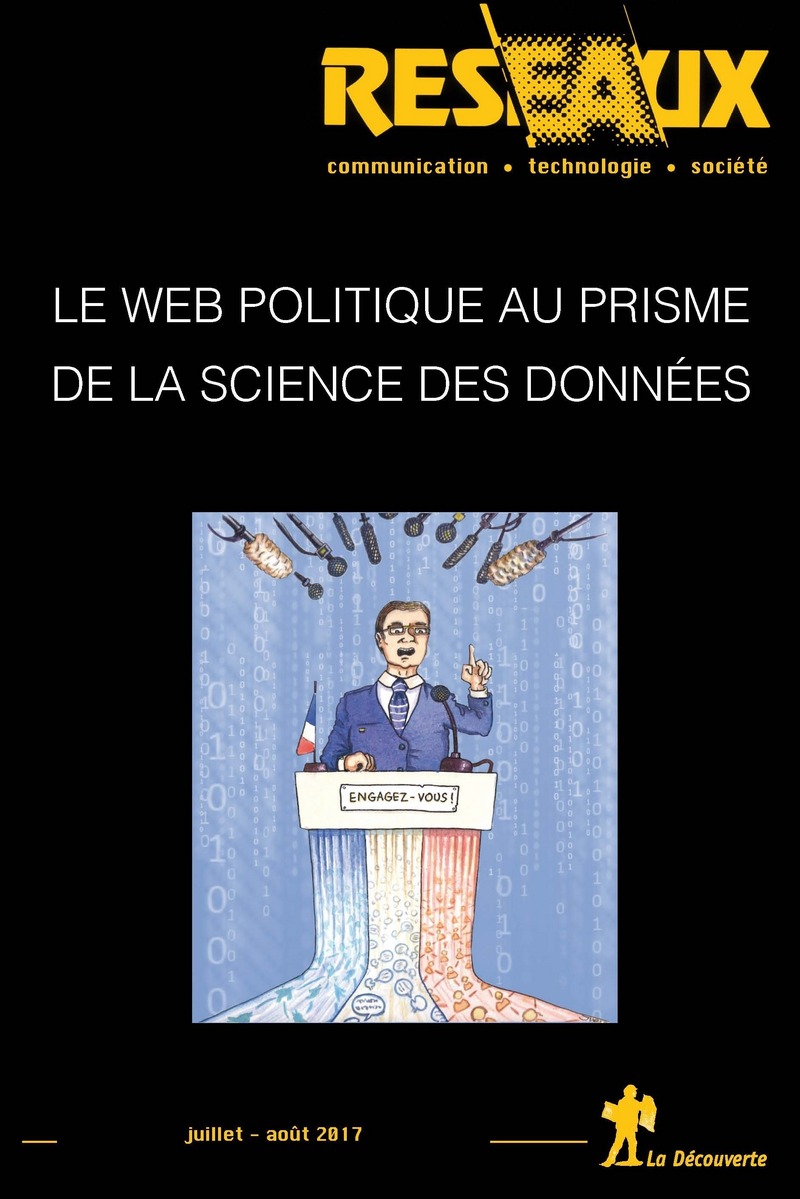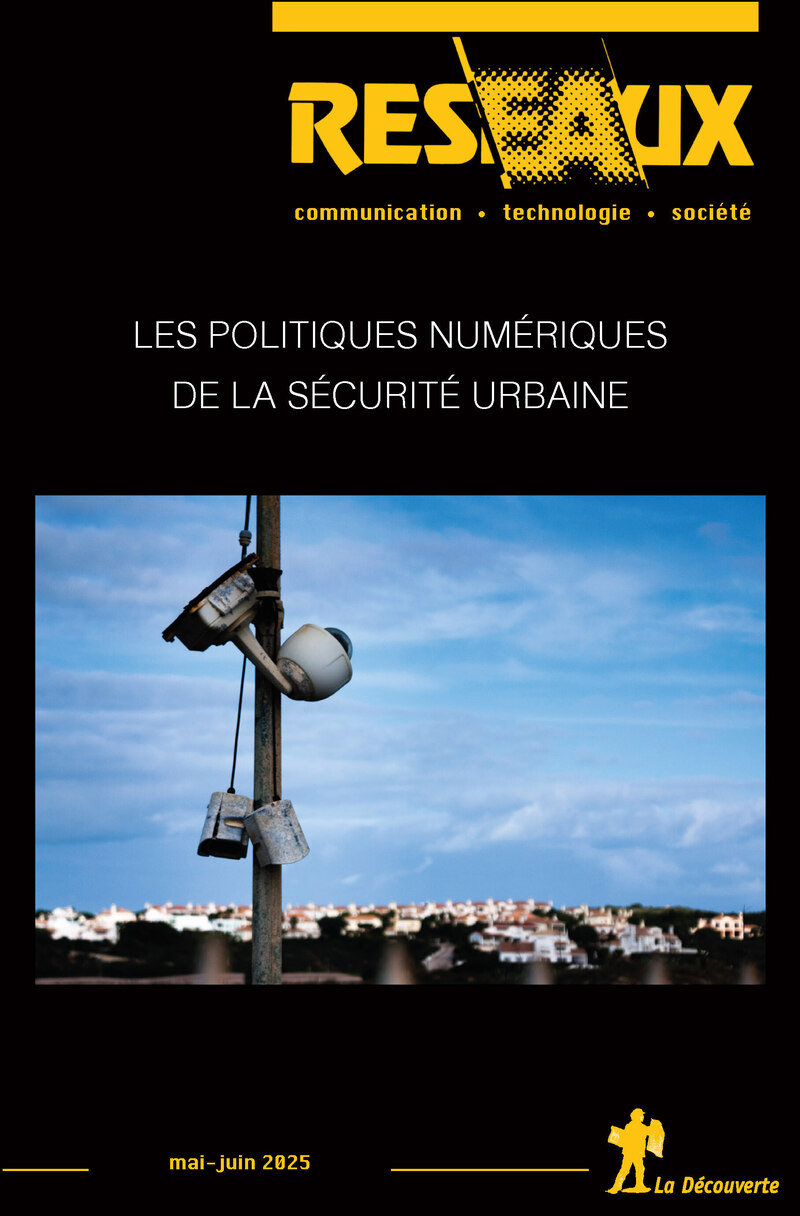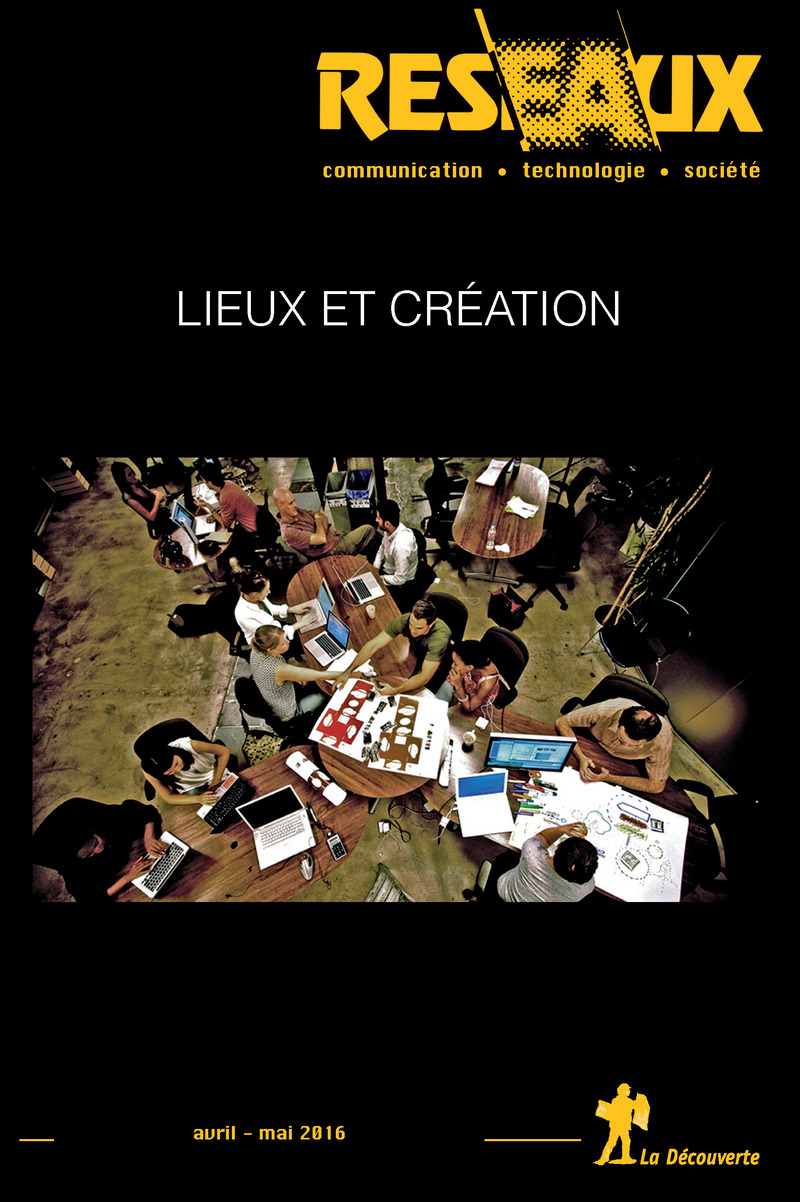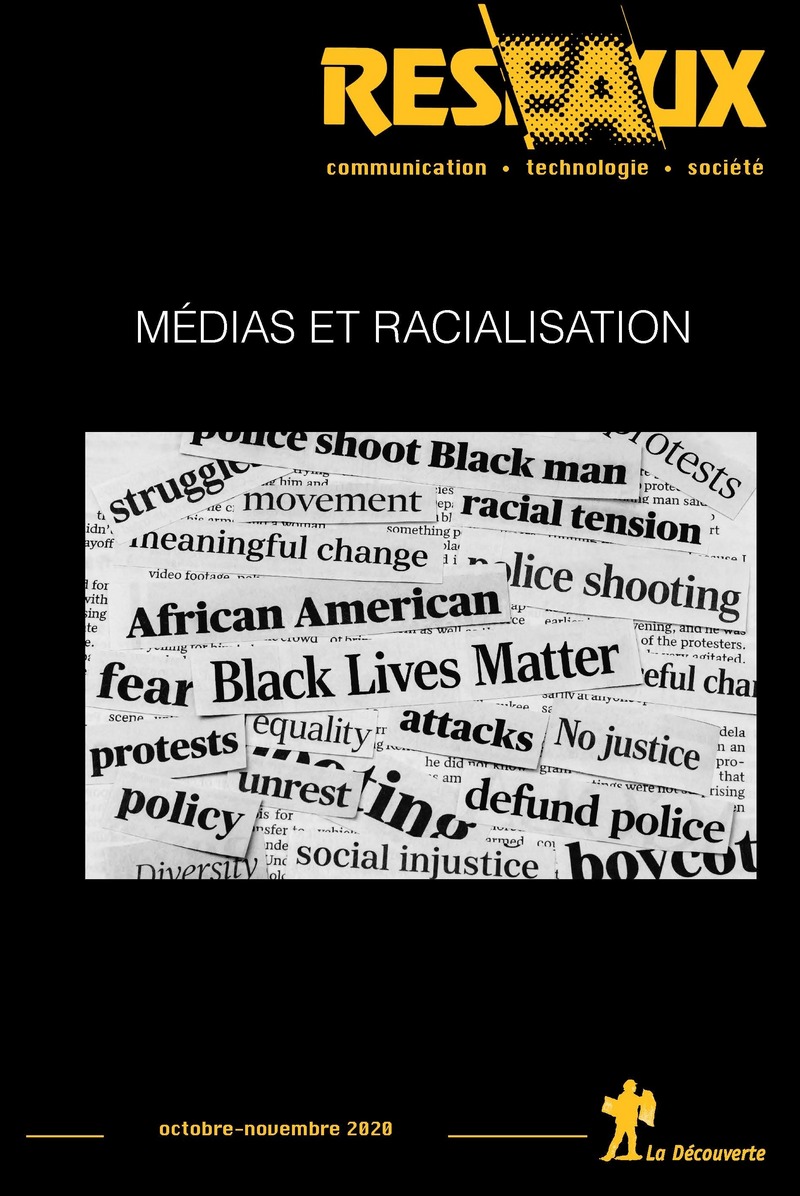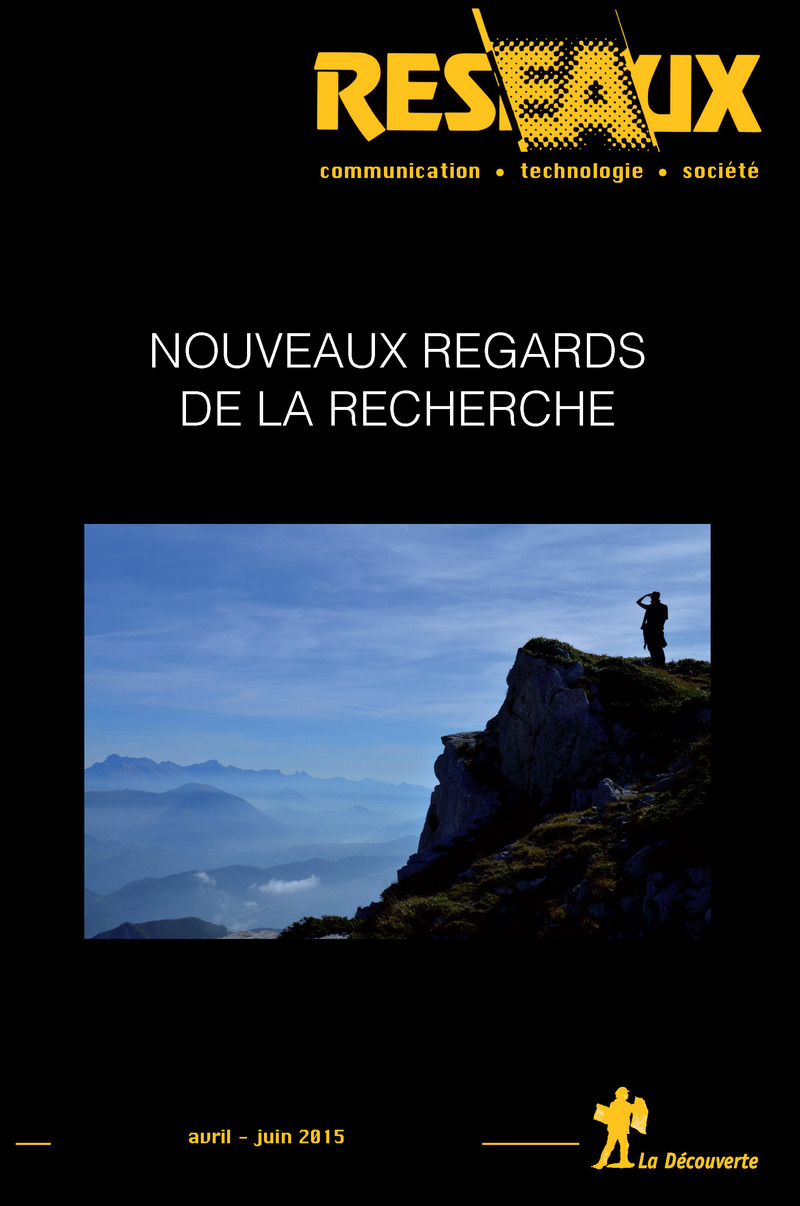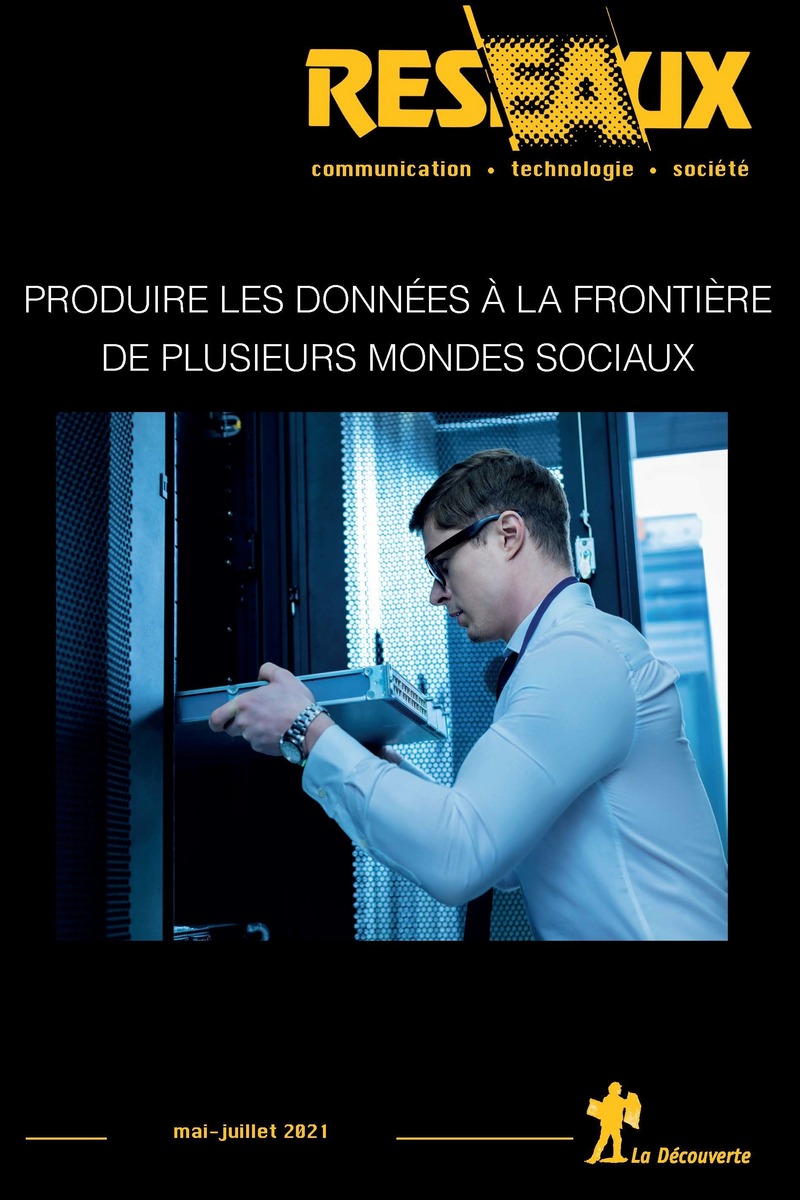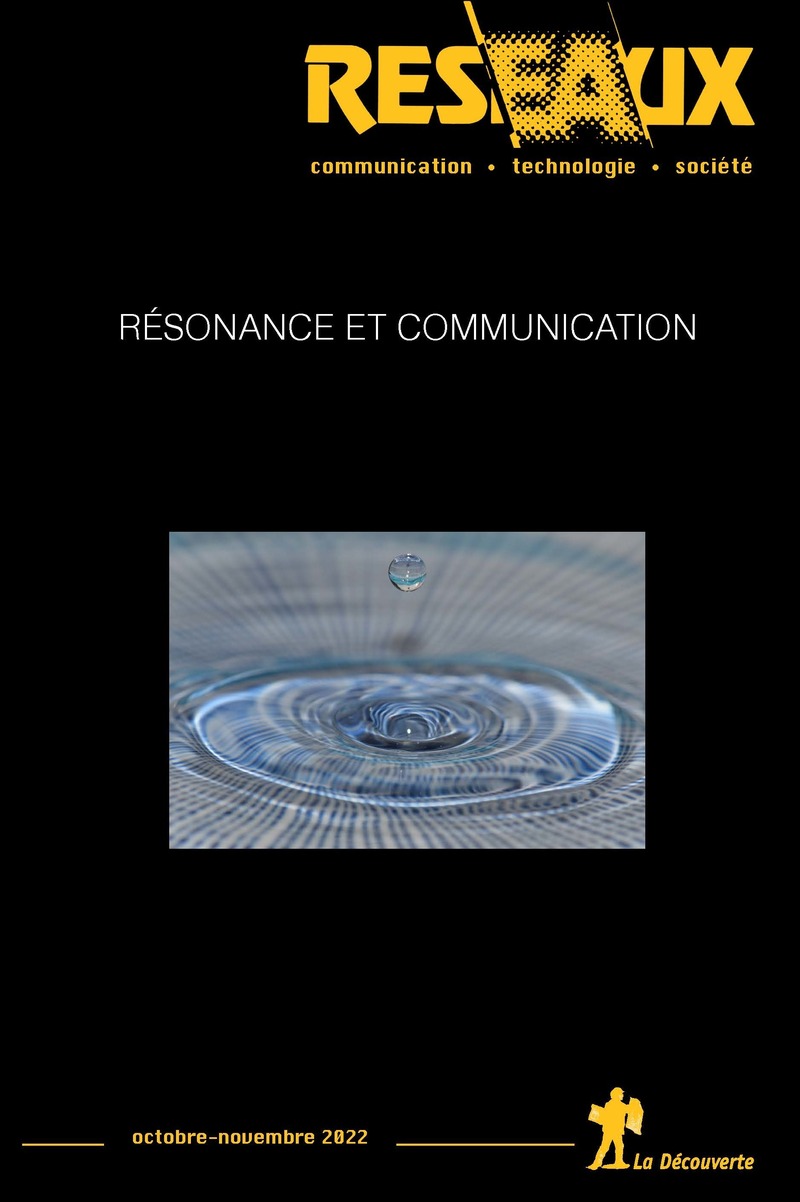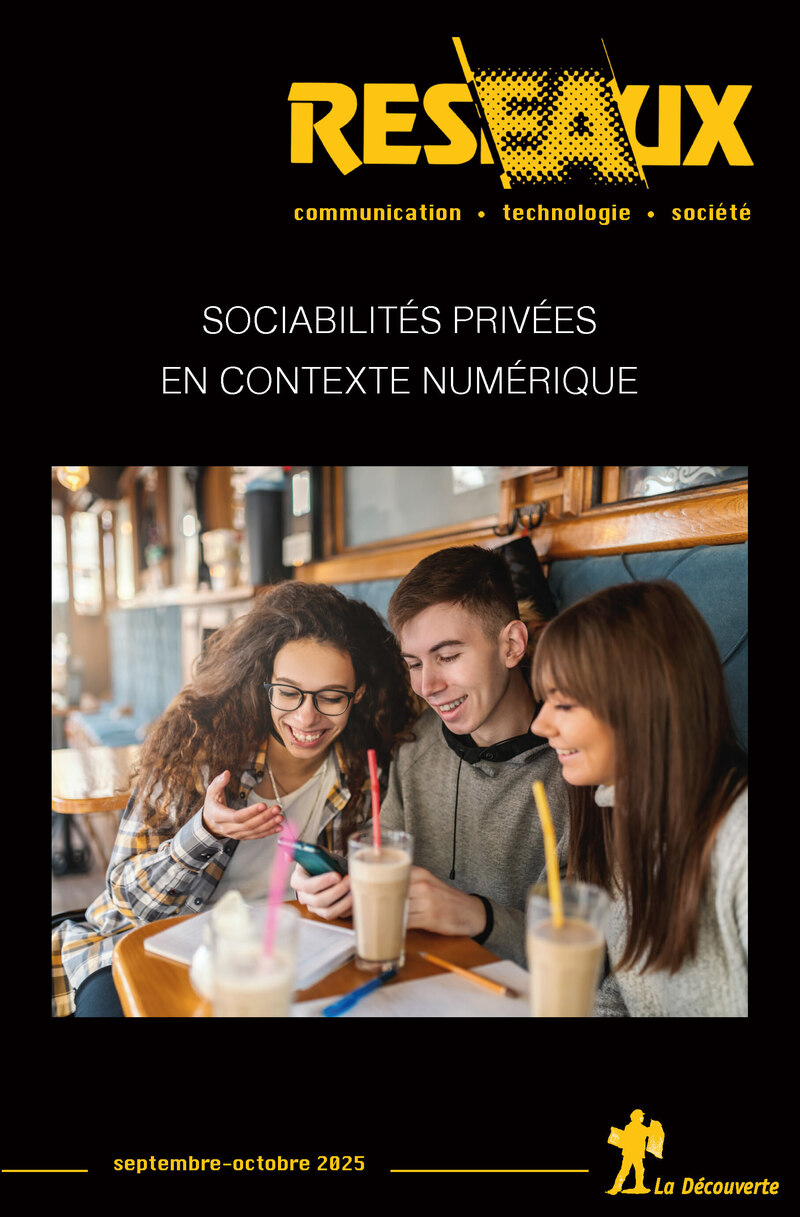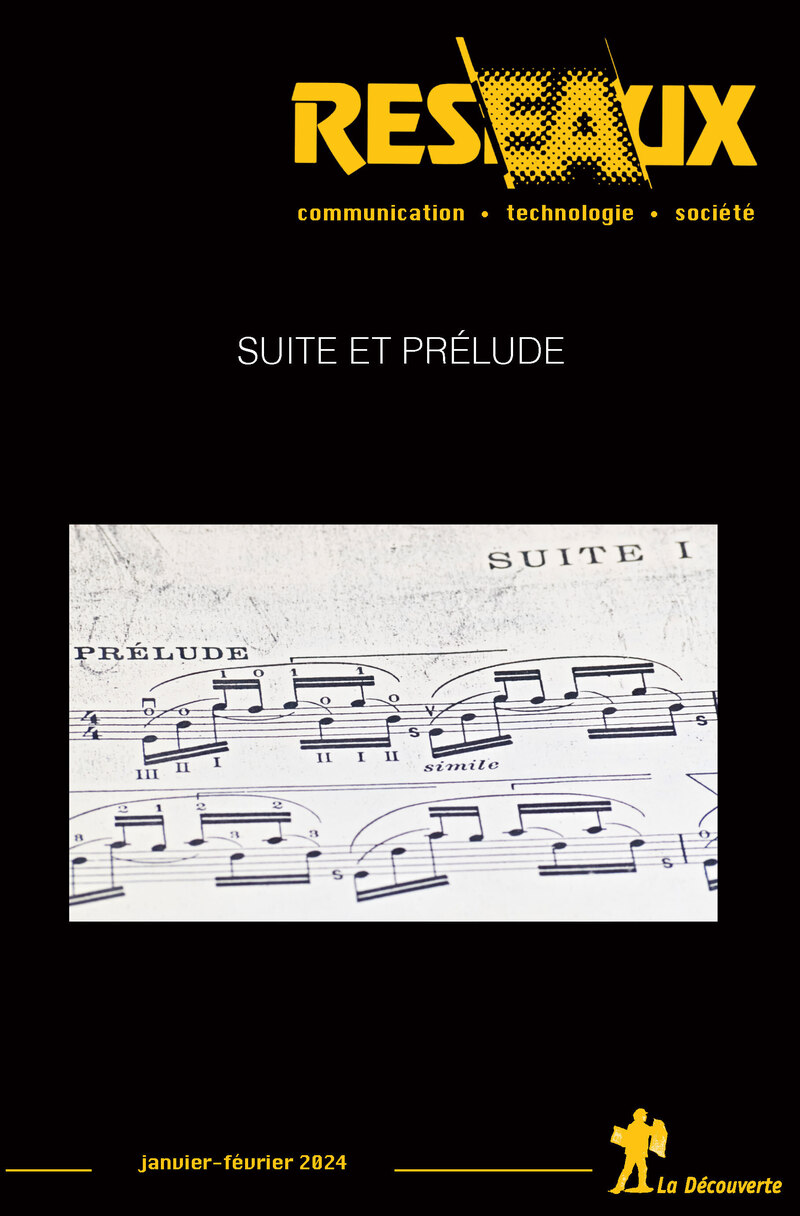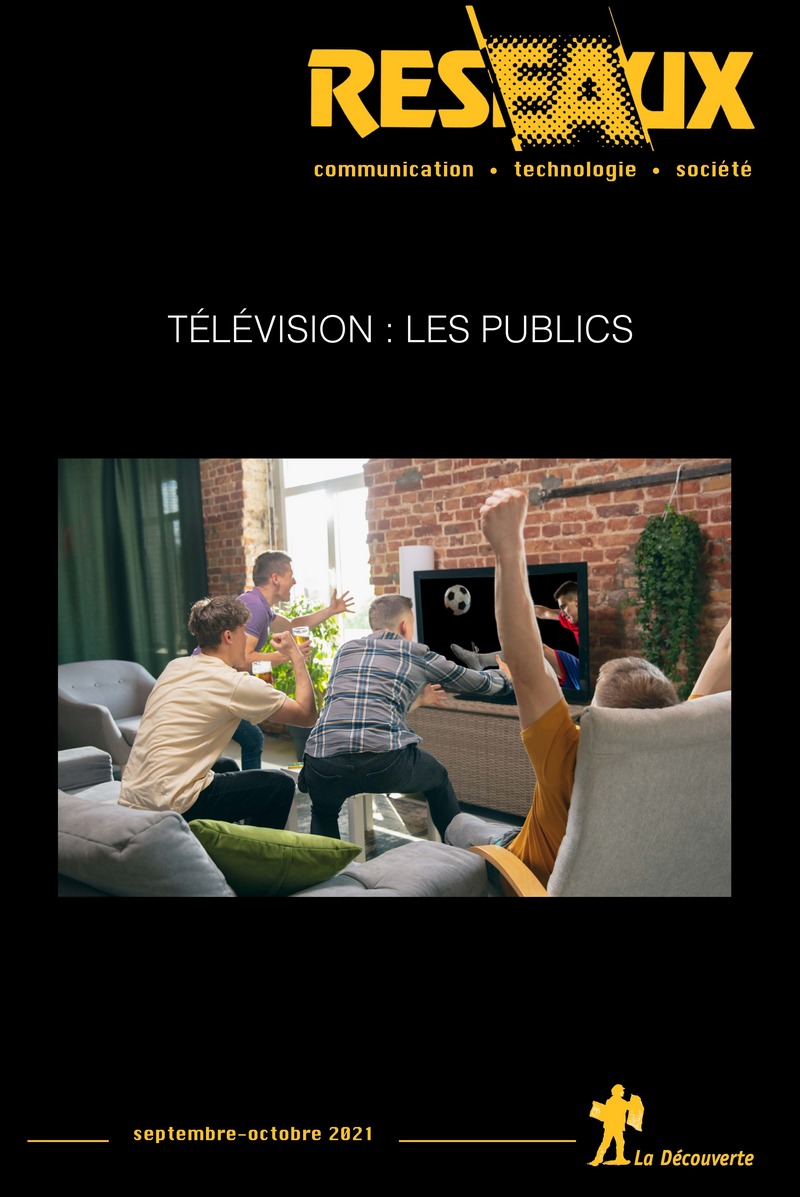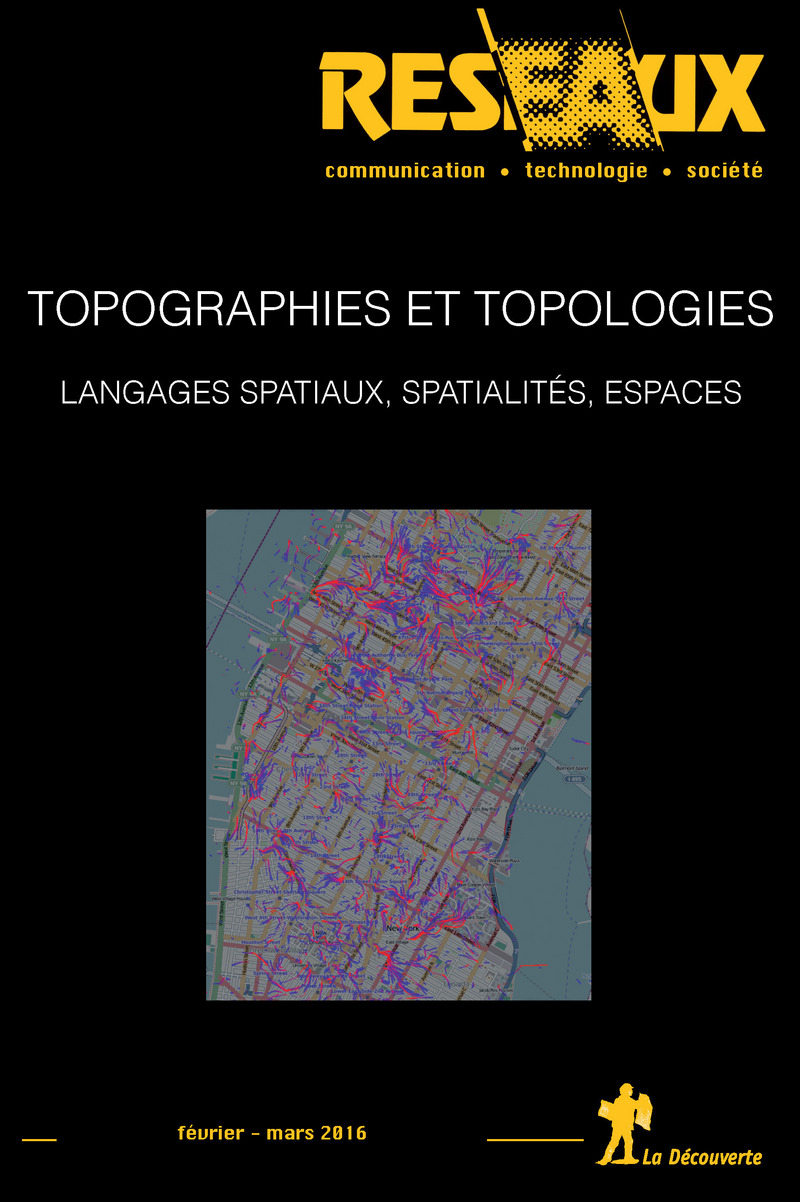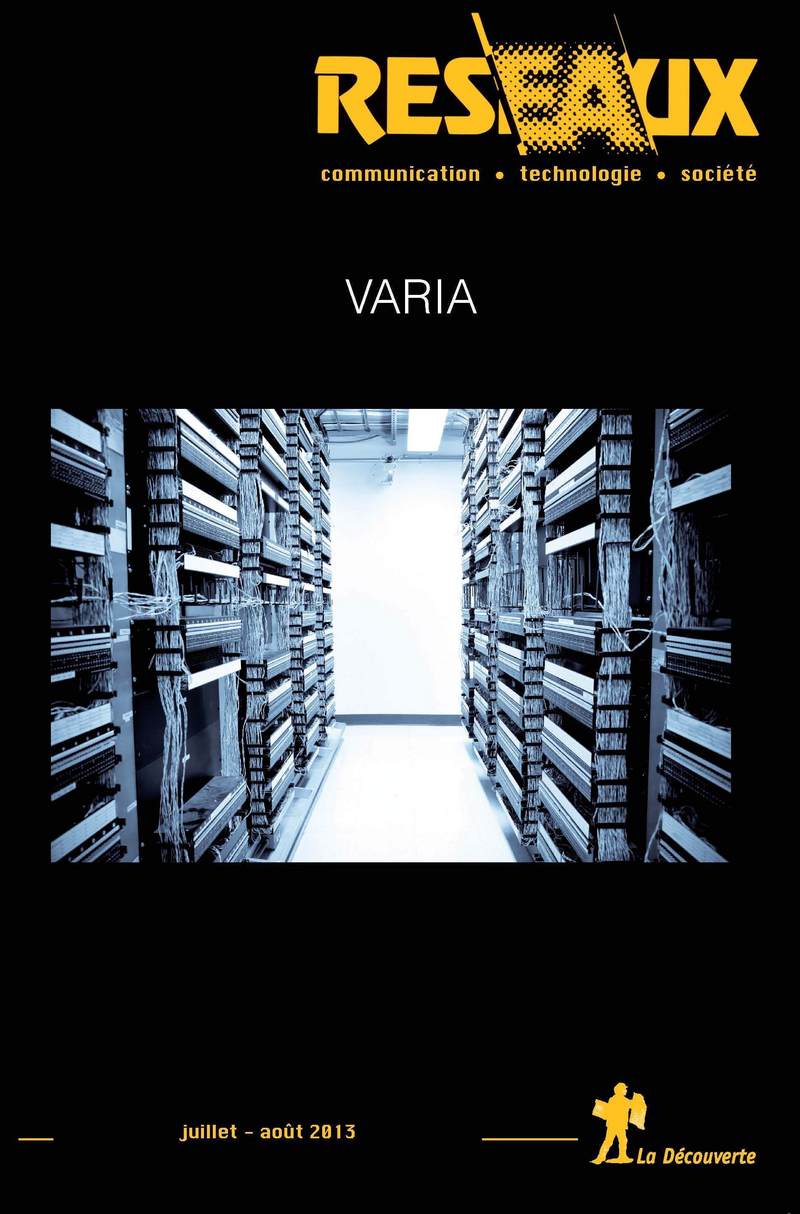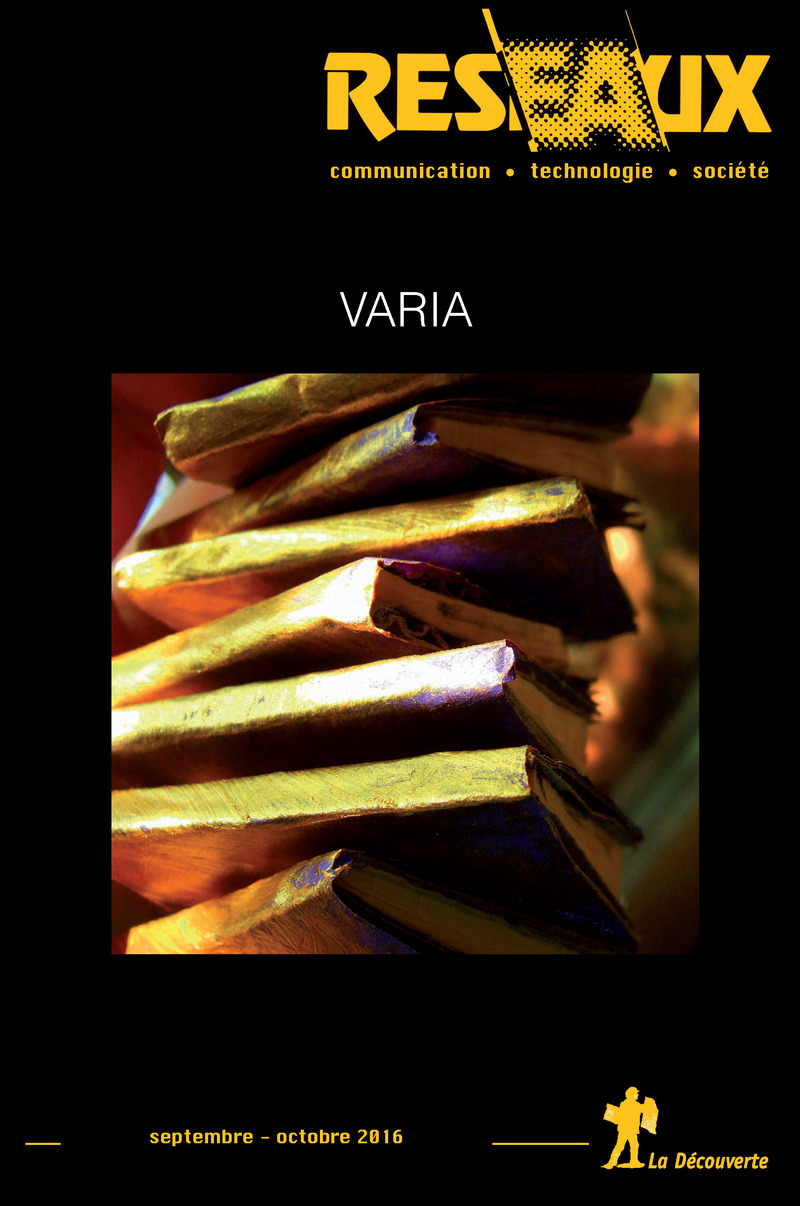Partis plateformes, plateformes de partis
Revue Réseaux
L'évocation de plateformes politiques et partis plateformes concernant les appropriations des technologies numériques à des fins partisanes apparaît a priori comme déconcertant. En effet, historiquement, le terme anglophone platform, de même que, de façon moins usuelle, les mots français plate-forme et plateforme, renvoient non à des dispositifs sociotechniques mais à un programme politique, c'est-à-dire à l'exposé des intentions, des projets d'une personne ou d'un groupe, soit un genre politique codifié, distinct du reste du matériel électoral, qui a une portée illocutoire et varie selon les contextes sociohistoriques (Bué et al., 2016). Les expressions plateforme politique et plateforme de parti ( political/party platform) concernent, au sens premier, un ensemble de propositions politiques et de politiques publiques, élaboré et utilisé en vue de la conquête de positions électorales, sans préjuger ni du type d'organisation, ni des techniques avec lequel cet ensemble se construit, s'impose ou se donne à voir dans le débat public.
Pourtant, depuis une douzaine d'années, et plus encore avec la parution de l'ouvrage de Paolo Gerbaudo The Digital Party (Gerbaudo, 2019), qui nourrit une grande partie des travaux rassemblés dans ce numéro, l'usage des syntagmes " politique plateforme " et " parti plateforme " contribue à réorienter le sens de ceux-ci vers leurs déclinaisons numériques. La politique plateforme signale ainsi un état de la politique institutionnalisée dans lequel les organisations qui participent à la compétition électorale, quelles qu'elles soient – partis mais aussi organisations citoyennes, mouvements sociaux, voire agences spécialisées – s'ajustent à l'emprise des plateformes numériques sur les pratiques sociales et politiques et sont travaillées par celle-ci, du point de vue de leur fonctionnement interne et externe.

Nb de pages : 348
Dimensions : * cm
 Revue Réseaux
Revue Réseaux

La revue Réseaux. Communication - Technologie - Société, créée en 1982 par Patrice Flichy et Paul Beaud, s'intéresse à l'ensemble du champ de la communication en s'axant tout particulièrement sur les télécommunications. Les mass-médias et l'informatique sont également abordés. La télévision a notamment constitué le thème d'un nombre important de numéros. La réflexion sur la communication étant à l'origine de nombreux débats au sein des sciences sociales, des numéros sont aussi consacrés à des questions d'ordre théorique ou méthodologique. Bien qu'orienté plutôt vers la sociologie, Réseaux souhaite traiter les problèmes de la communication de façon pluridisciplinaire.
Pour s'abonner à la revue, rendez-vous sur le site Cairn.info
Table des matières 

Les auteurs
Présentation
Les partis politiques par temps de plateformes. Mobilisations électorales, transformations organisationnelles, initiatives citoyennes,
par Fabienne Greffet
Dossier : Partis plateformes, plateformes de partis
Le parti plateforme. La transformation des organisations politiques à l'heure du
Big Data,
par Paolo Gerbaudo, traduction et adaptation par Fabienne Greffet
" Partis plateforme " versus " partis en réseau ". Analyse comparative du design de plateforme et du débat en ligne dans
Rousseau et
Decidim,
par Fabrizio Li Vigni, Avec la collaboration d' Enka Blanchard
L'organisation en ligne des partis politiques européens. Entre avancées des consultations numériques et réticences concernant la digitalisation de la sélection des organes internes,
par Giulia Sandri, Felix Von Nostitz et Marie Neihouser
La plateformisation comme idéal participatif : vers une démocratisation de la démocratie ? Les cas de Ma Voix et de LaPrimaire.org,
par Anaïs Theviot
Plateformes numériques et participation politique dans une démocratie inaboutie. Le cas des partis politiques de l'opposition au Cameroun,
par Aboubakar Sidi Njutapwoui
La dichotomie des réseaux socionumériques pour le parti au pouvoir en Chine. L'exemple de la médiatisation du nationalisme,
par Zhuoran Ma
Sociologie des plateformes marchandes
L'hébergement Airbnb hors des grandes métropoles. Une activité plus ou moins rationalisée entre visée rentière et occupation,
par Nicolas Oppenchaim, Marie-Pierre Lefeuvre et Julian Devaux
Histoire des techniques
La " privatisation " de l'électron. Propriété intellectuelle et capitalisme technoscientifique dans les industries des télécommunications,
par Benoît Lelong
Notes de lecture
Gérald GAGLIO,
Du neuf avec des vieux ? Télémédecine d'urgence et innovation en contexte gériatrique, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2018, 291 p.,
par Nicolas Klein
Olivier FOURNOUT,
Le nouvel héroïsme : puissances des imaginaires, Paris, Presses des Mines, 2022, 209 p., par
Catherine Lejealle
Julie SEDEL,
Dirigeants de médias. Sociologie d'un groupe patronal. Rennes, PUR, 2021, 274 p. ,
par Ivan Chupin
Résumés.