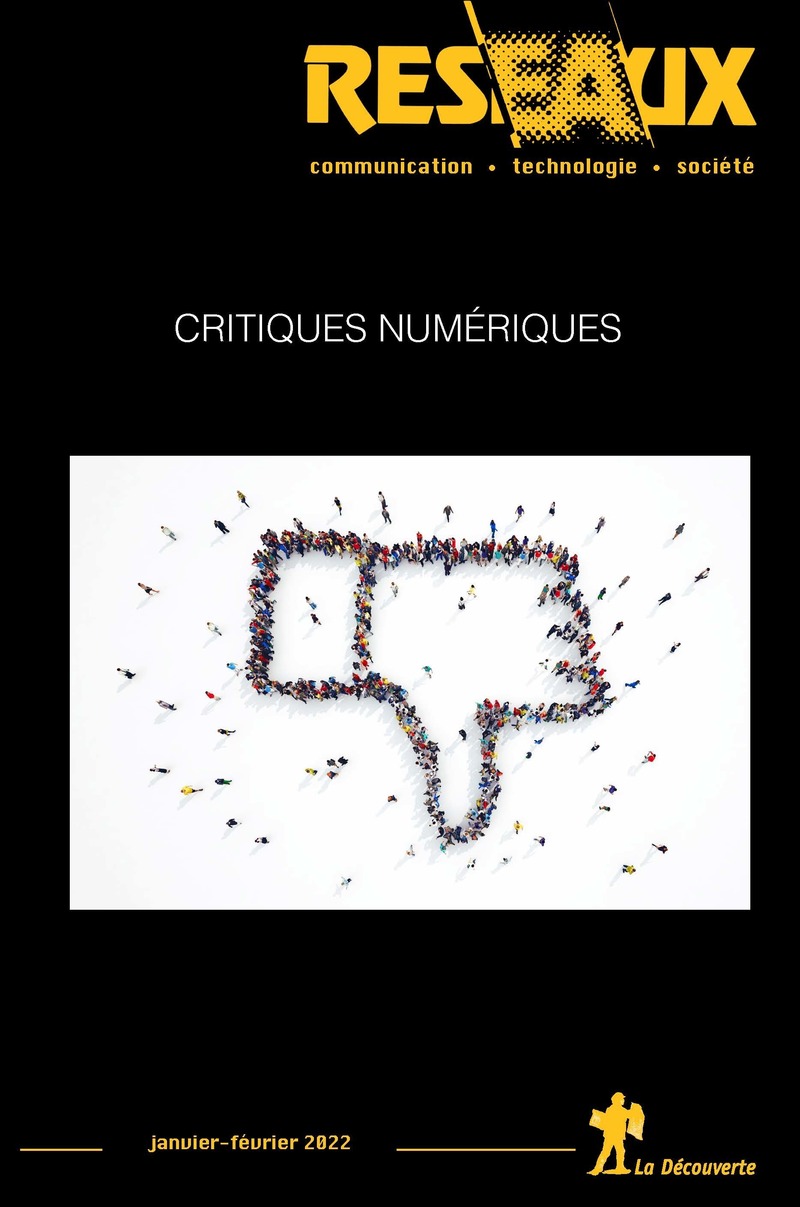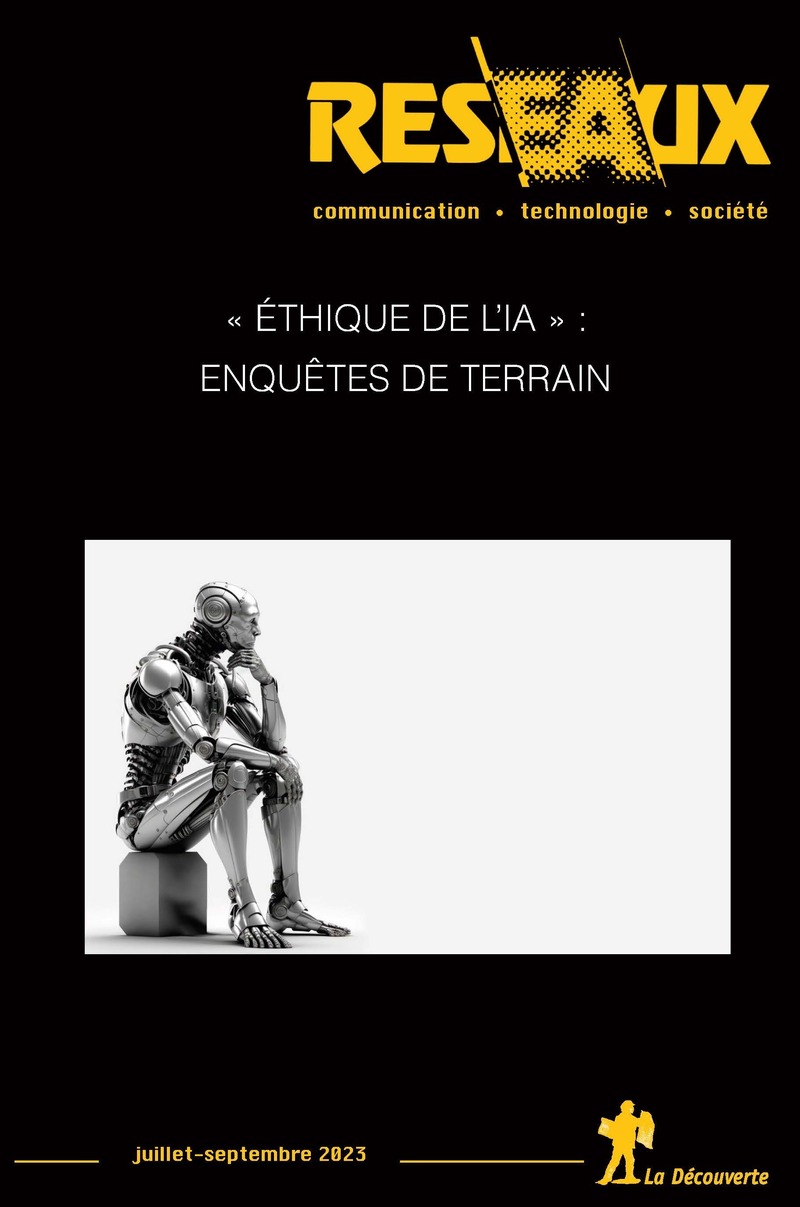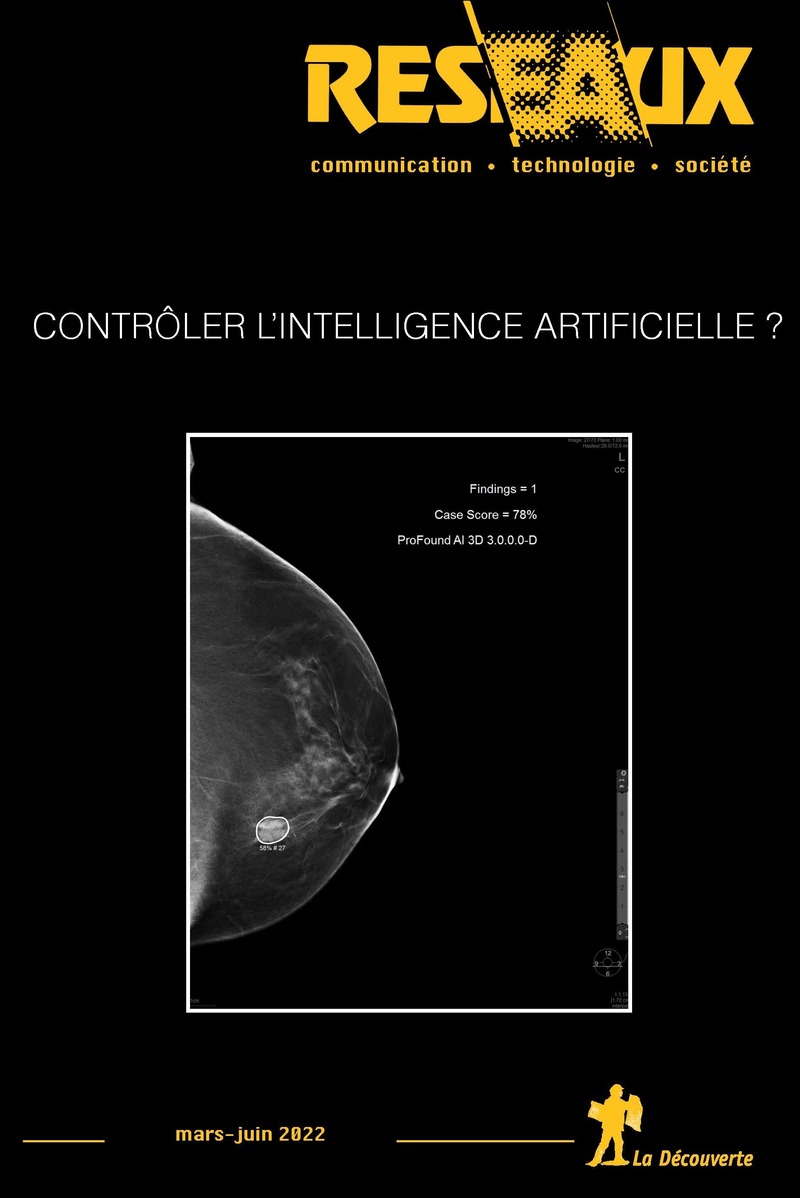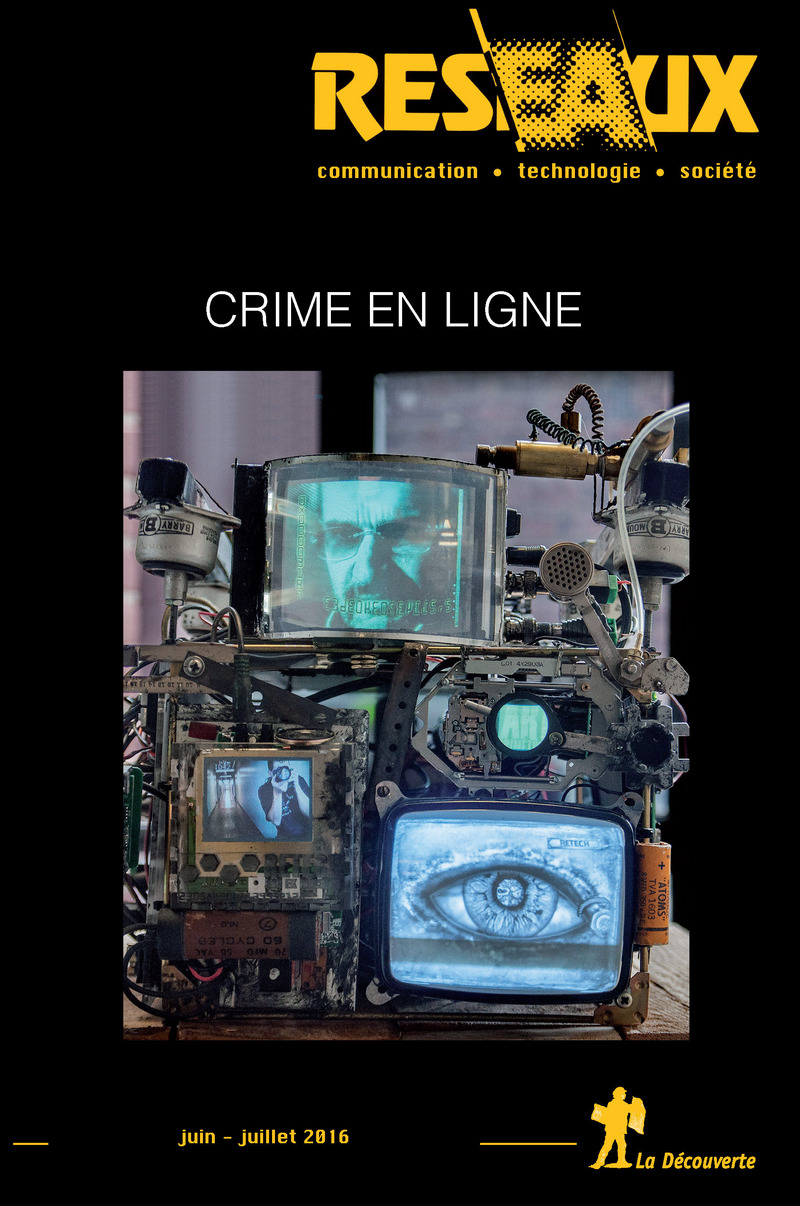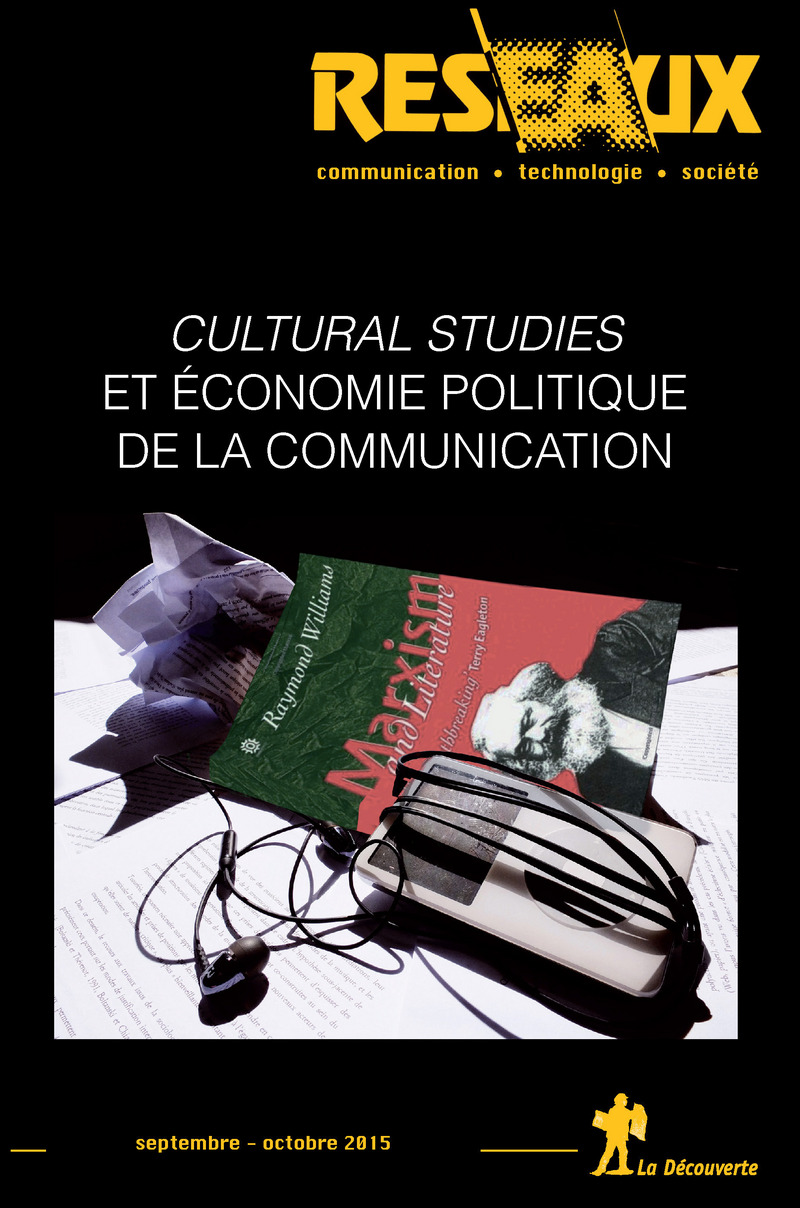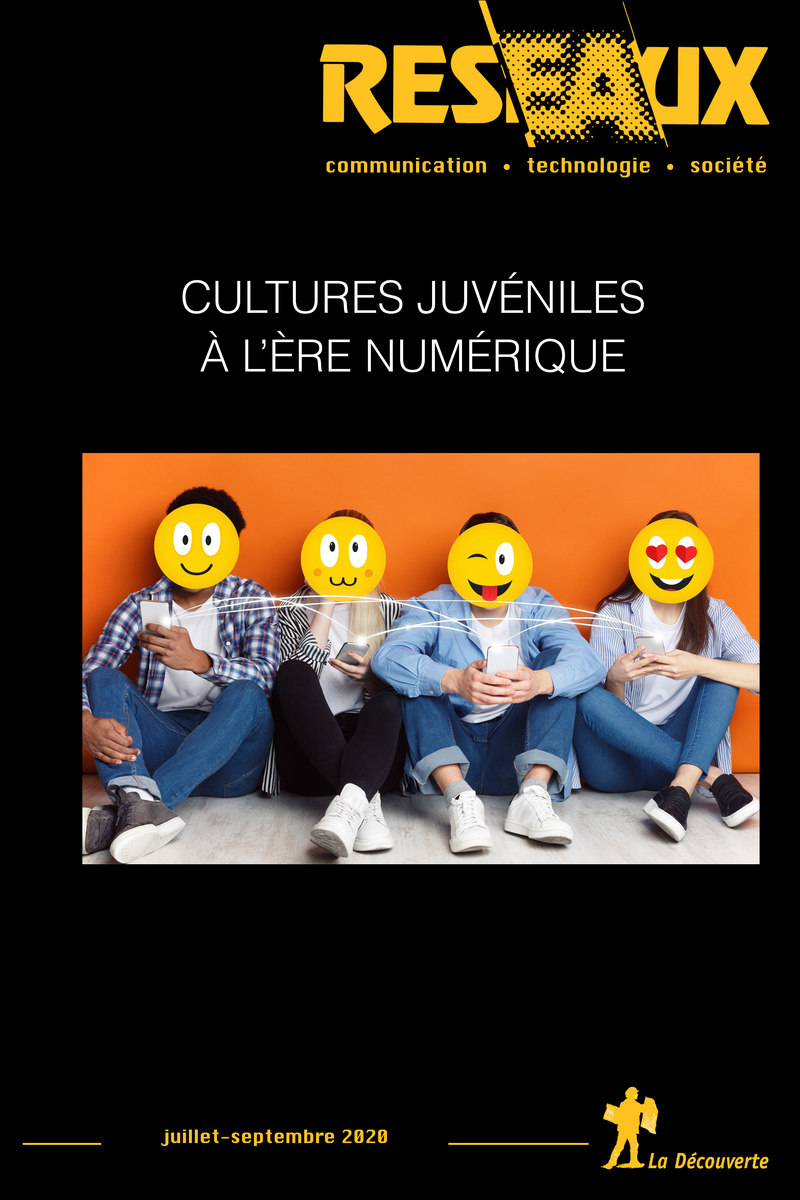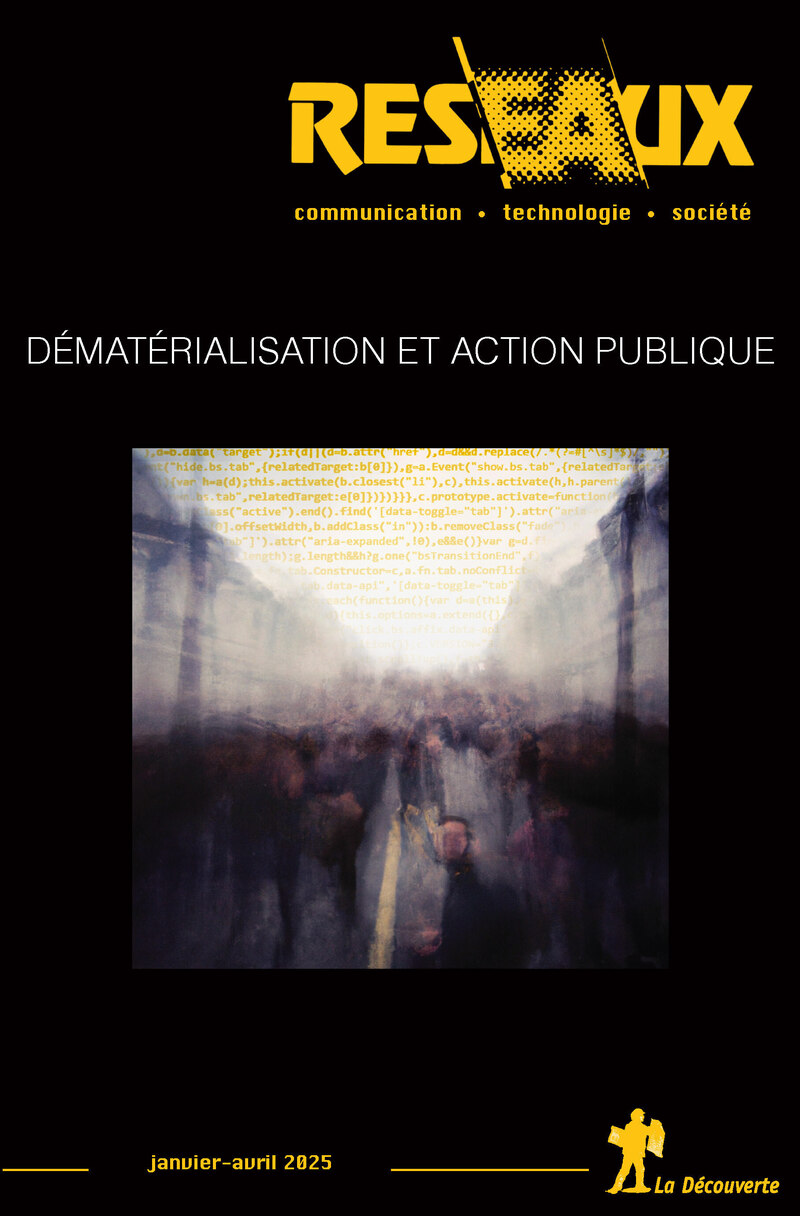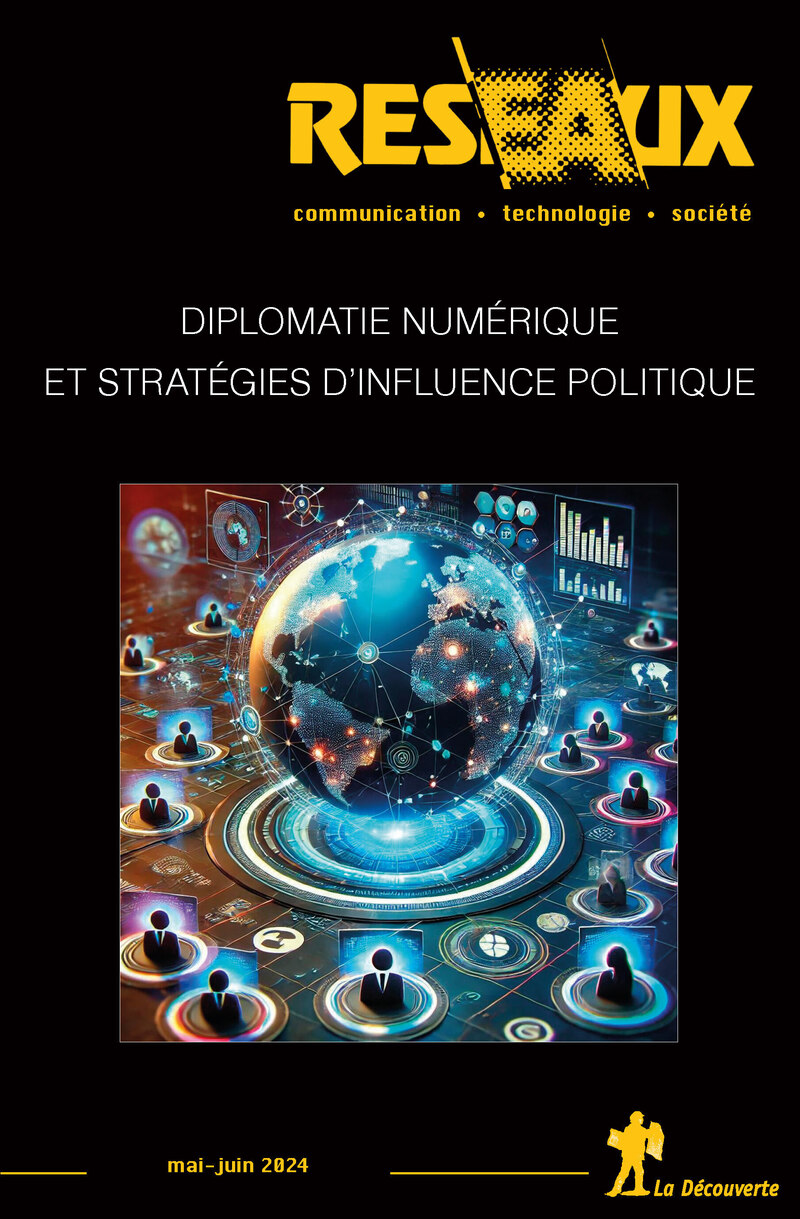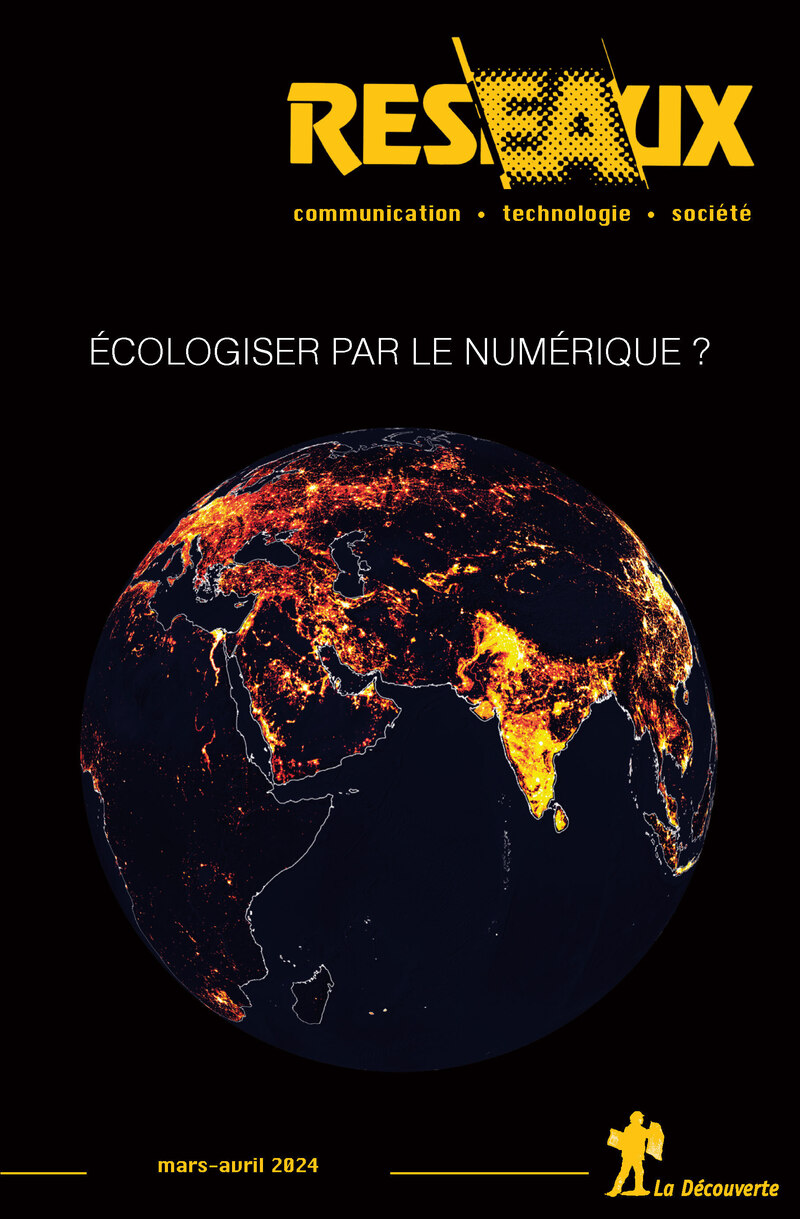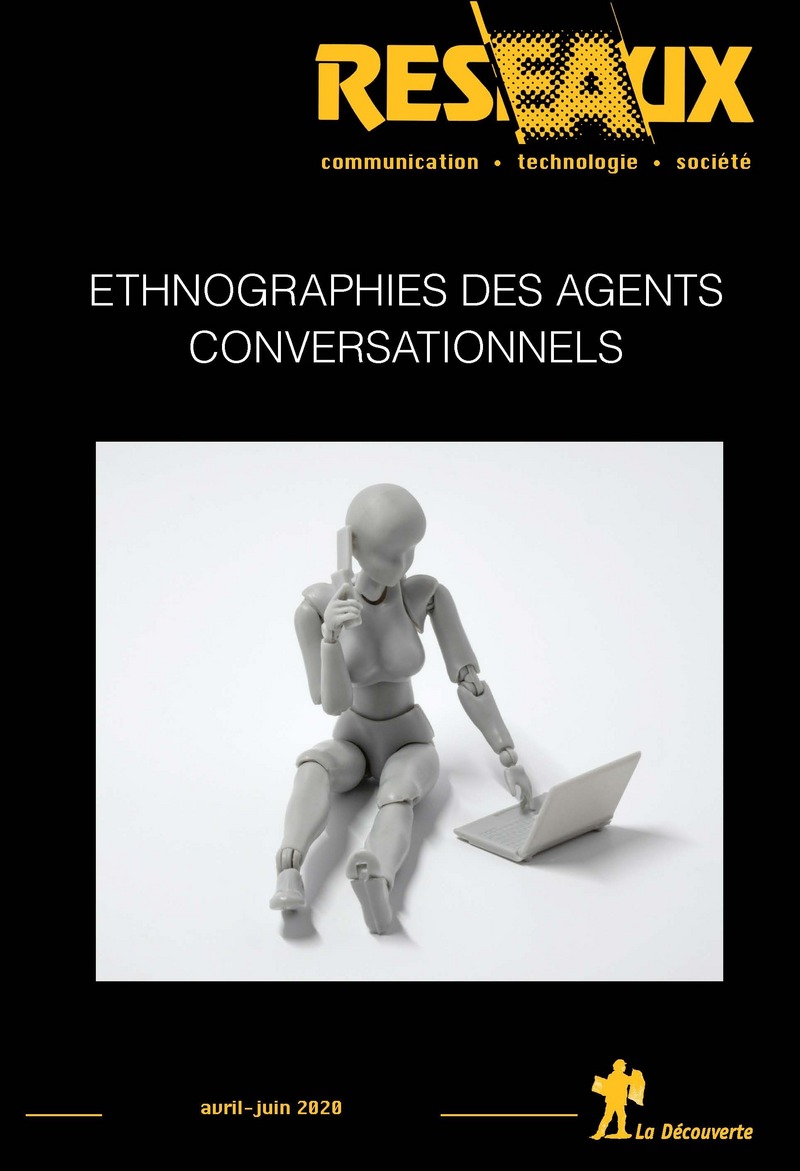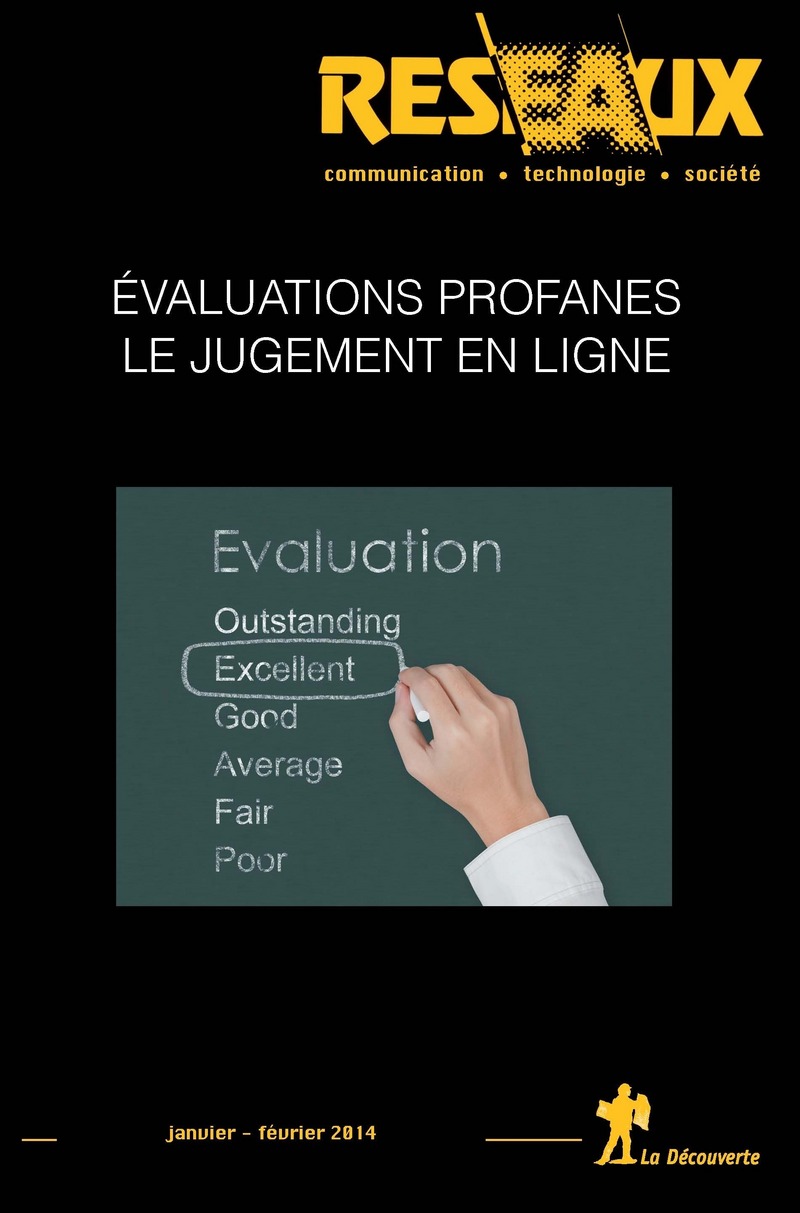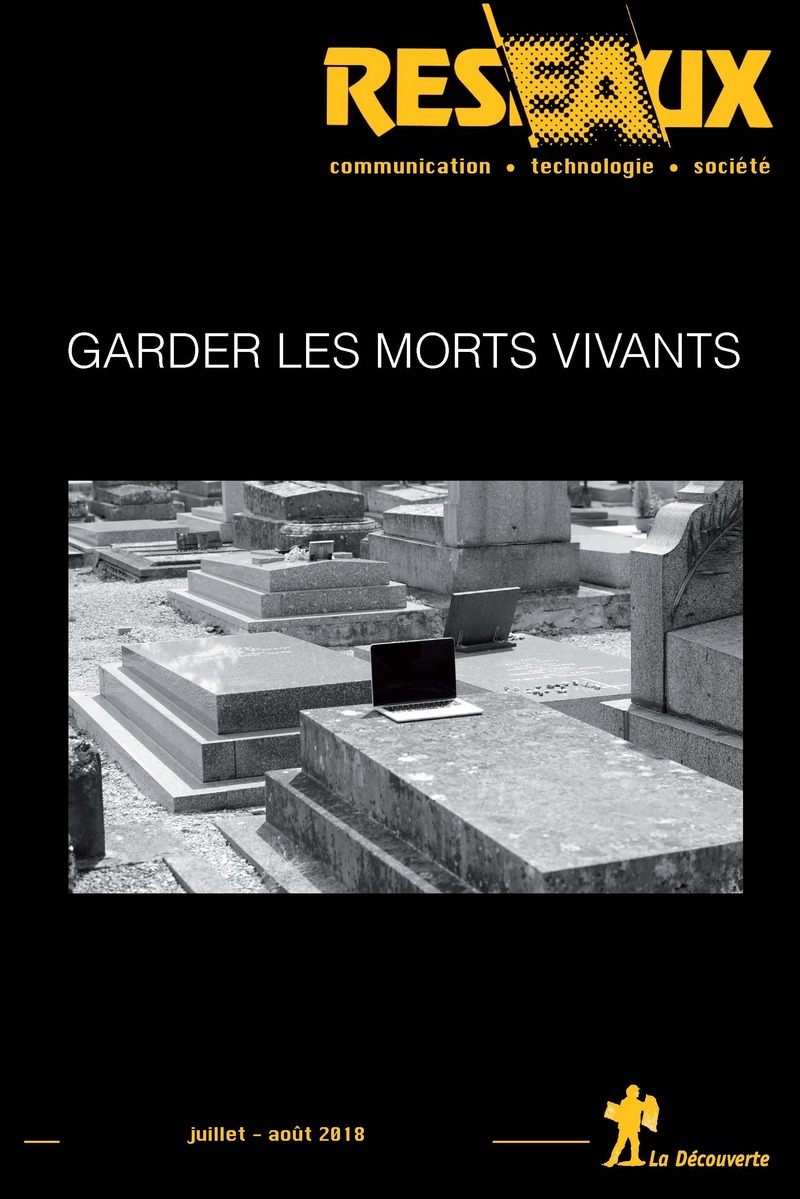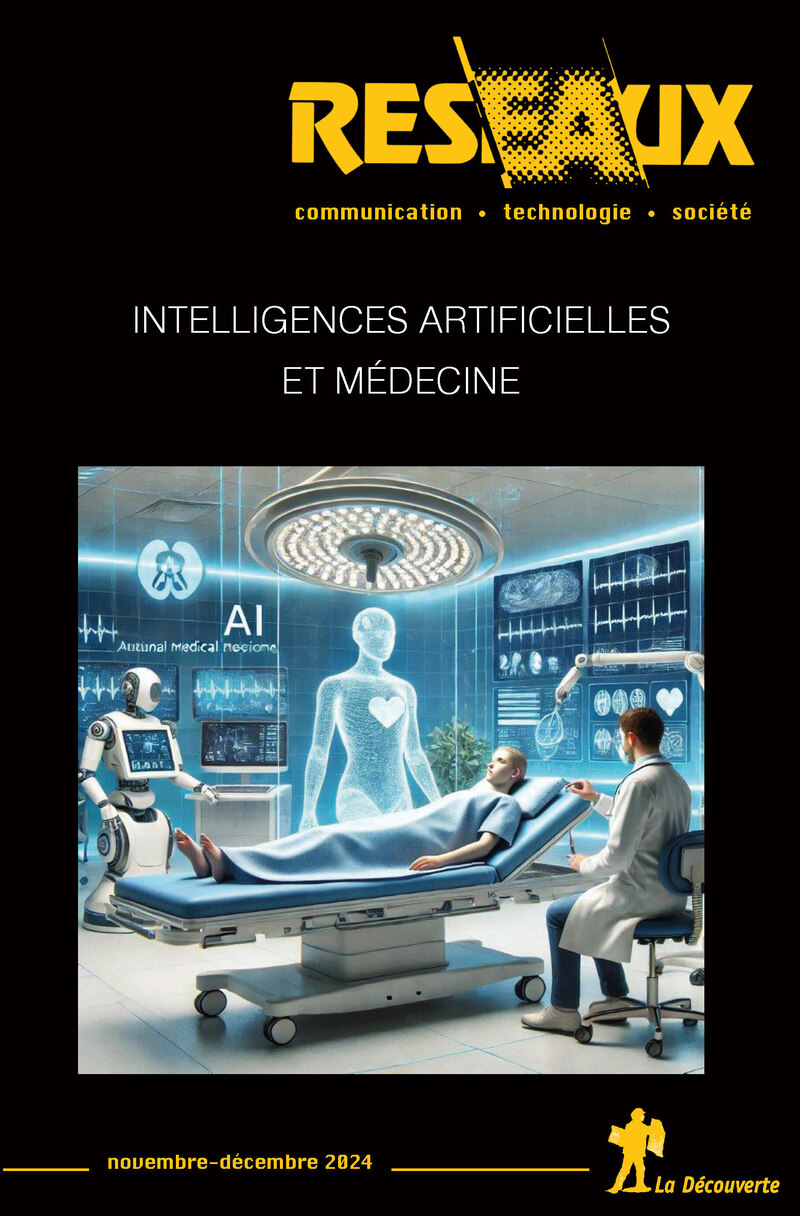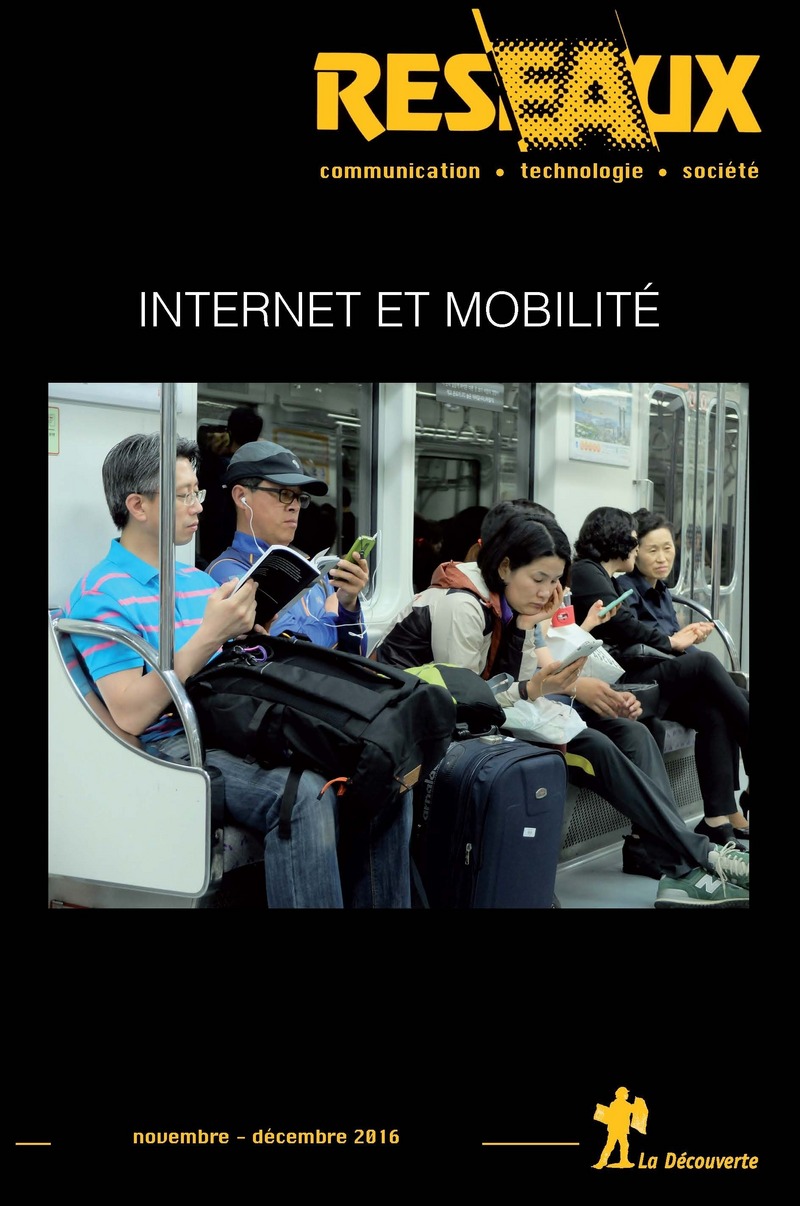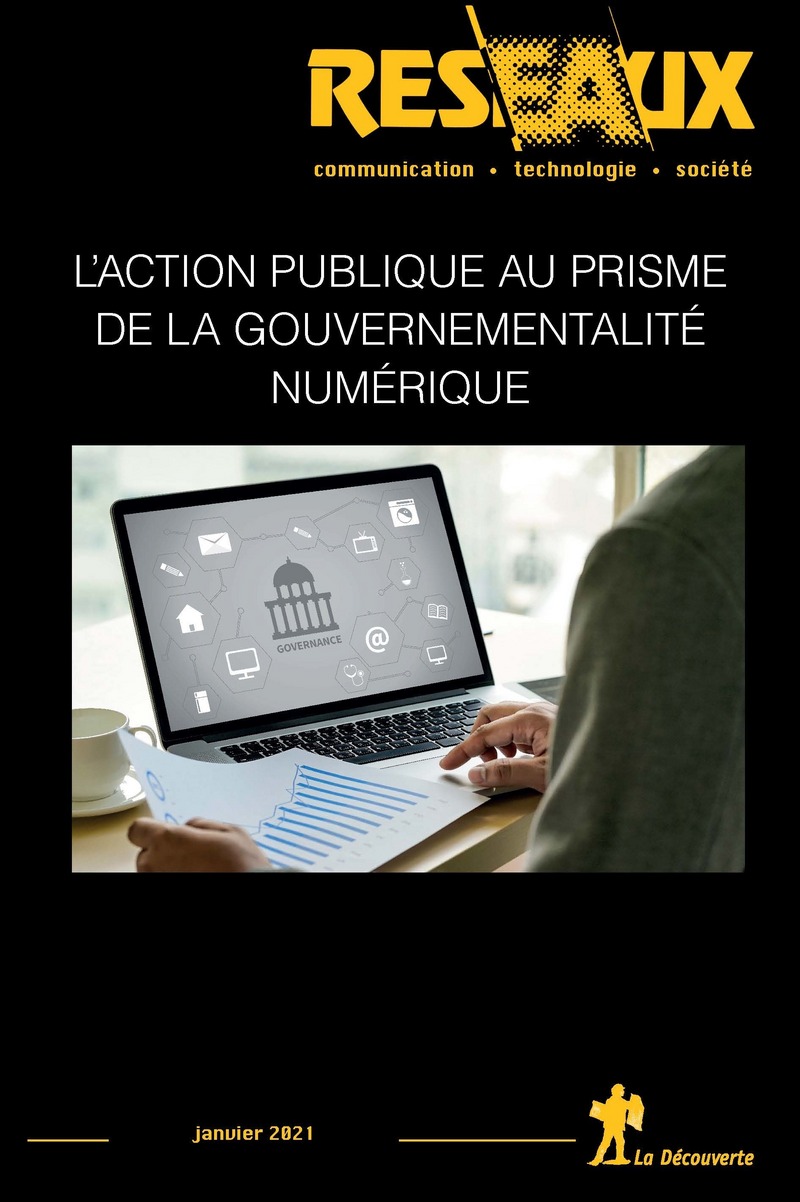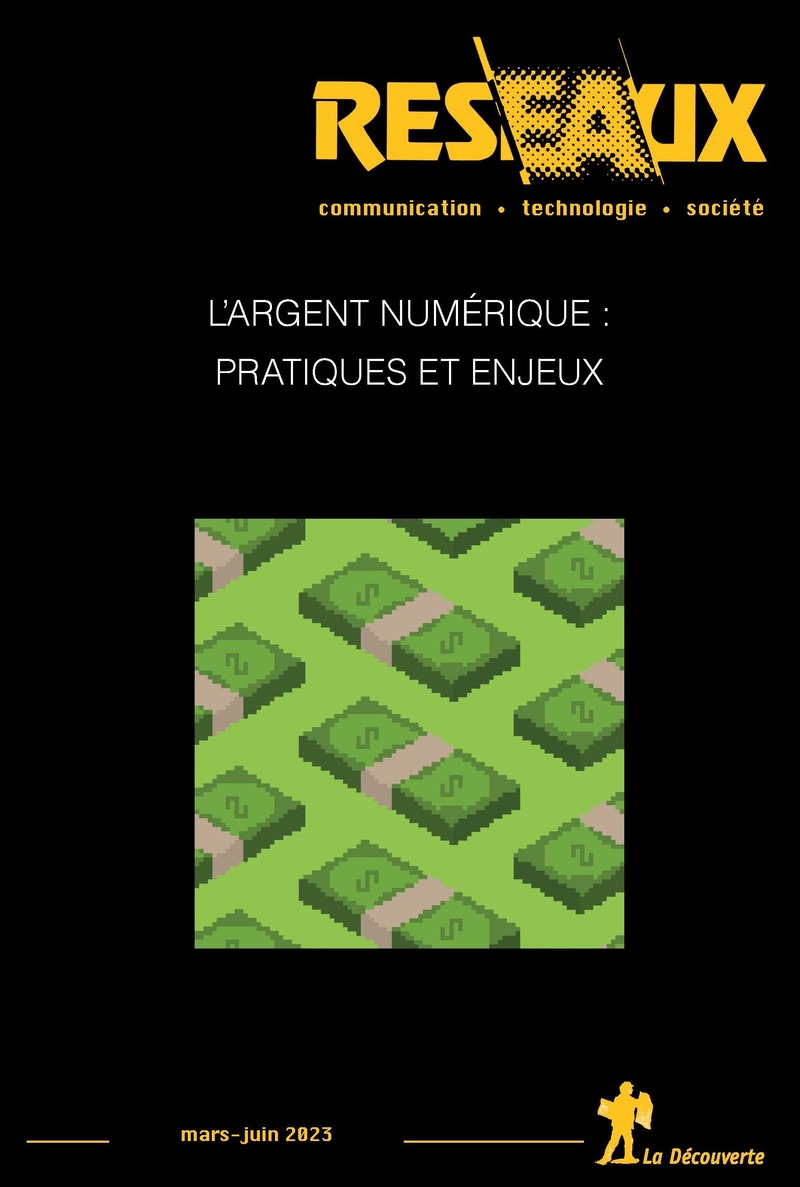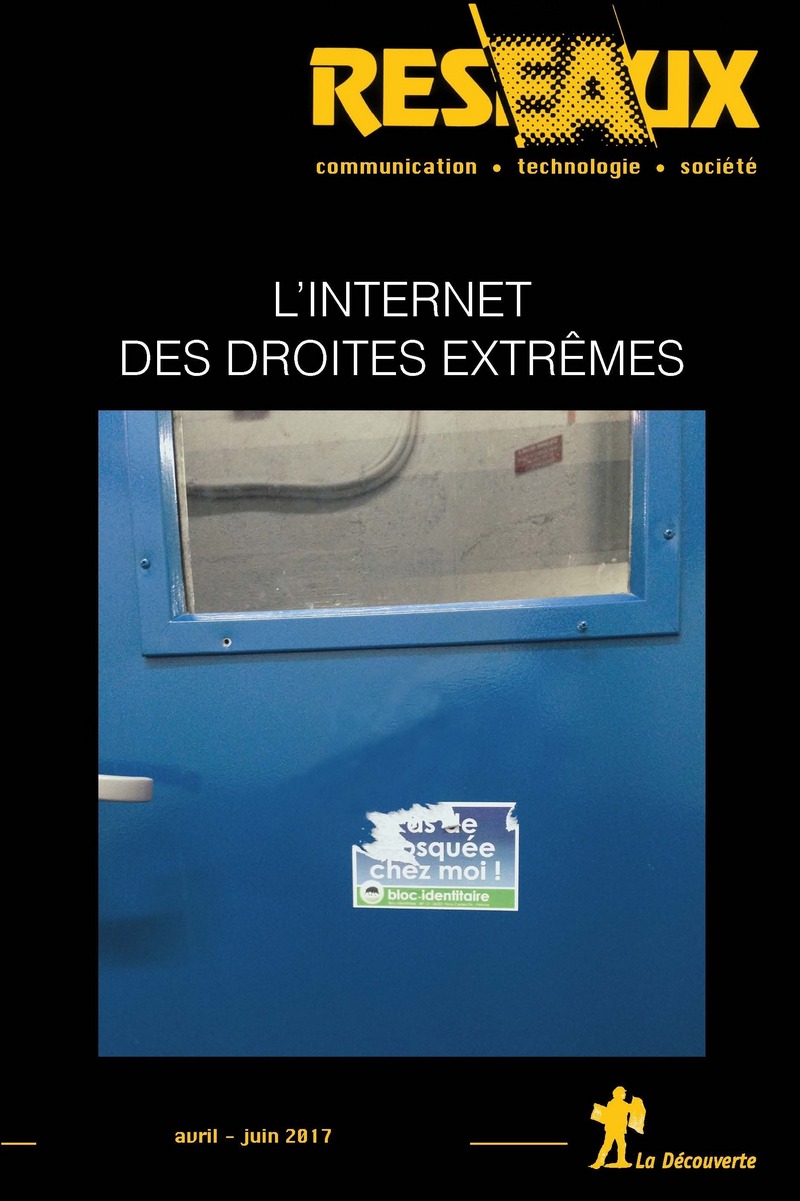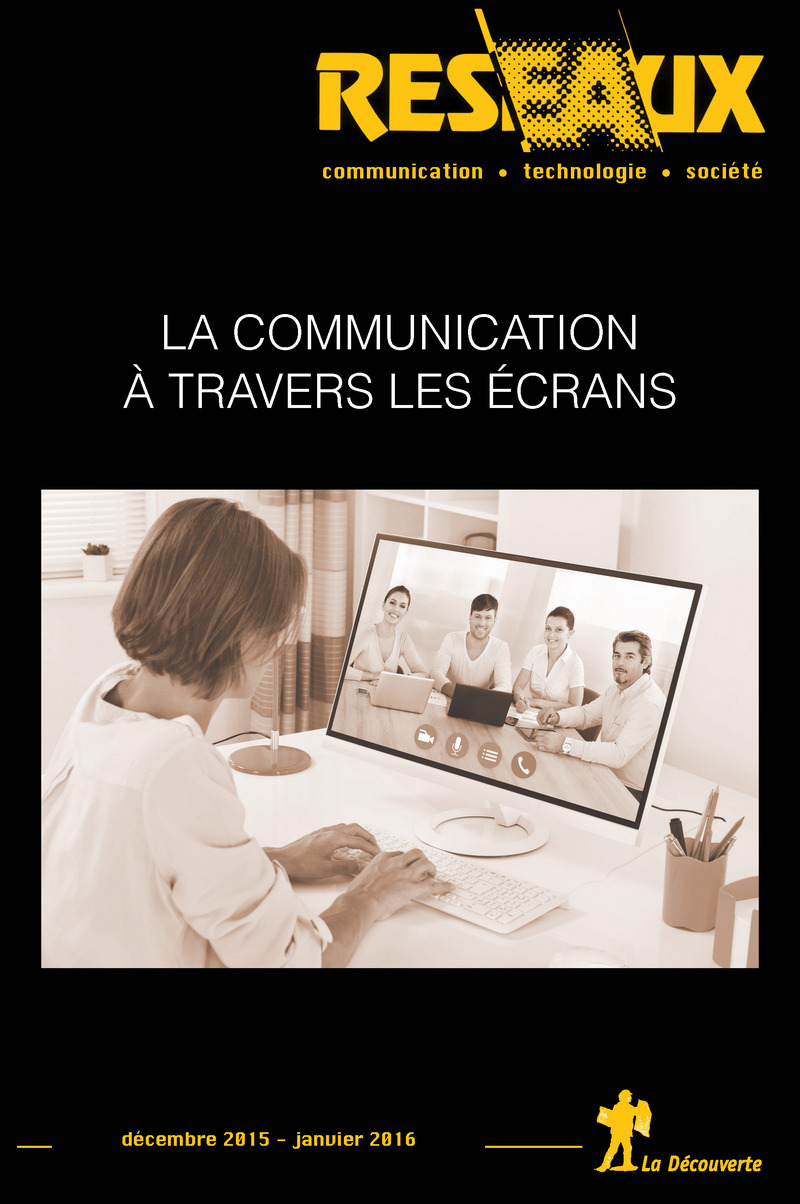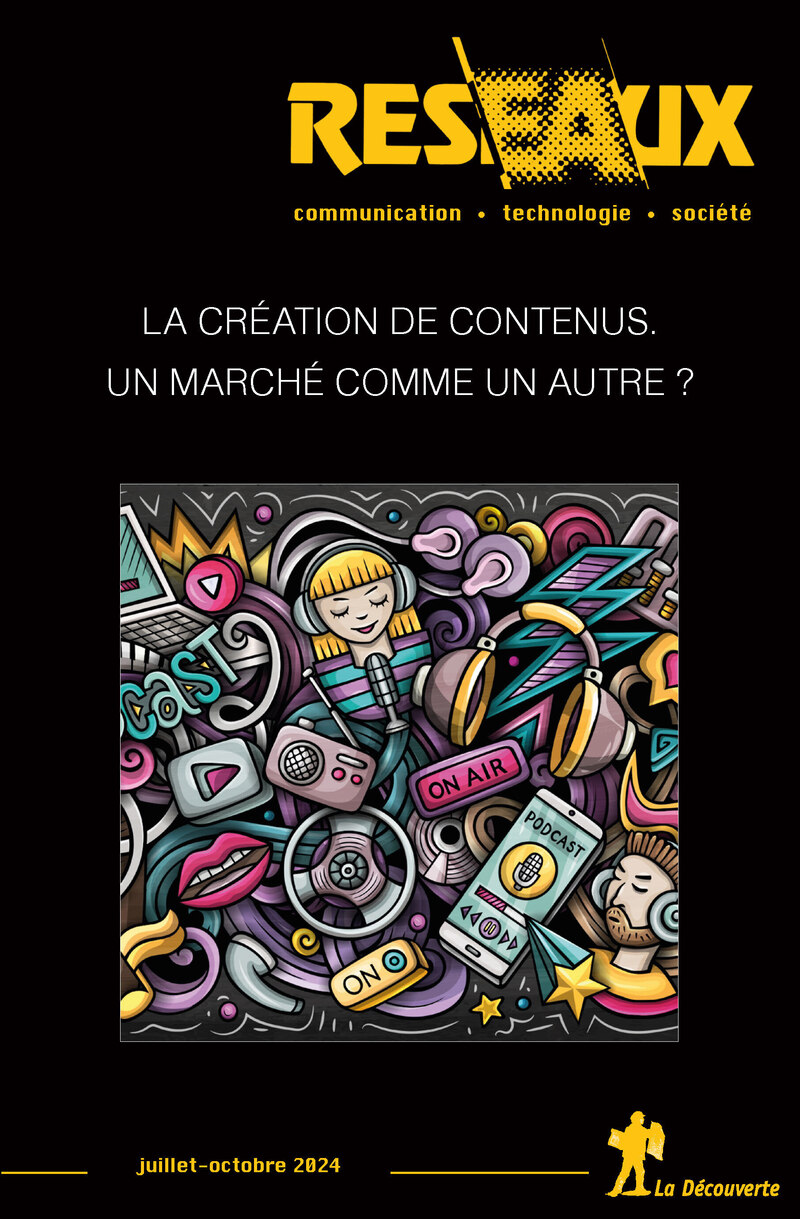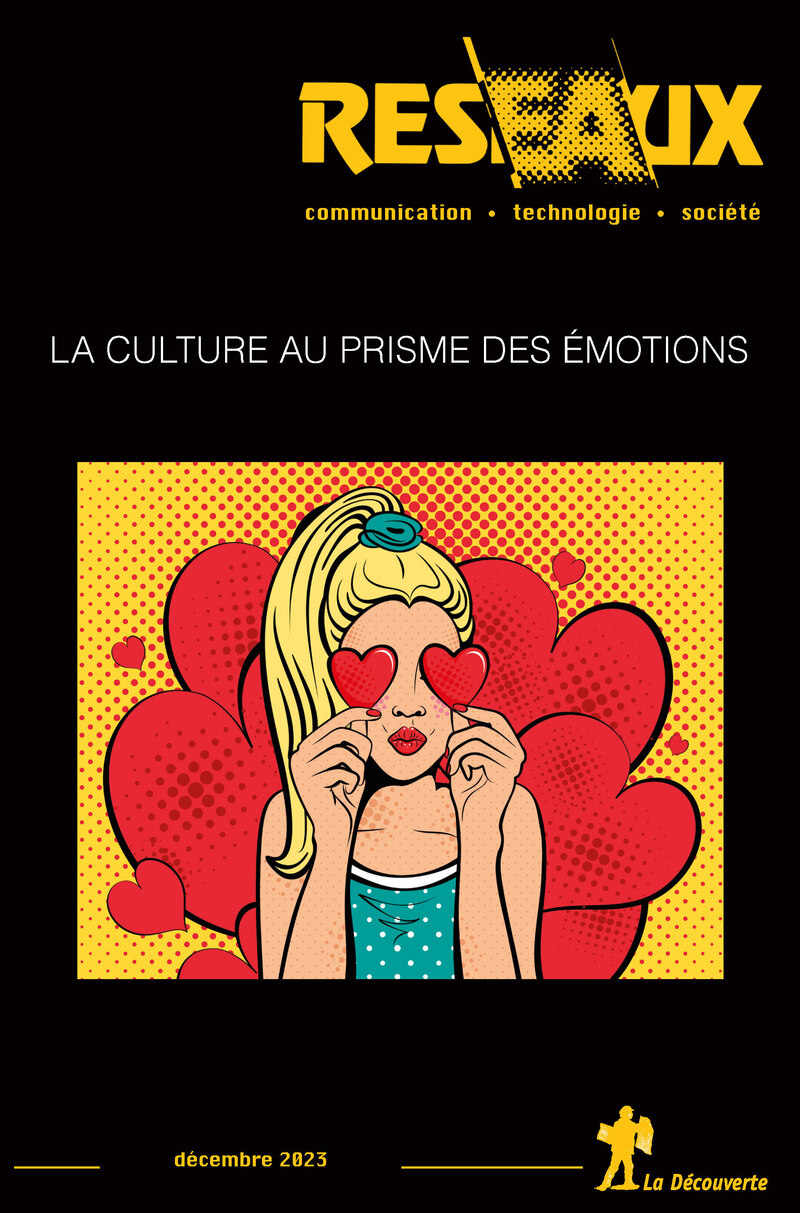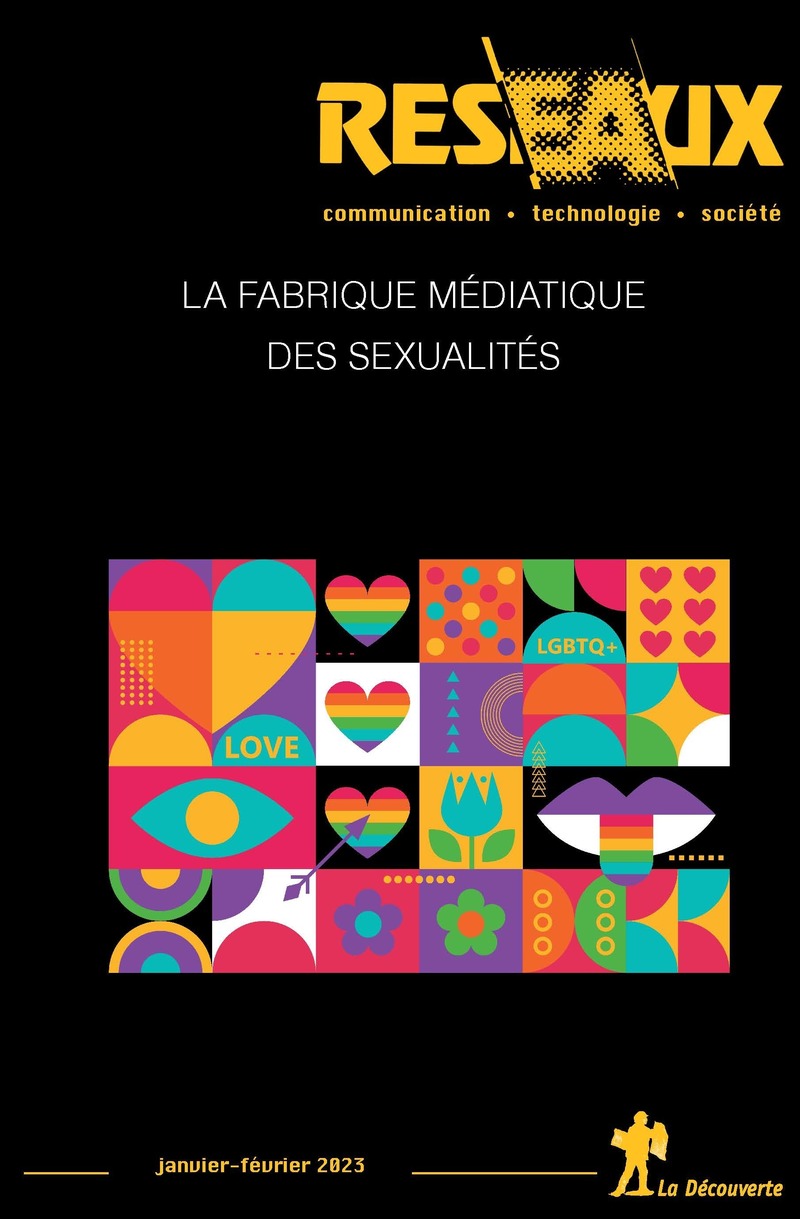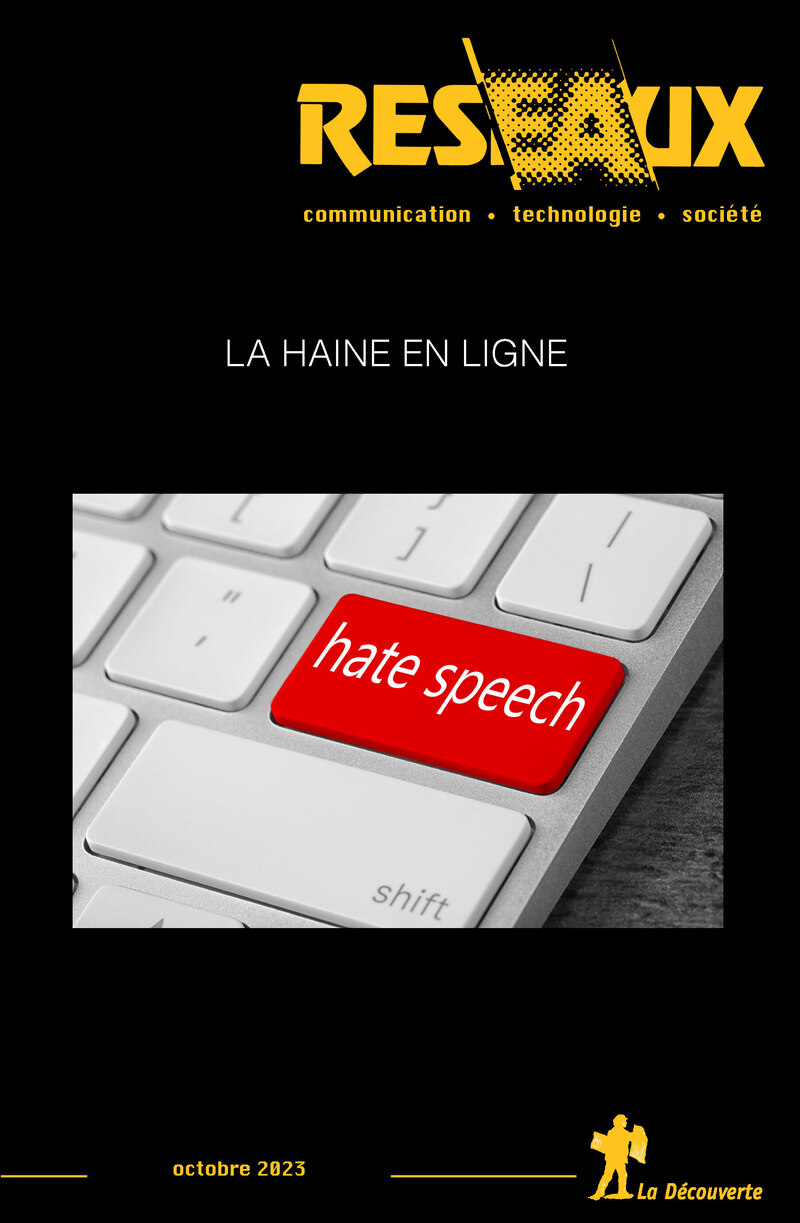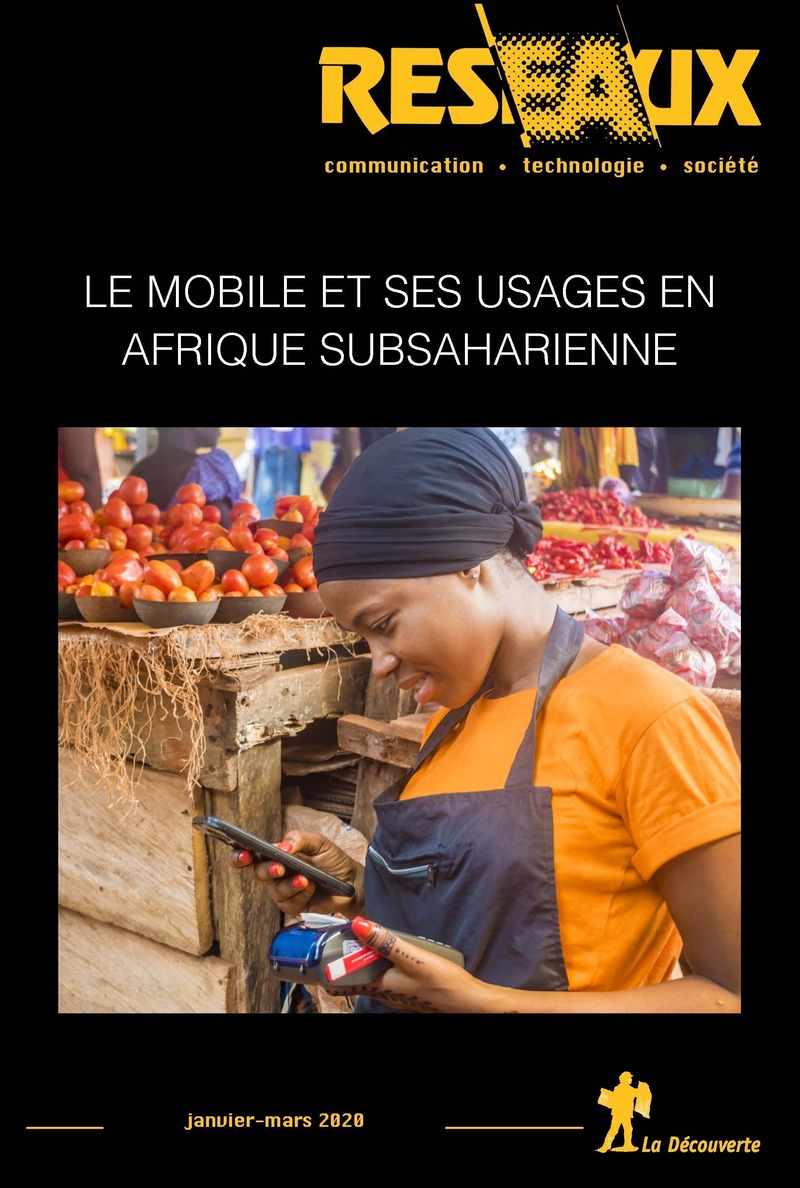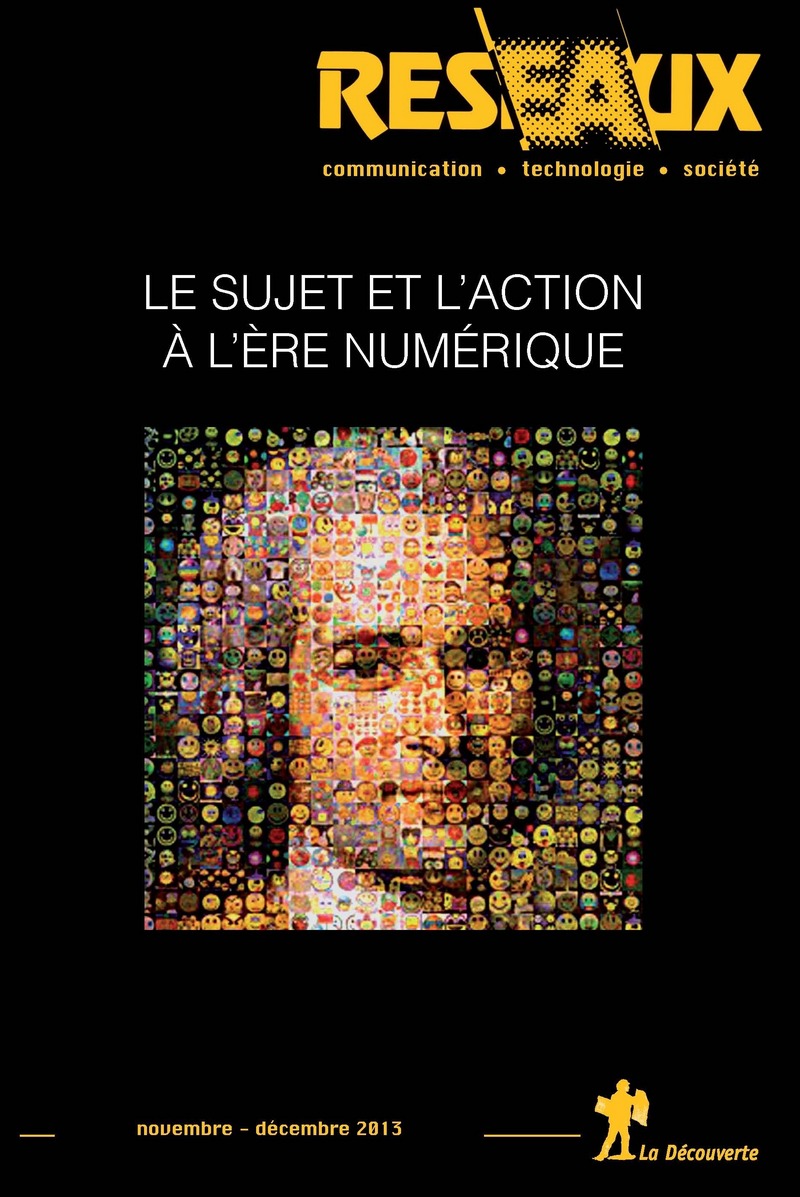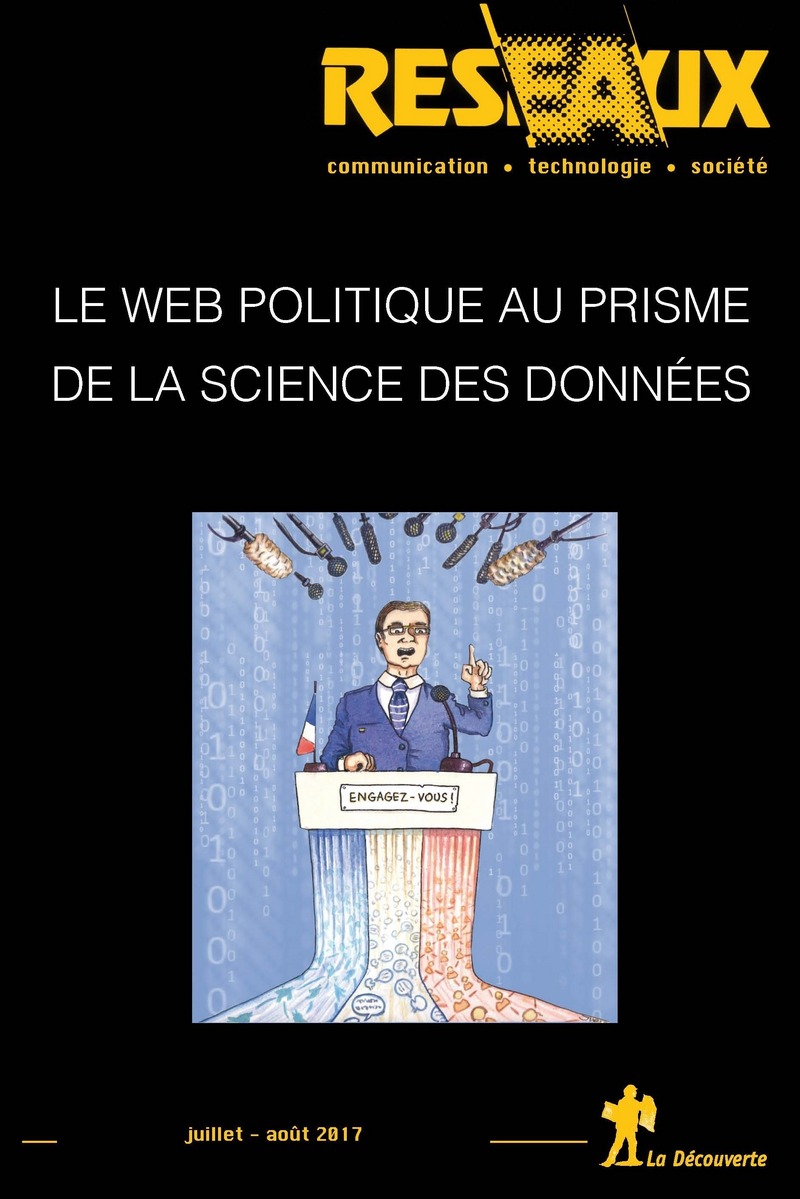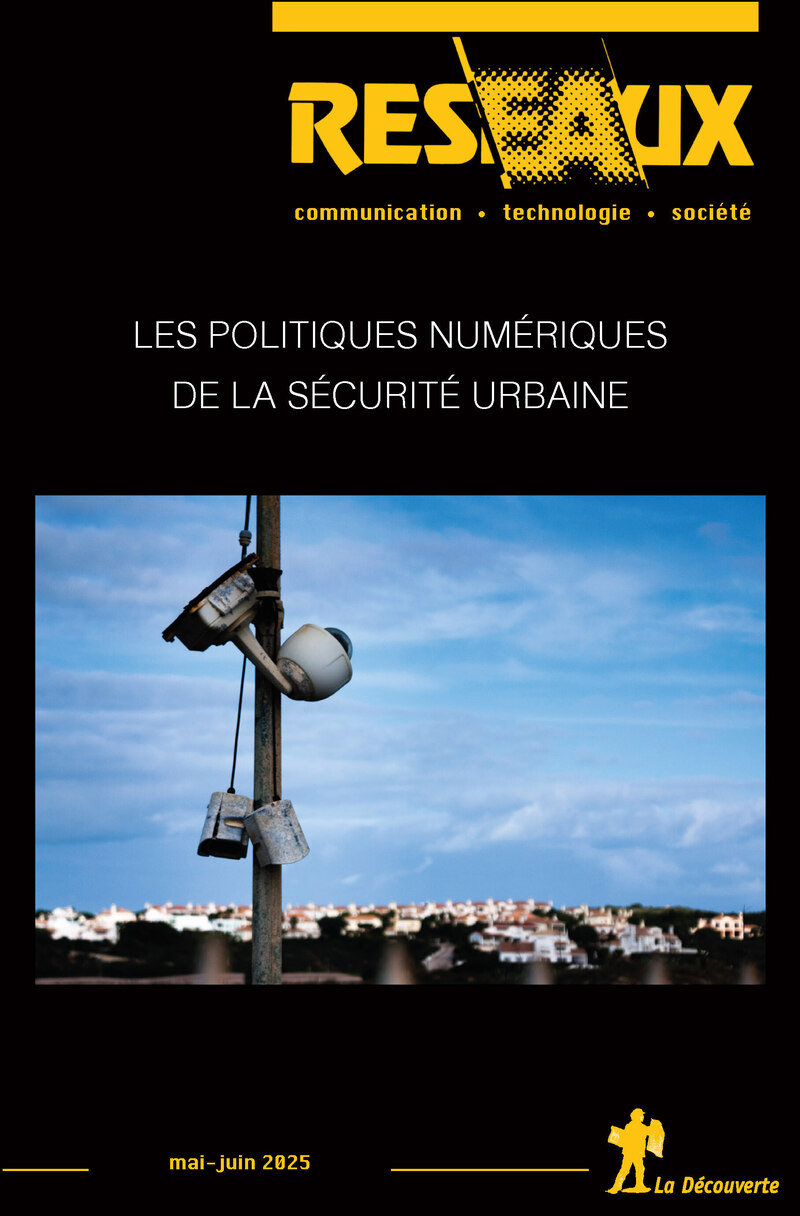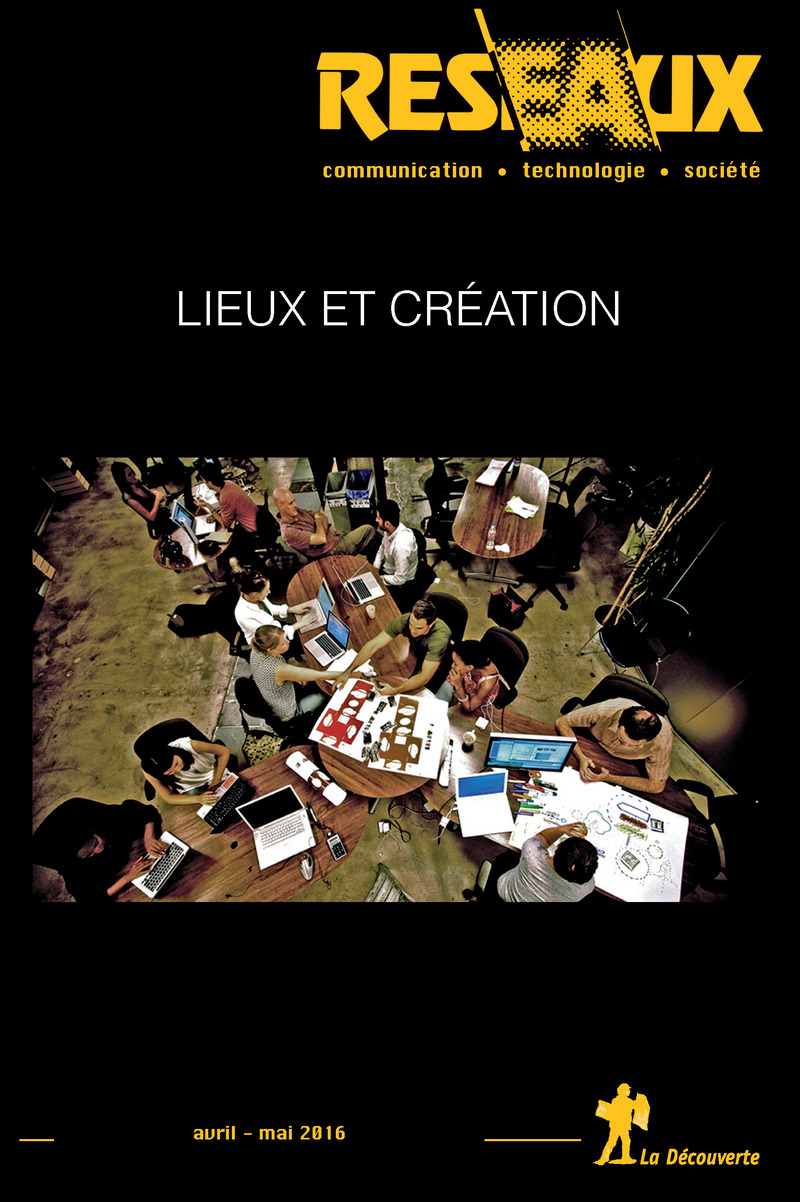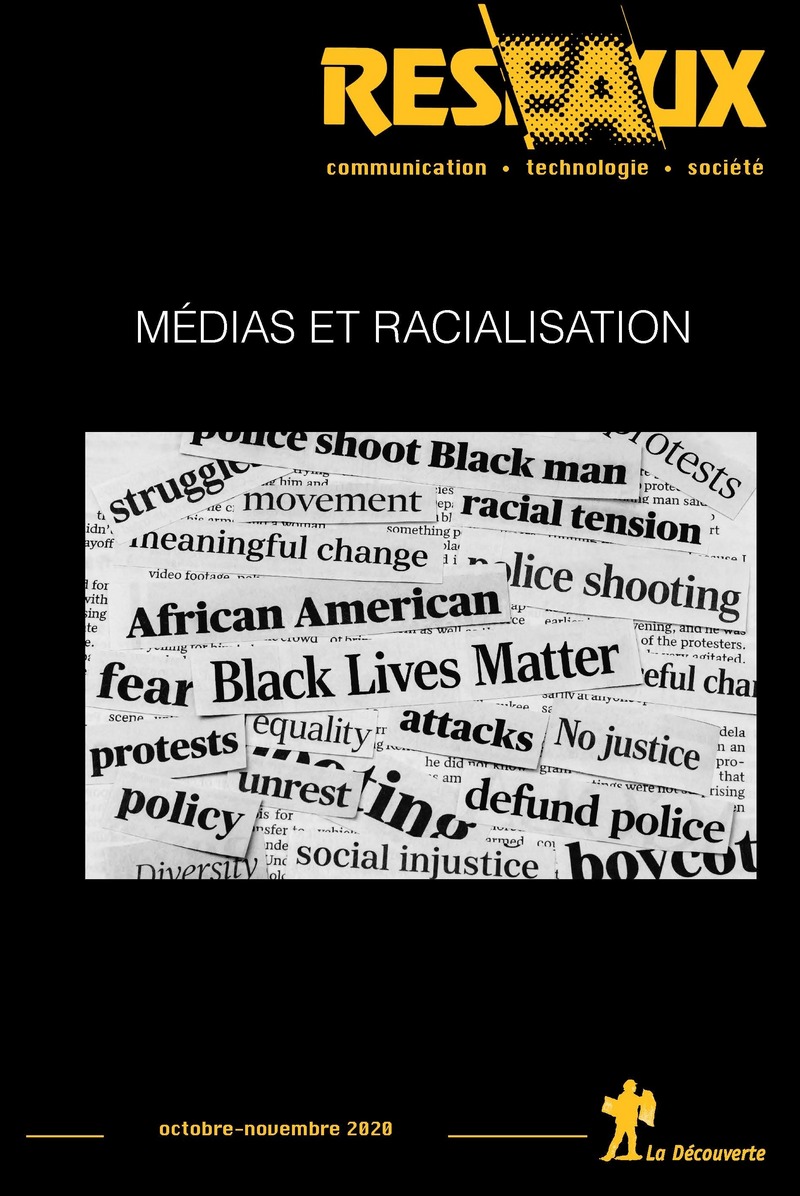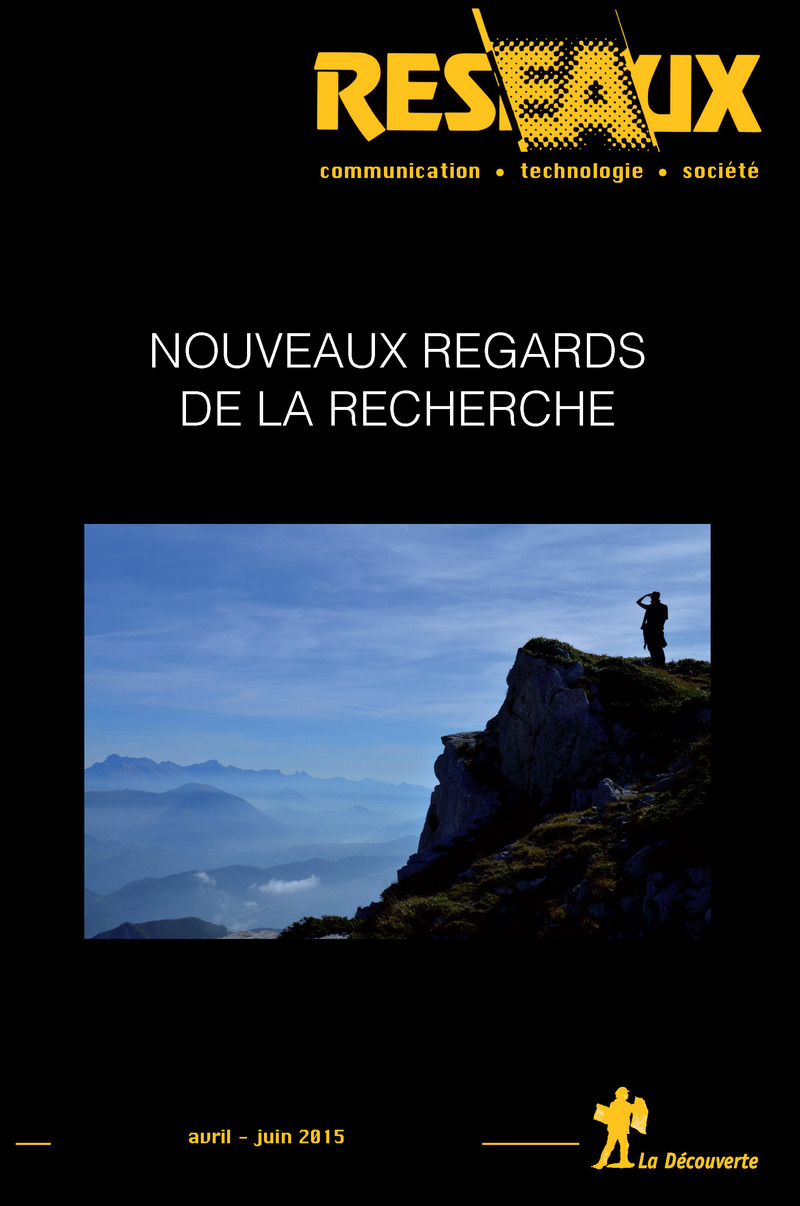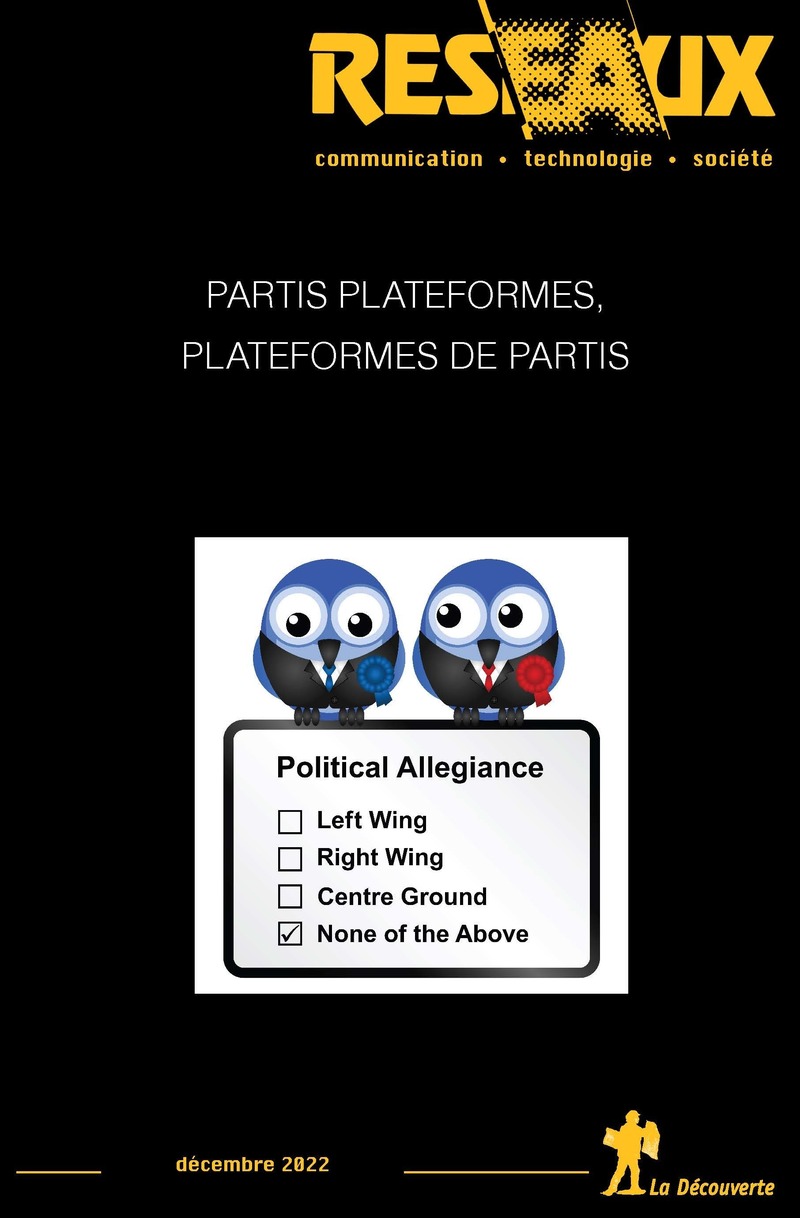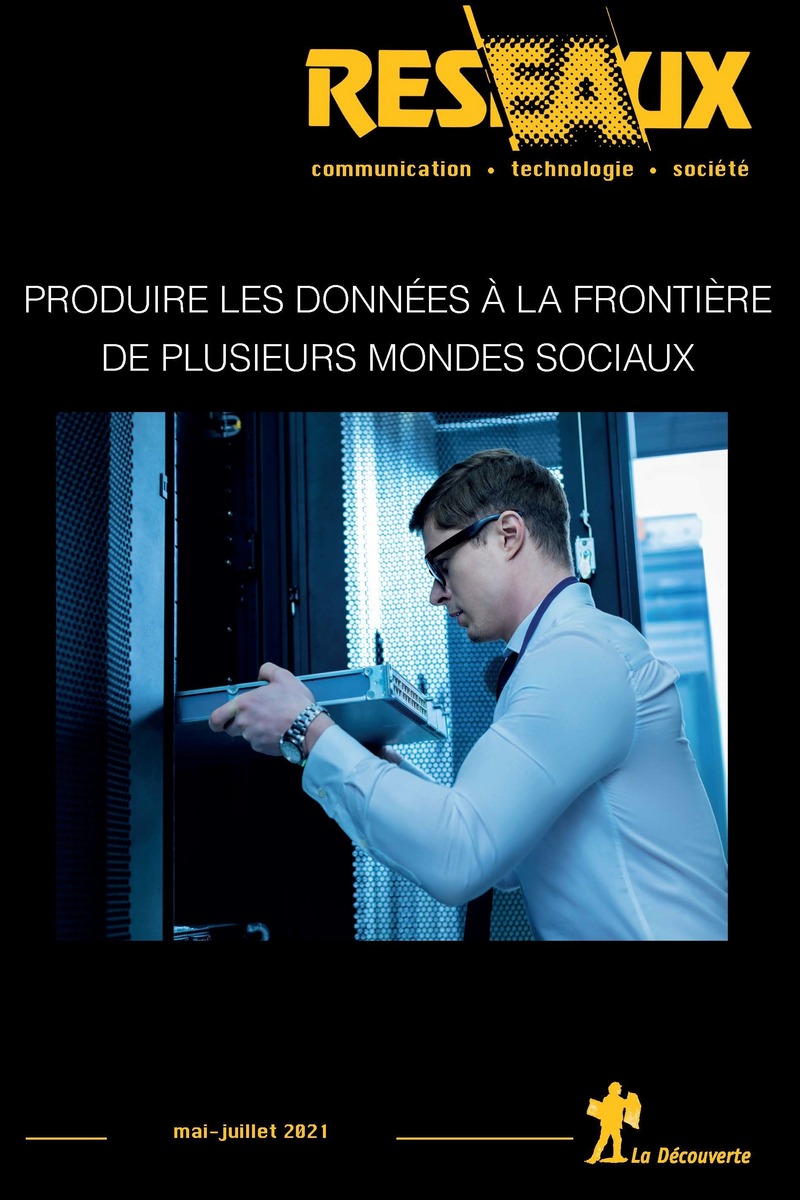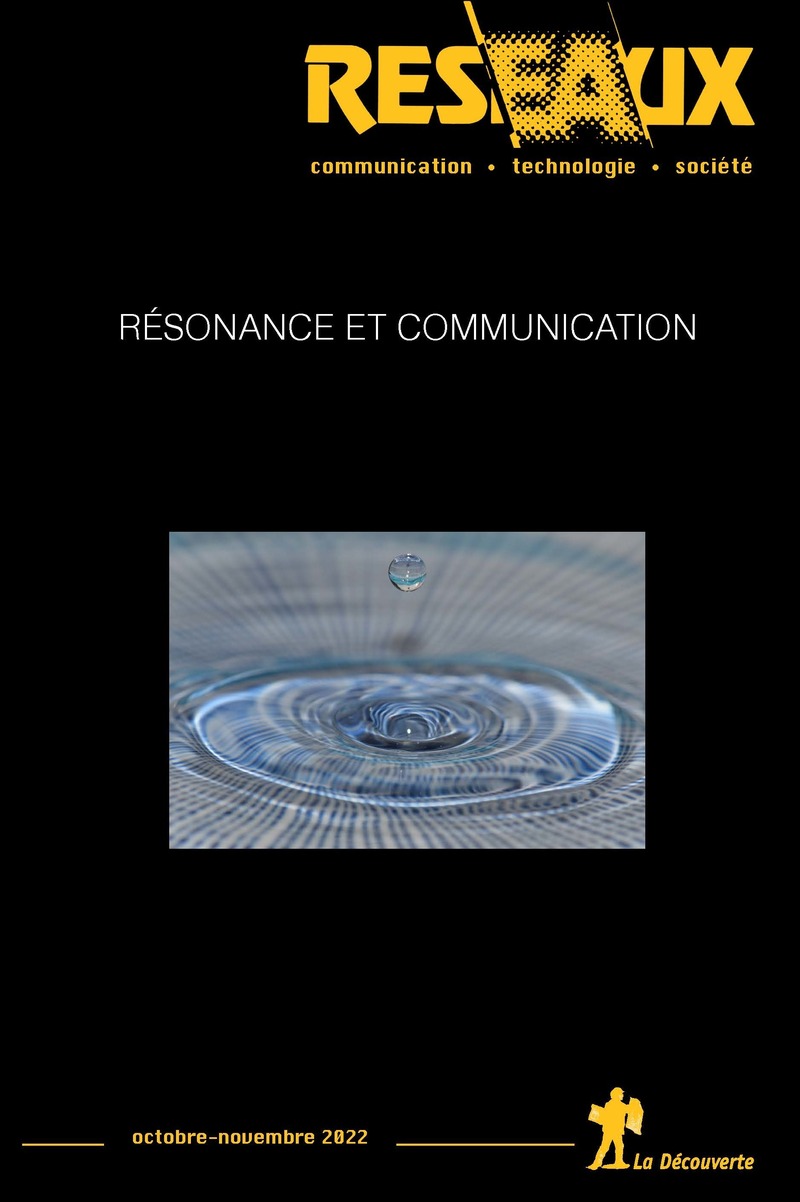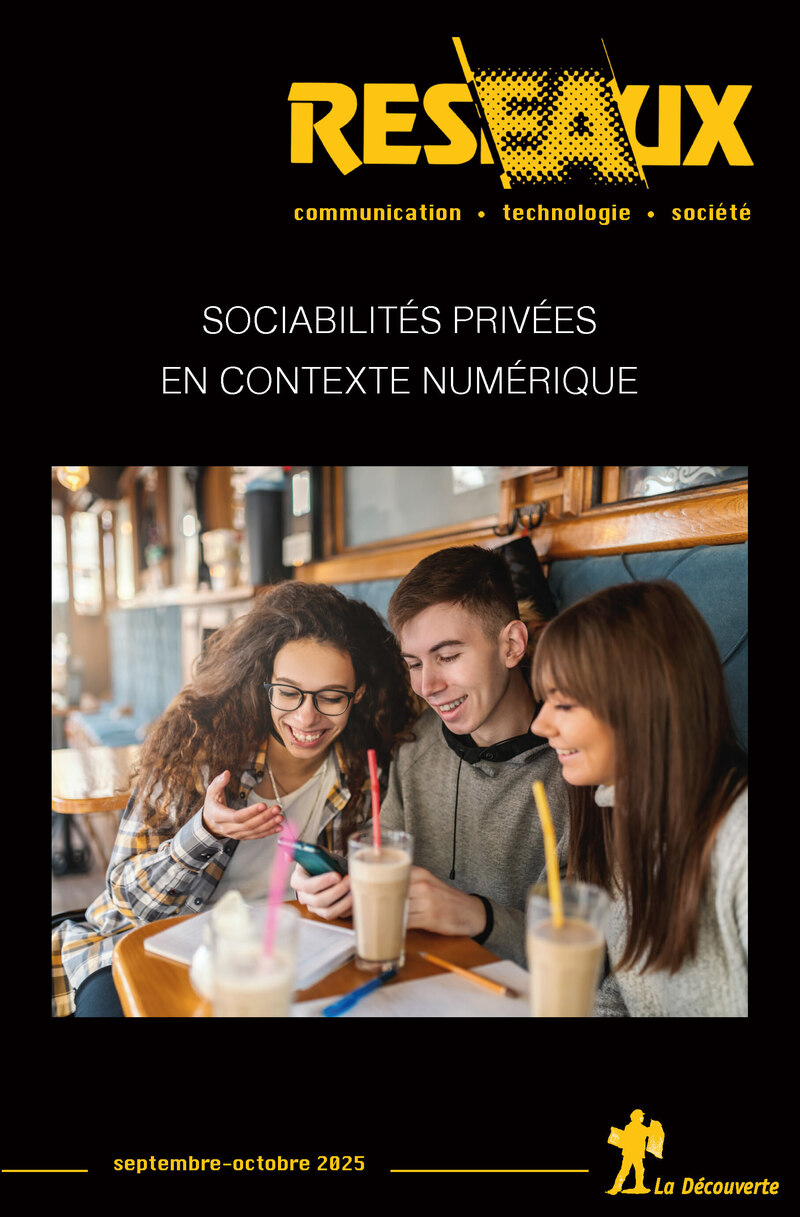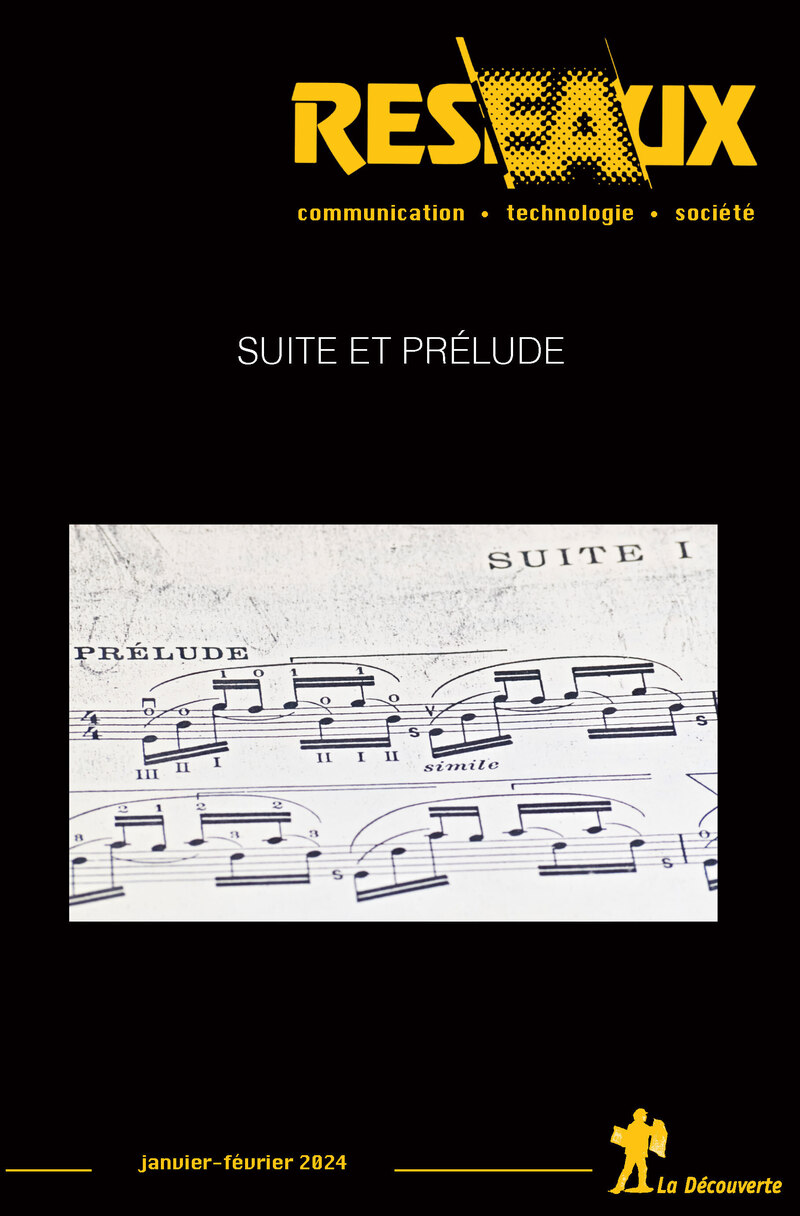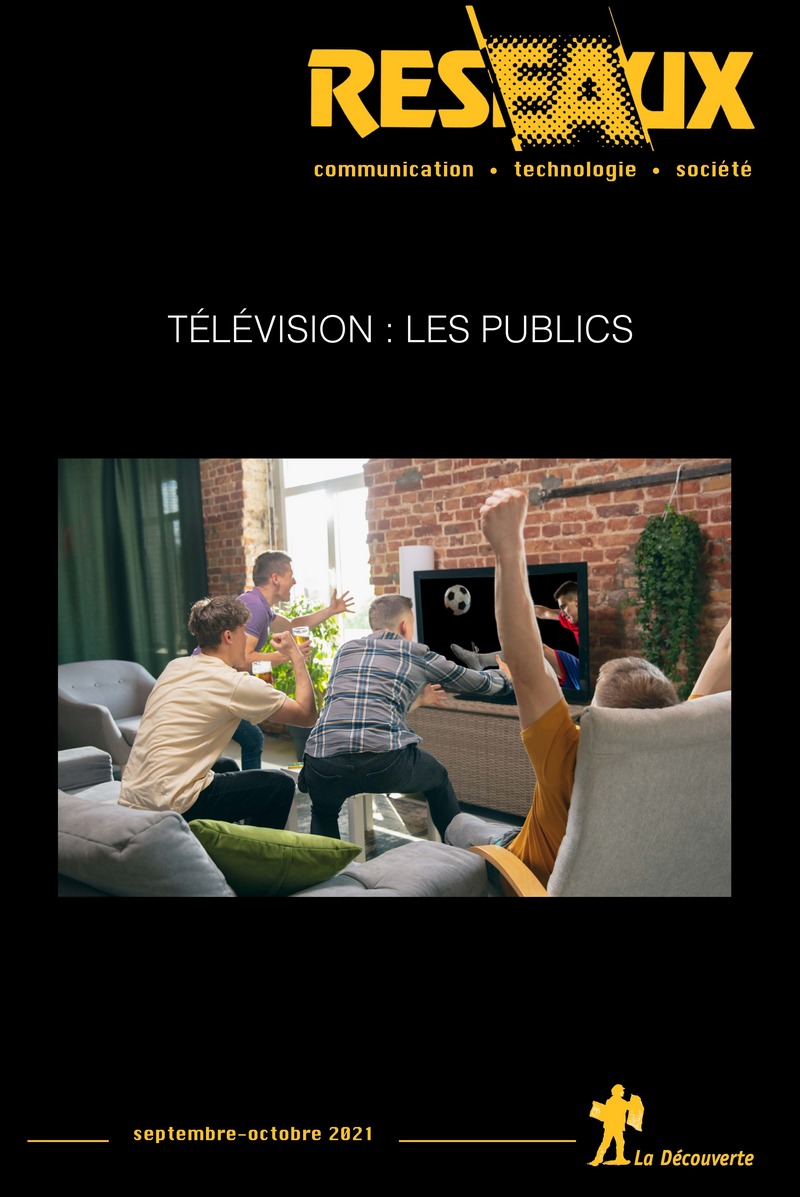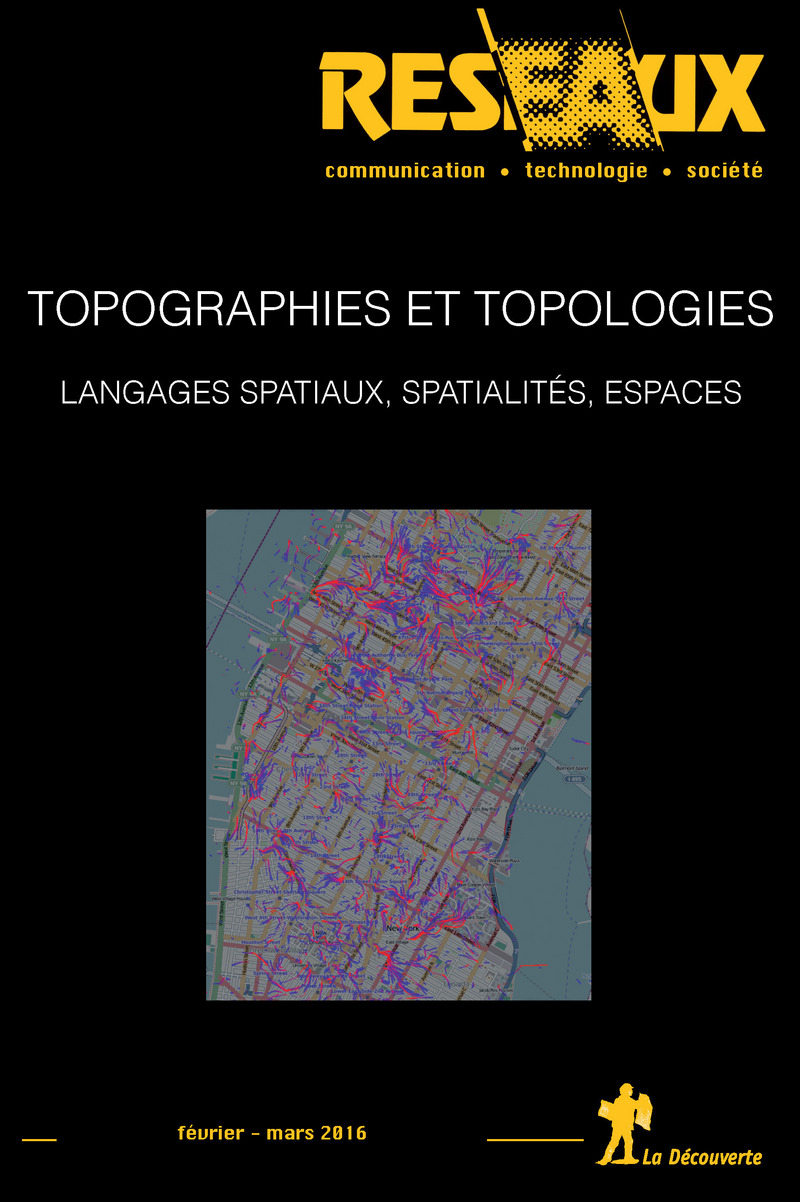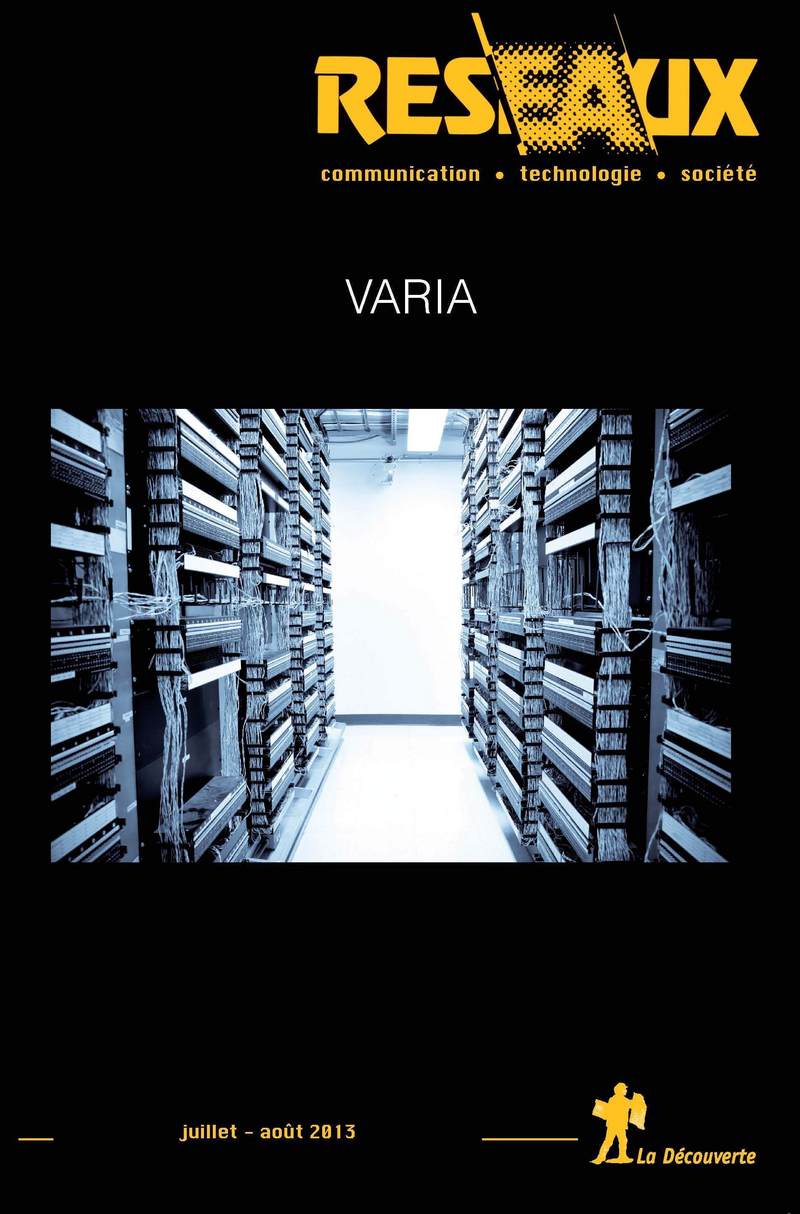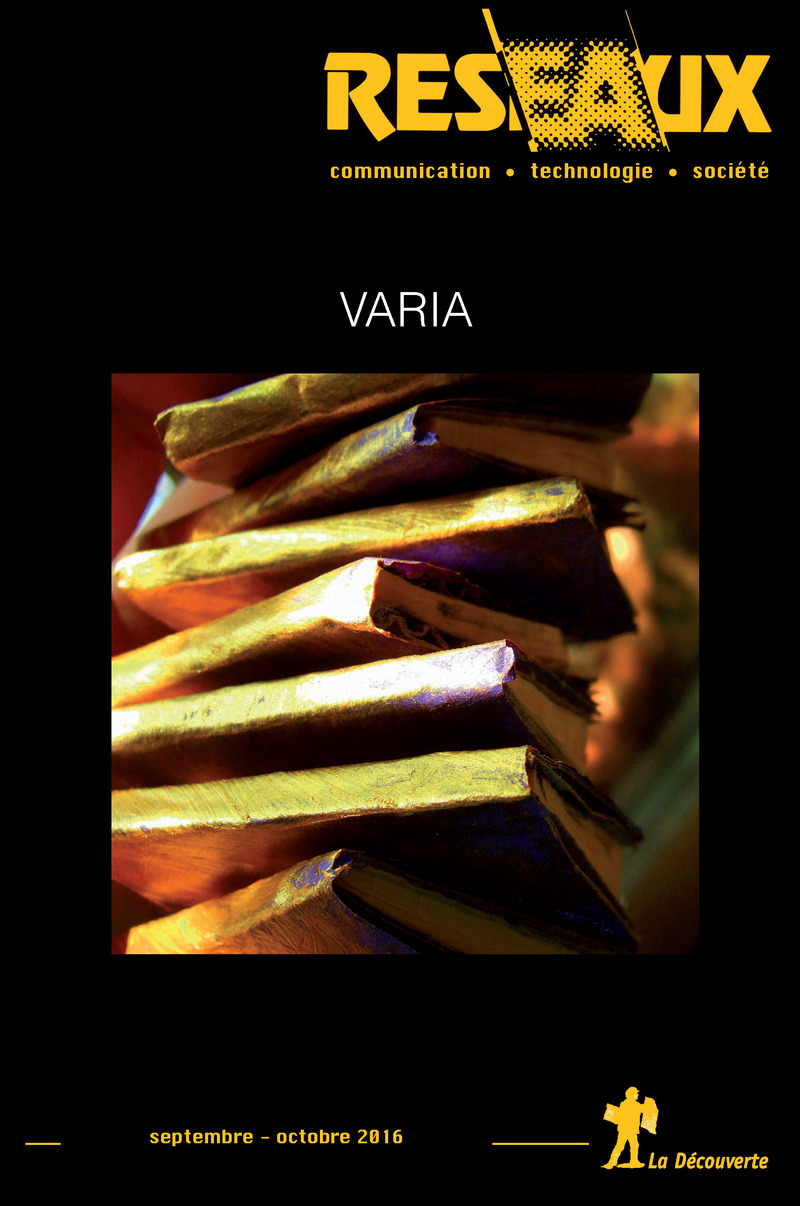Critiques numériques
Revue Réseaux
Techlash. Utilisé pour la première fois dans les pages de The Economist en 20131, le terme a bénéficié depuis lors d'un certain succès sous l'effet des critiques grandissantes émises à l'égard des grandes entreprises de la Silicon Valley et plus généralement des technologies numériques. La célébration des vertus démocratiques, des effets émancipateurs et des gains socio-économiques associés à internet dans les années 1990 et 2000 a cédé le pas à de nombreuses expressions de colère suscitées tour à tour par l'élection de Donald Trump, le Brexit, le scandale Cambridge Analytica, la fraude de Théranos, le management prédateur dénoncé par des employées de l'entreprise Uber, la mobilisation d'Amazon pour empêcher la syndicalisation au sein de ses entrepôts, les conditions de travail et l'incidence psychologique relative à la modération des contenus, les contrats passés par les " Big Tech " avec le Pentagone, l'utilisation des technologies dans la surveillance et la répression de mouvements contestataires dans les pays autoritaires, les biais relatifs aux classifications des moteurs de recherche et de la justice prédictive, le poids des réseaux sociaux dans les sociabilités adolescentes, ou encore la prise de conscience de l'impact environnemental et social d'une industrie qui s'est longtemps présentée comme immatérielle et progressiste. La pandémie de Covid-19, en accentuant la domination des grandes entreprises du numérique, aurait achevé le mouvement de bascule morale, séparant l'utopie internet des années 1990 de la dystopie numérique des années 2010.
Le propos de ce numéro s'inscrit dans cette perspective : proposer une analyse sociologique (sociologicisée) et historique (historicisée) des critiques. Sociologique tout d'abord, puisque les contributions de ce dossier visent à appréhender les critiques du numérique comme des objets à part entière. Il s'agit en cela, suivant la formule de L. Boltanski, d'opérer un glisse-ment d'une sociologie critique – du numérique – à une sociologie de la critique – du numérique (Boltanski, 1990). Historique ensuite, puisque les cas d'études proposés visent à relativiser et contrebalancer les récits dominants, pour faire entrevoir la manière dont la critique joue un rôle dans le développement du numérique. Il ne s'agit dès lors pas d'envisager une histoire, mais des histoires de la critique du numérique.

Nb de pages : 292
Dimensions : 16 * 24 cm
 Revue Réseaux
Revue Réseaux

La revue Réseaux. Communication - Technologie - Société, créée en 1982 par Patrice Flichy et Paul Beaud, s'intéresse à l'ensemble du champ de la communication en s'axant tout particulièrement sur les télécommunications. Les mass-médias et l'informatique sont également abordés. La télévision a notamment constitué le thème d'un nombre important de numéros. La réflexion sur la communication étant à l'origine de nombreux débats au sein des sciences sociales, des numéros sont aussi consacrés à des questions d'ordre théorique ou méthodologique. Bien qu'orienté plutôt vers la sociologie, Réseaux souhaite traiter les problèmes de la communication de façon pluridisciplinaire.
Pour s'abonner à la revue, rendez-vous sur le site Cairn.info
Table des matières 

Les auteurs
Présentation
Une sociohistoire des critiques numériques,
par Olivier Alexandre, Jean-Samuel Beuscart et Sébastien Broca
Dossier
Critiques numériques
Mouvement syndical et critique écologique des industries numériques dans la Silicon Valley,
par Christophe Lécuyer
Des luttes éthiques aux luttes sociales. Les mouvements de contestation critique des salariés des GAFAM (2015-2021) aux États-Unis,
par Isabelle Berrebi-Hoffmann et Quentin Chapus
La critique du numérique par les " travailleurs du milieu ". Identité collective et mobilisation par projet au sein de la communauté " Onestla.tech ",
par Clément Mabi et Irénée Régnauld
Penser le sabotage à l'ère du capitalisme numérique,
par Samuel Lamoureux
Le capitalisme numérique comme système-monde. Éléments pour une métacritique,
par Sébastien Broca
Varia
La justification des pratiques de co-création sur les plateformes de crowdsourcing,
par Damien Renard
La proximité à distance. Comment les agri-youtubeurs communiquent sur leurs pratiques,
par Louis Rénier, Aurélie Cardona, Frédéric Goulet et Guillaume Ollivier
Notes de lecture
Fred TURNER,
L'usage de l'art. De Burning Man à Facebook, art, technologie et management dans la Silicon Valley, Caen, C&F Éditions, 2020, 144 p. Par Pascal Froissart
Angèle CHRISTIN,
Metrics at Work. Journalism and the Contested Meaning of Algorithms, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2020, 272 p. Par Valentina Grossi
Jean Paul FOURMENTRAUX, antiDATA -
La désobéissance numérique – Art et hacktivisme technocritique, Dijon, Les Presses du réel, coll. " Perceptions ", 2020, 232 p. Par Fardin Mortazavi
Dominique BOULLIER,
Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux, Paris, Le Passeur, 2020, 304 p. Par Alain Busson
Résumés/Abstracts.