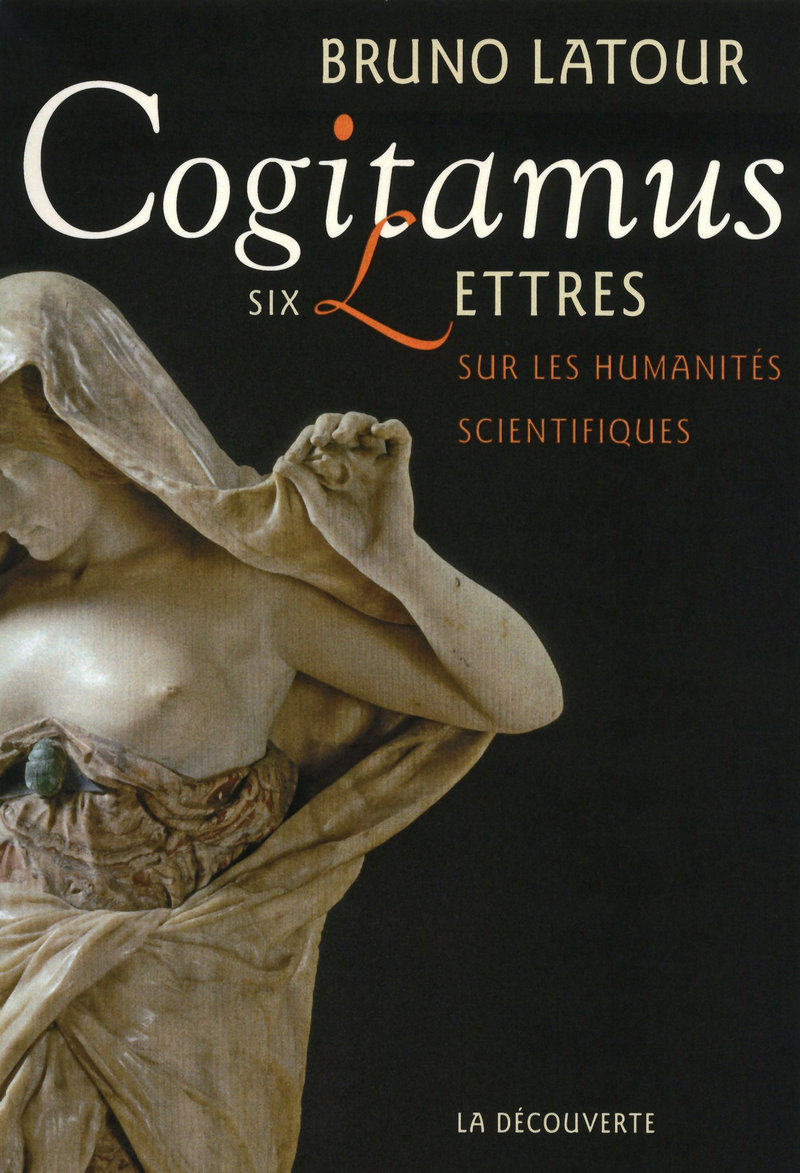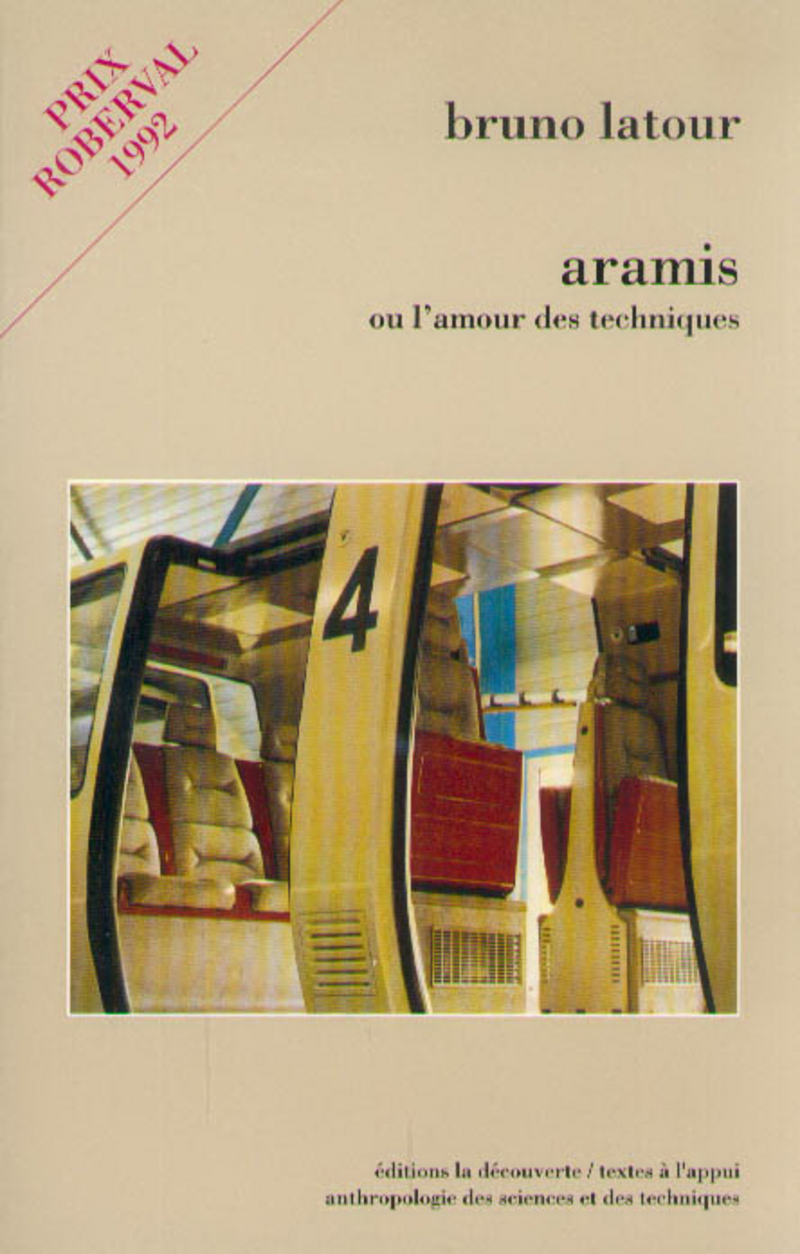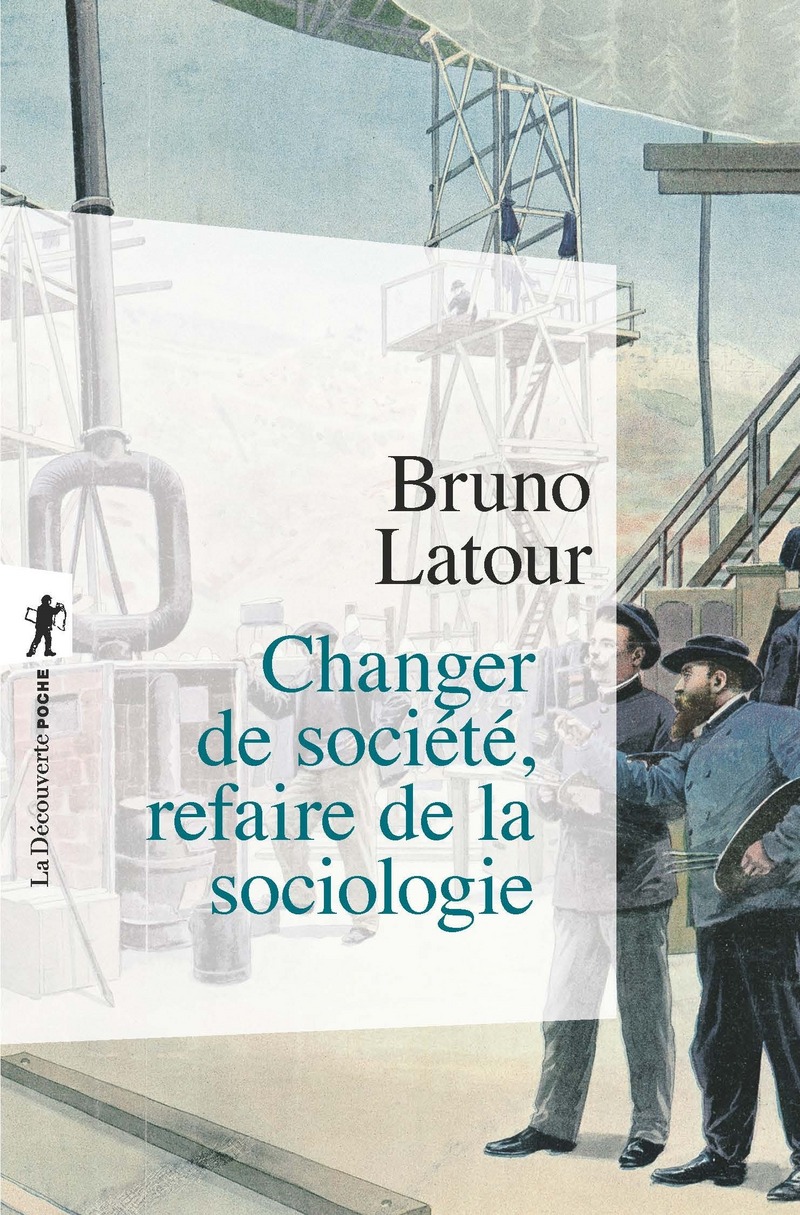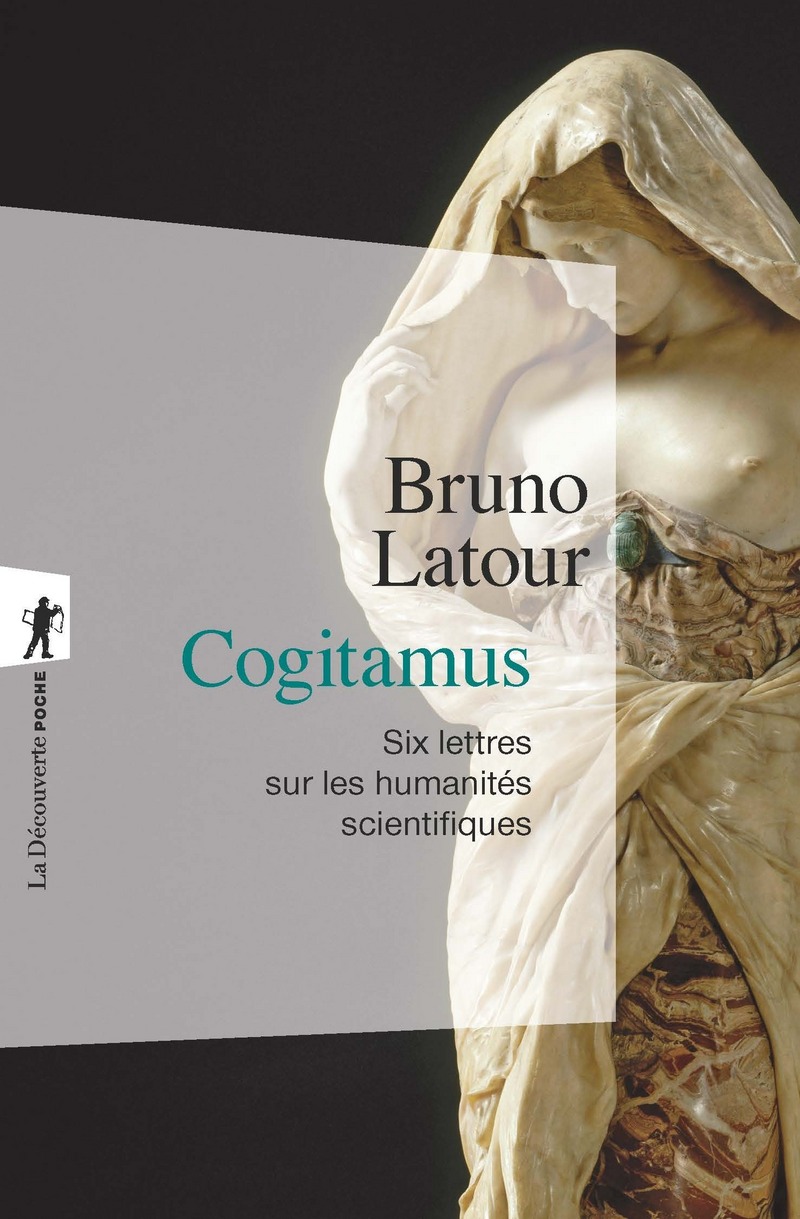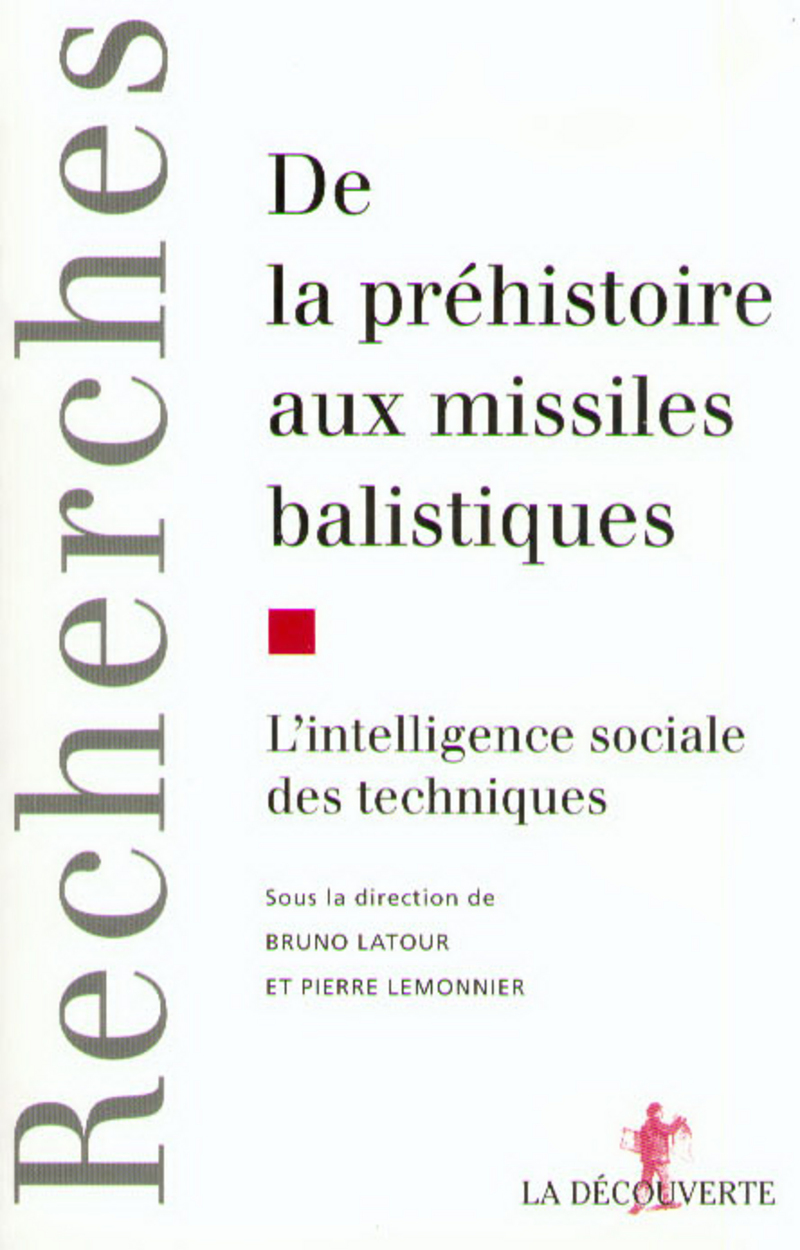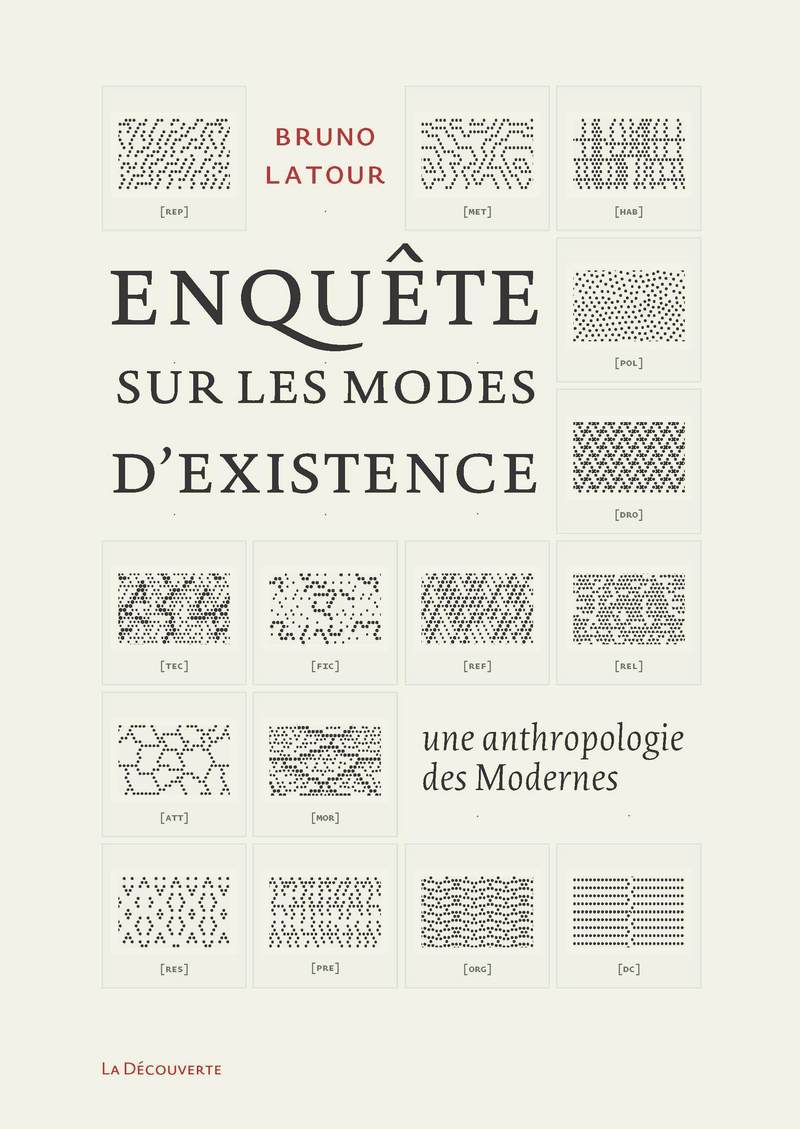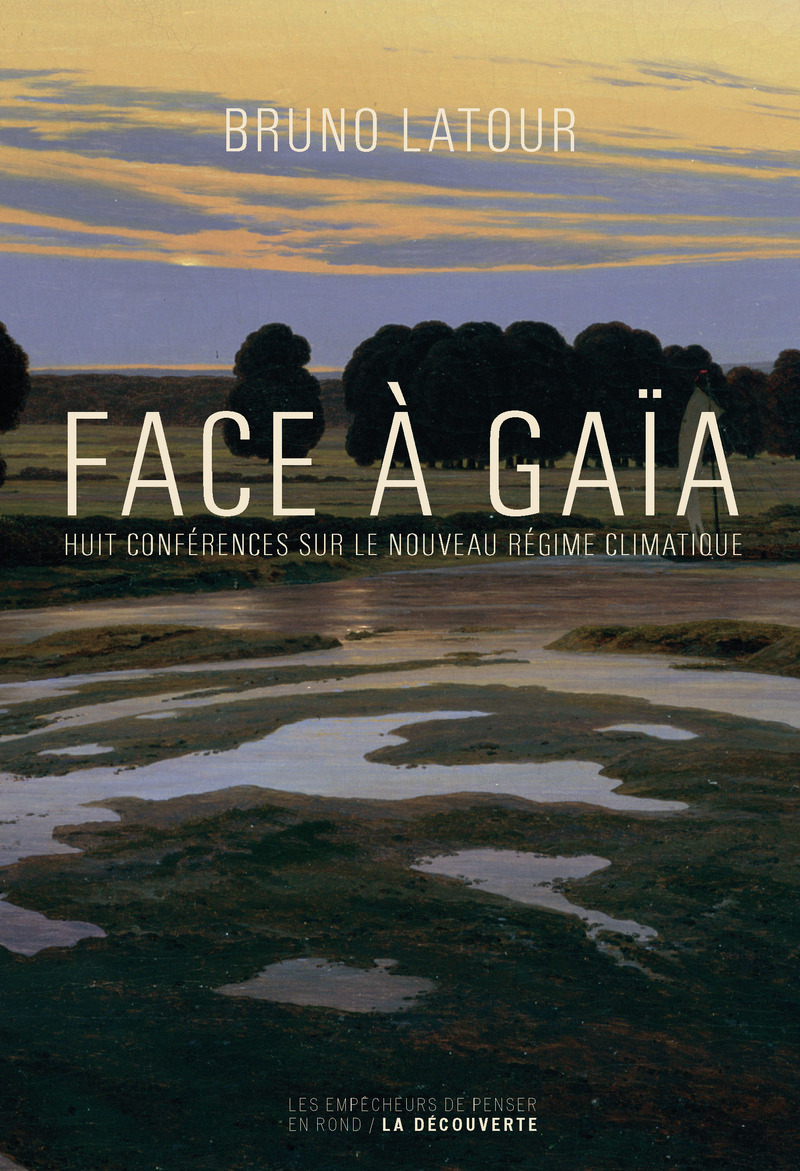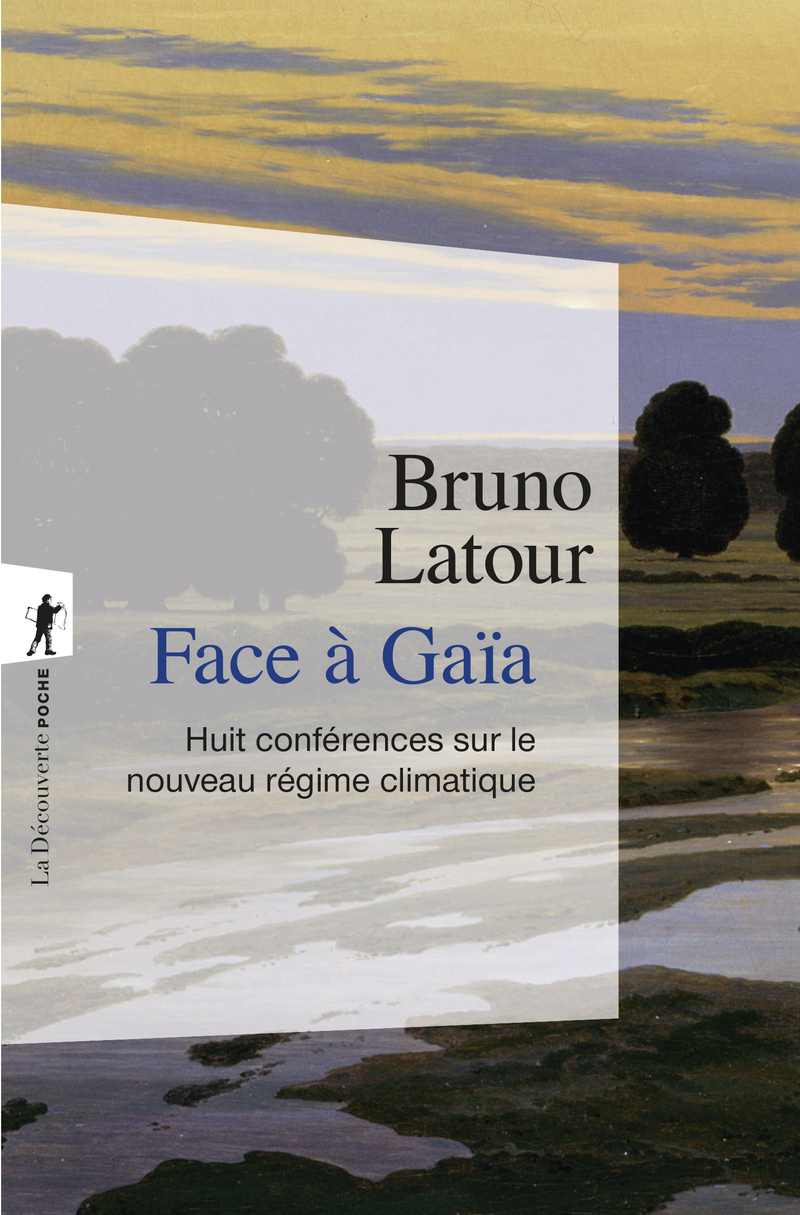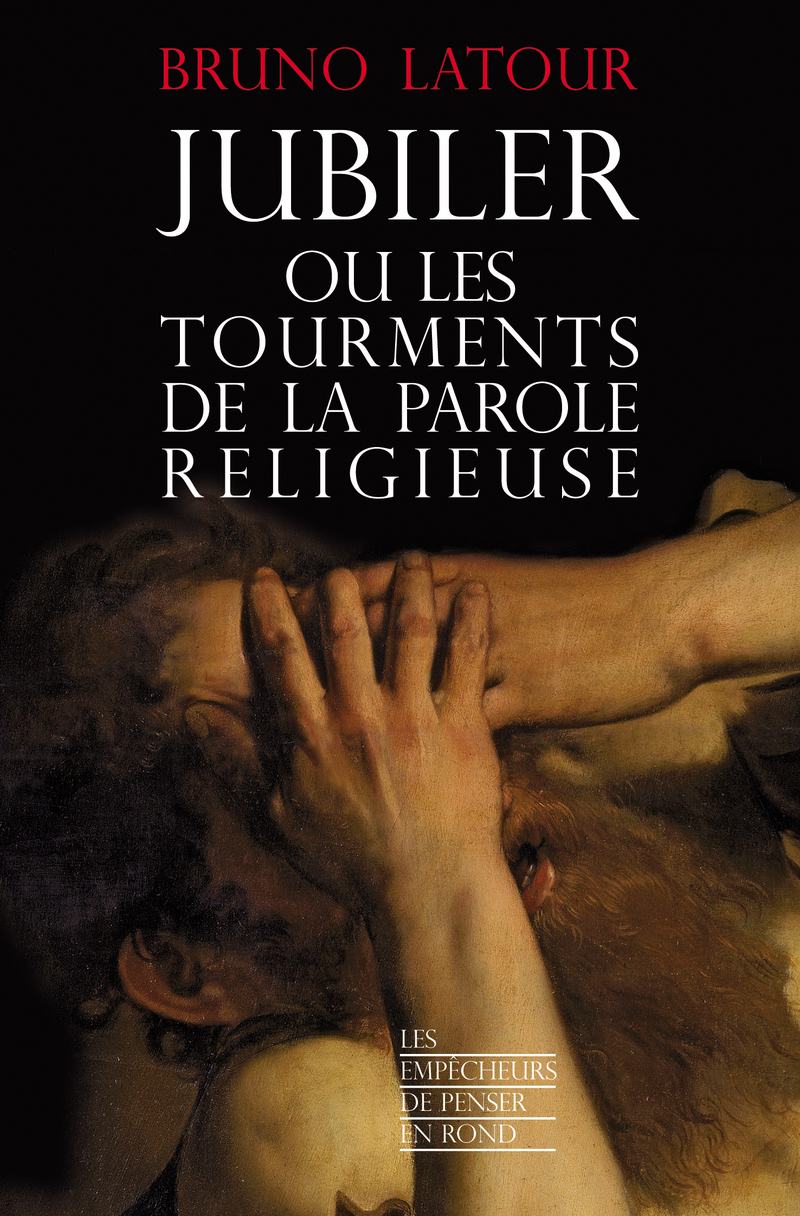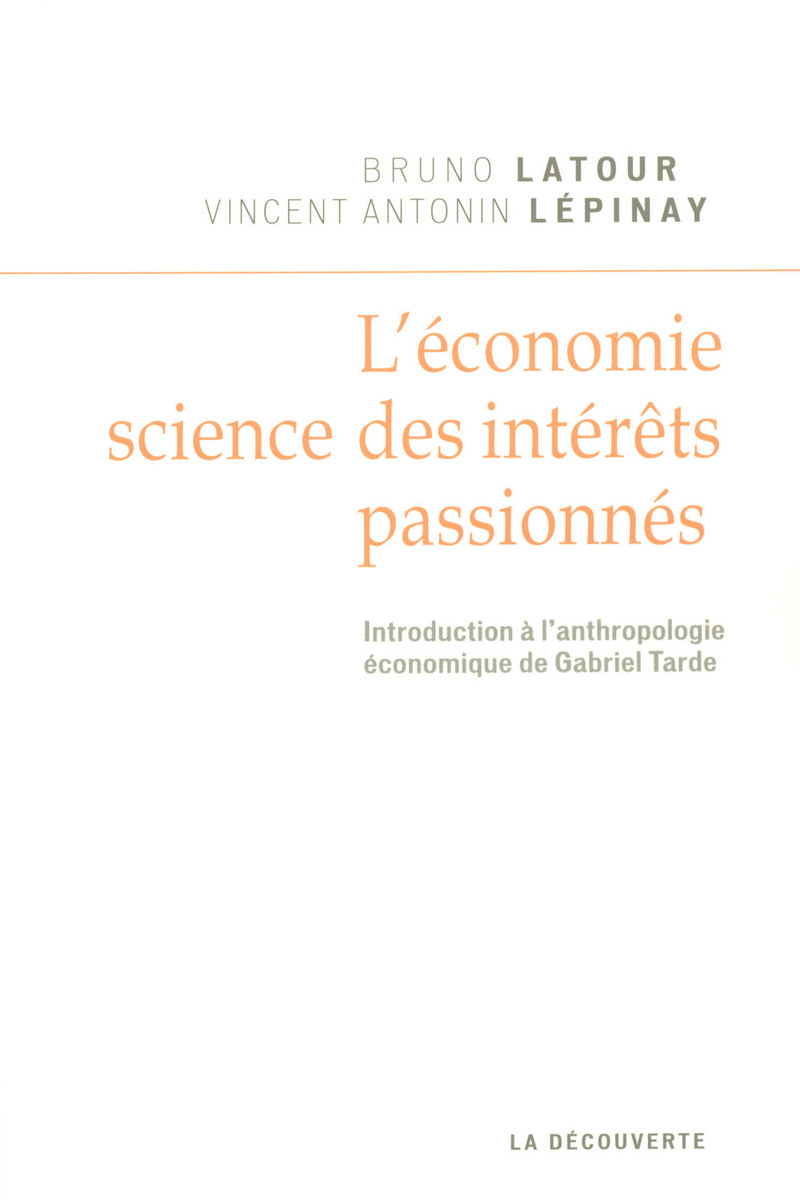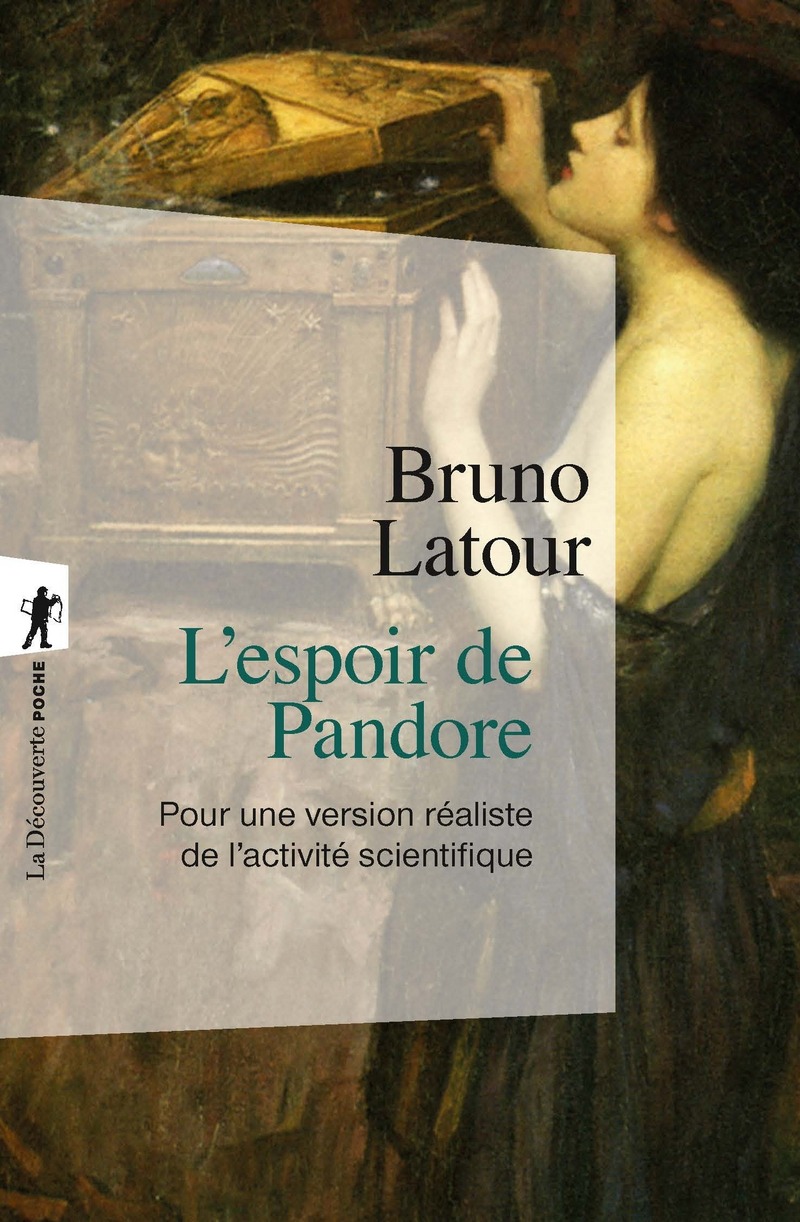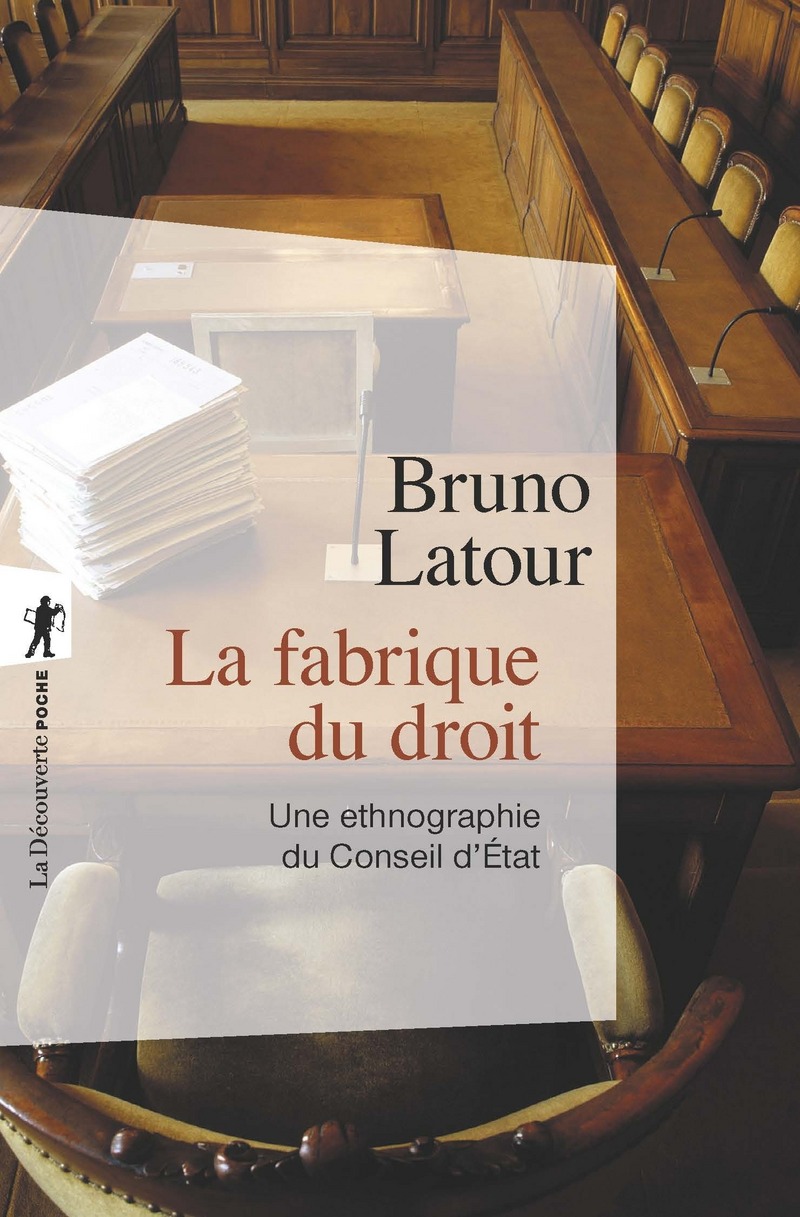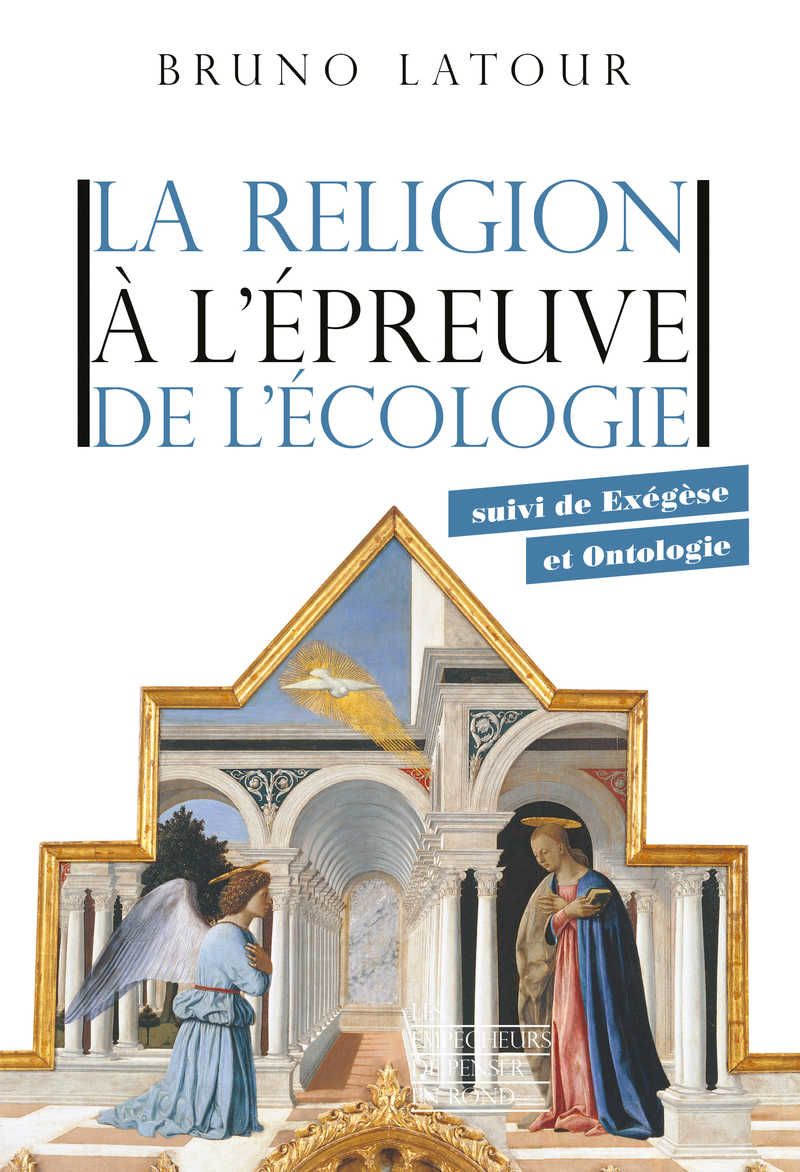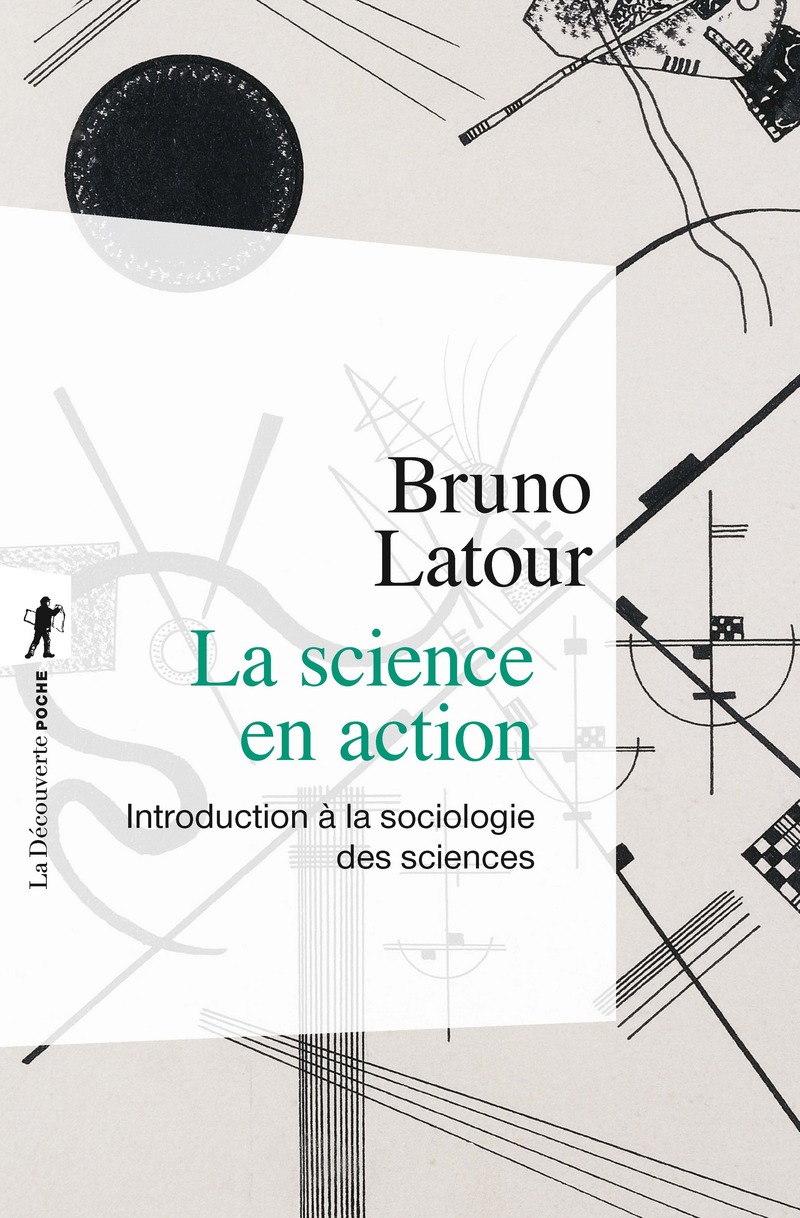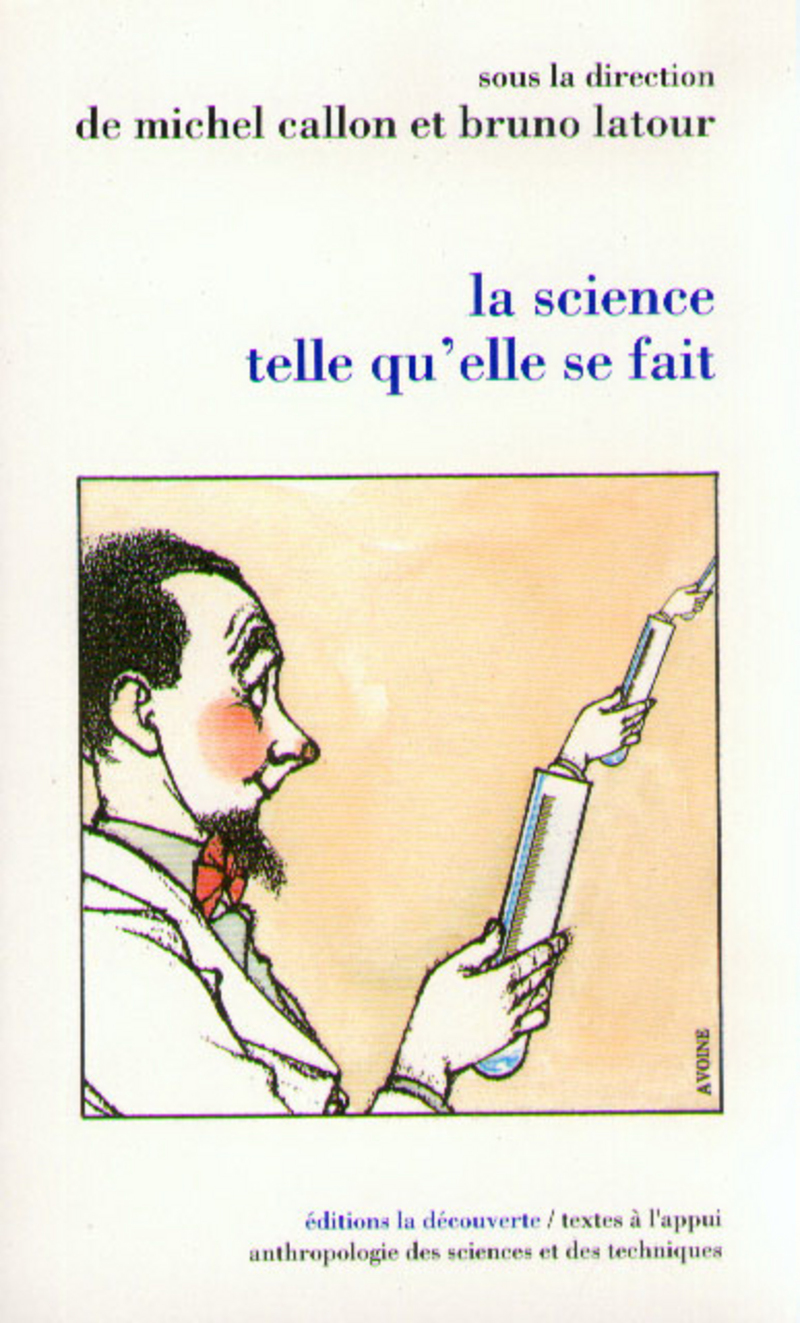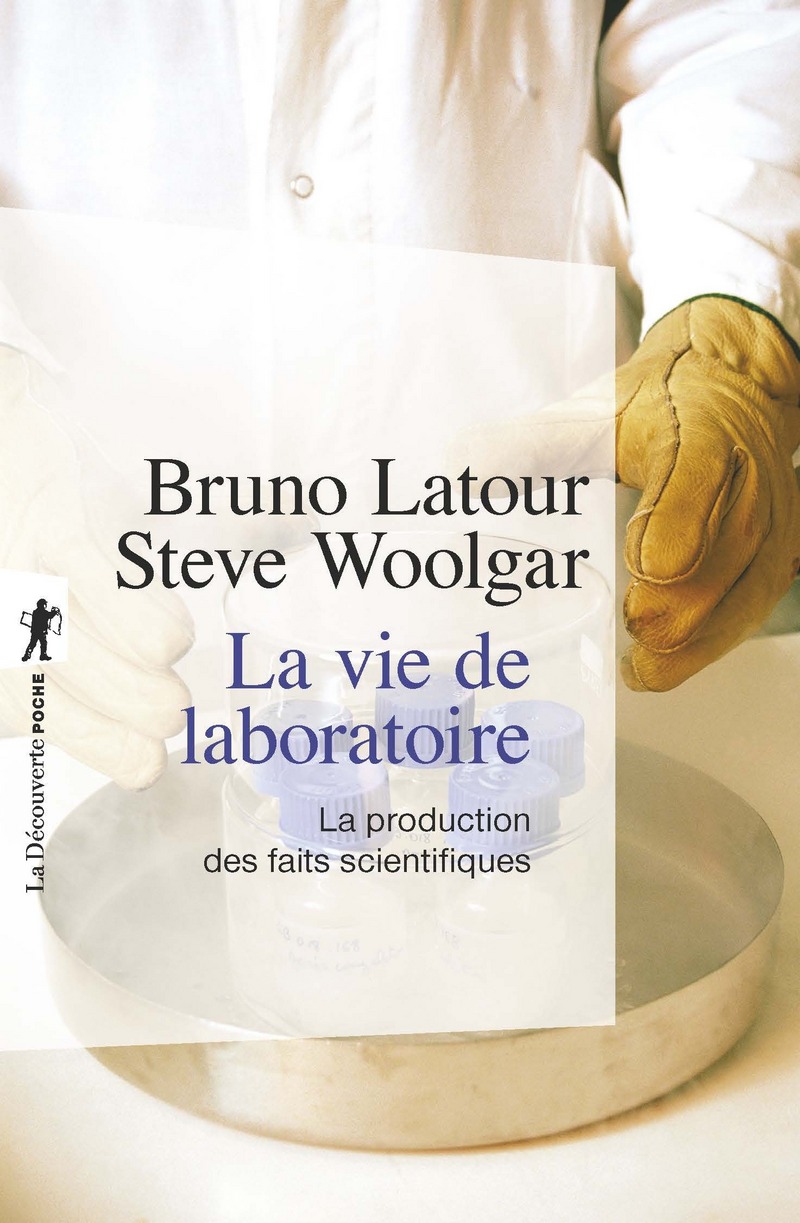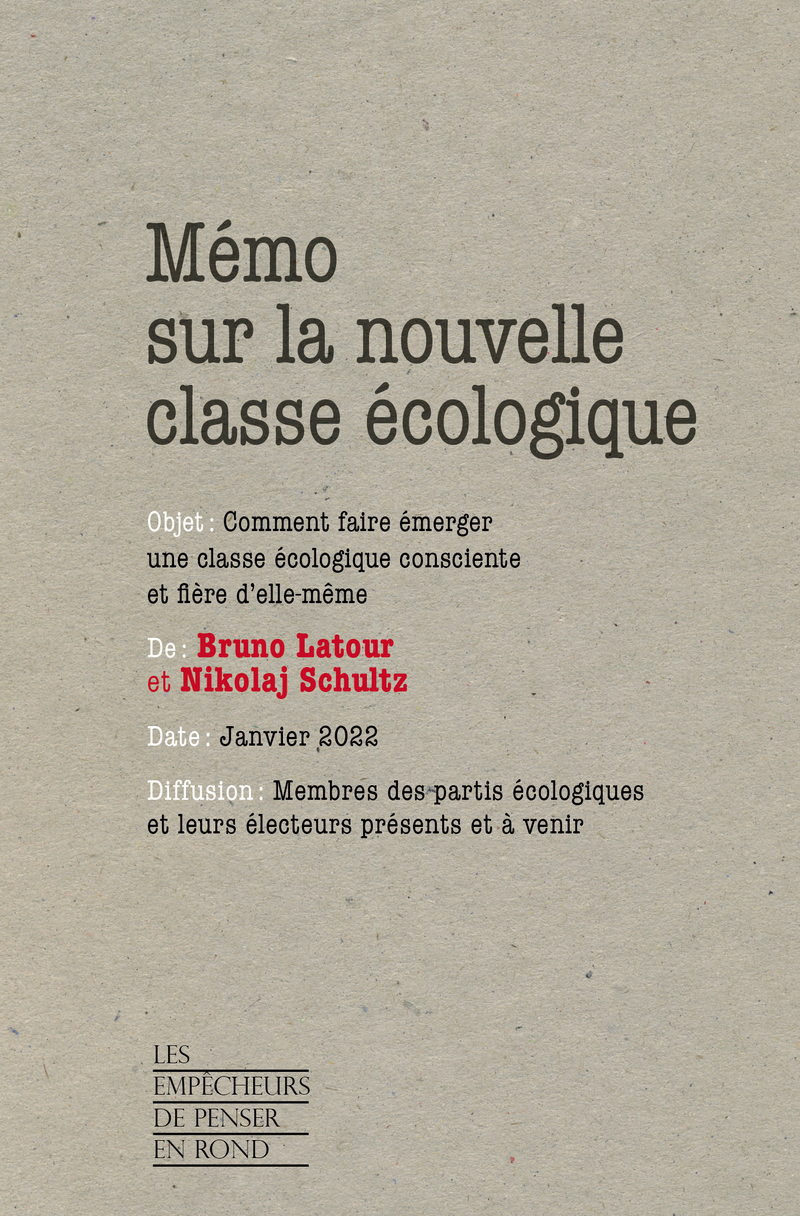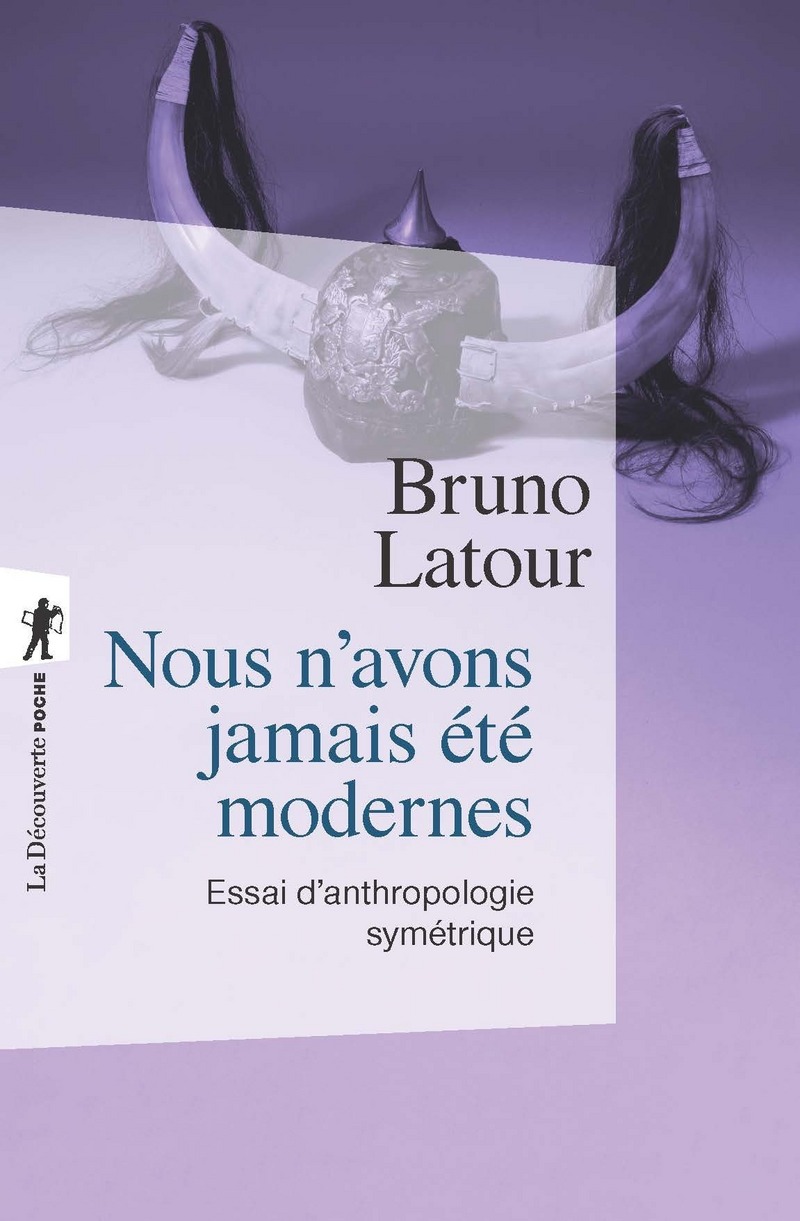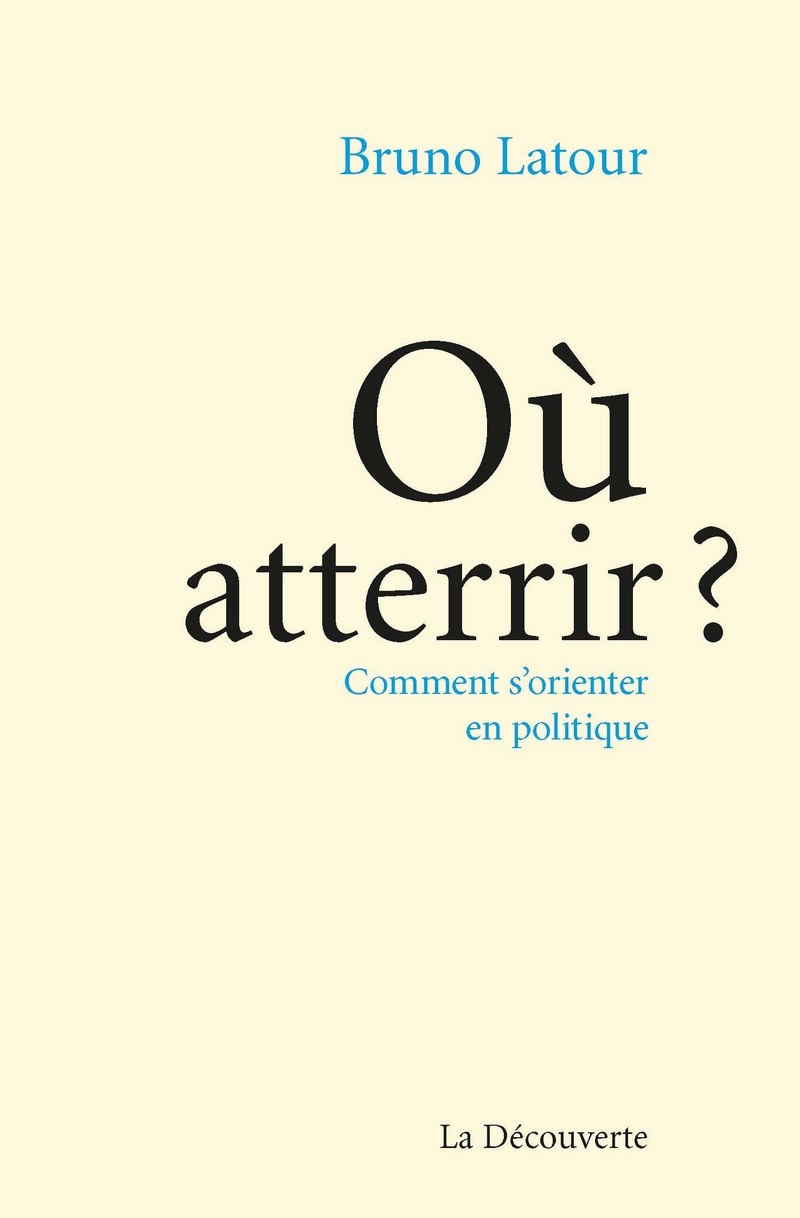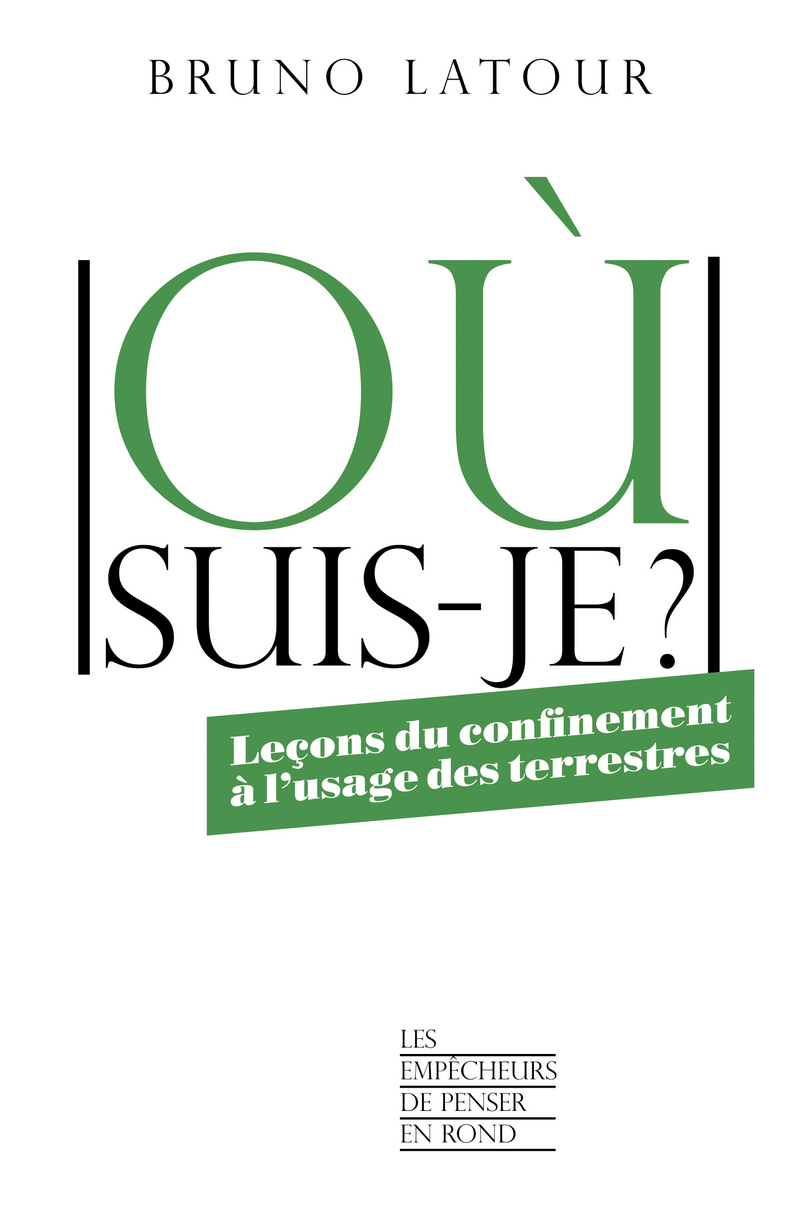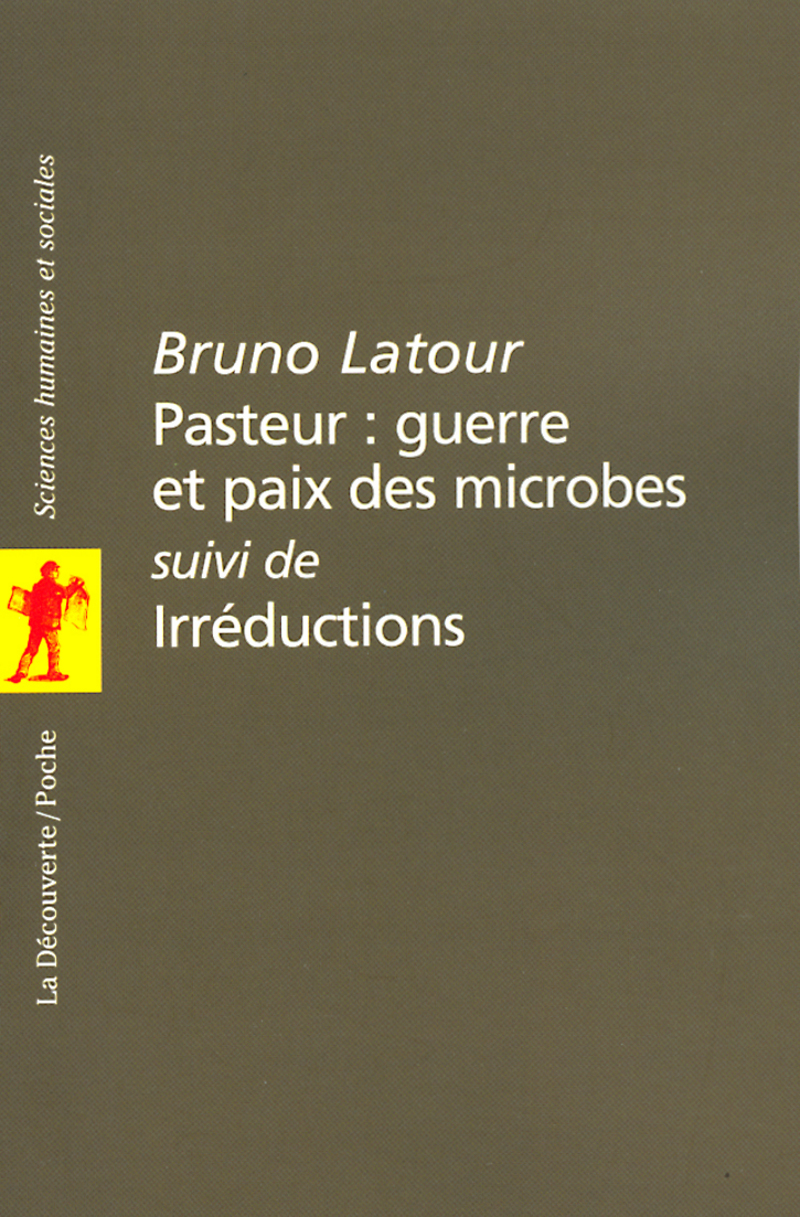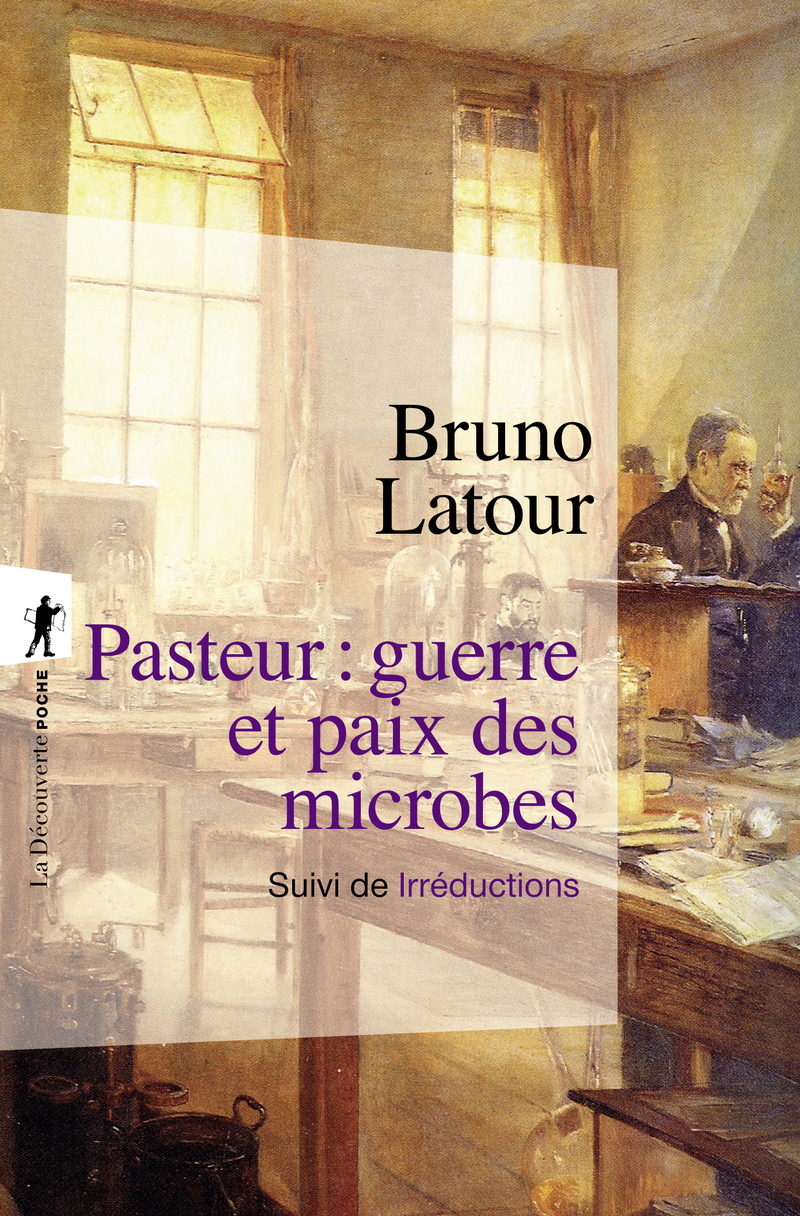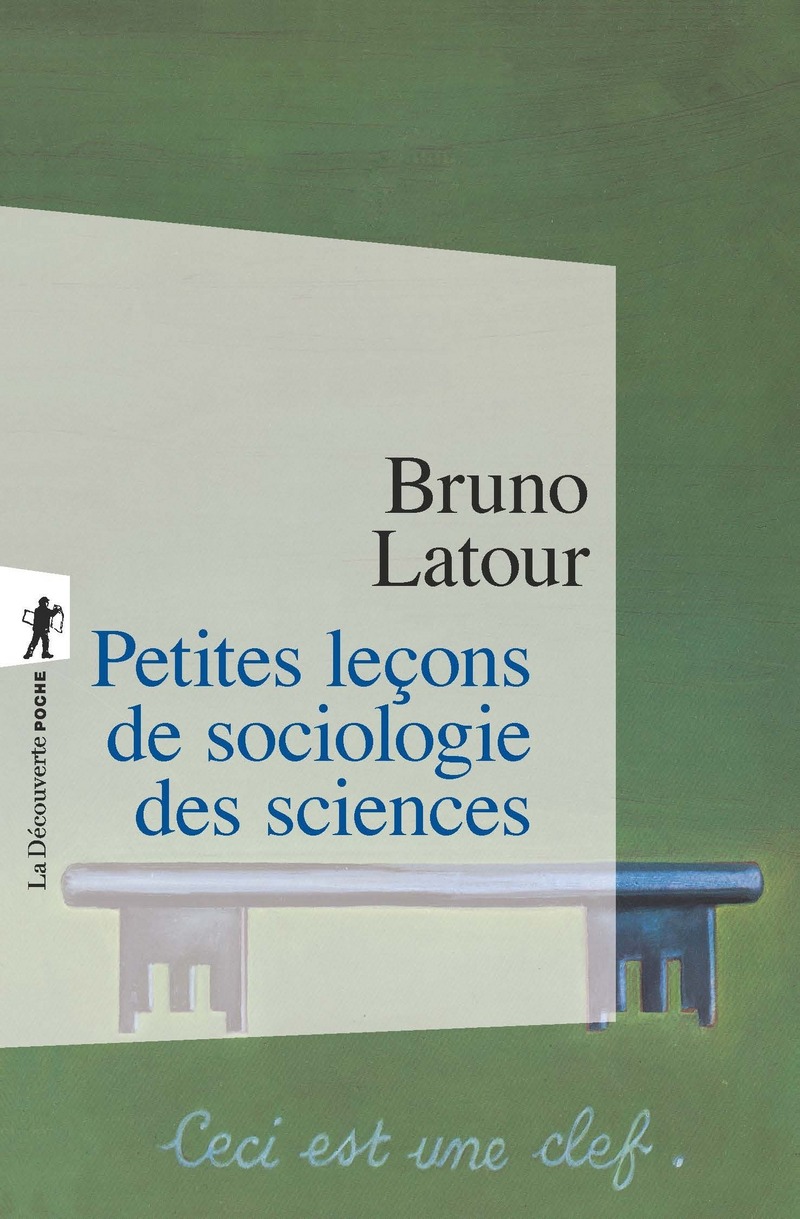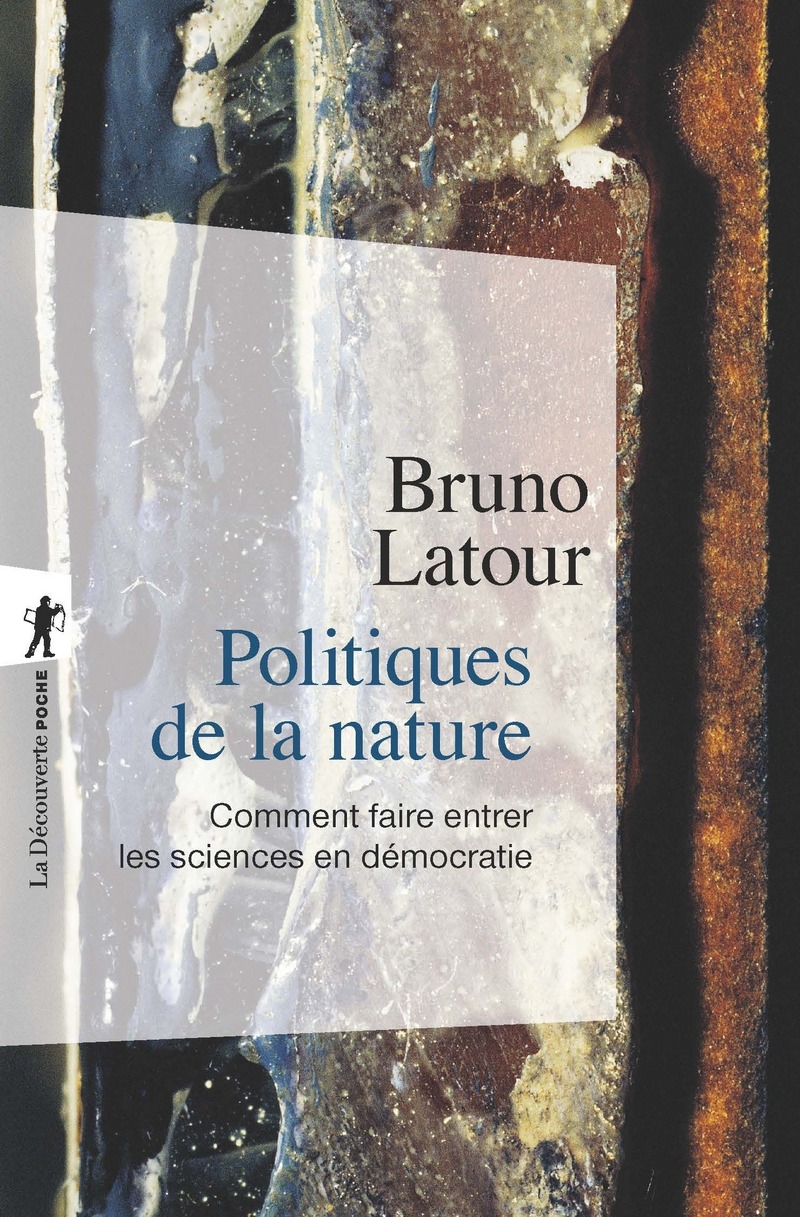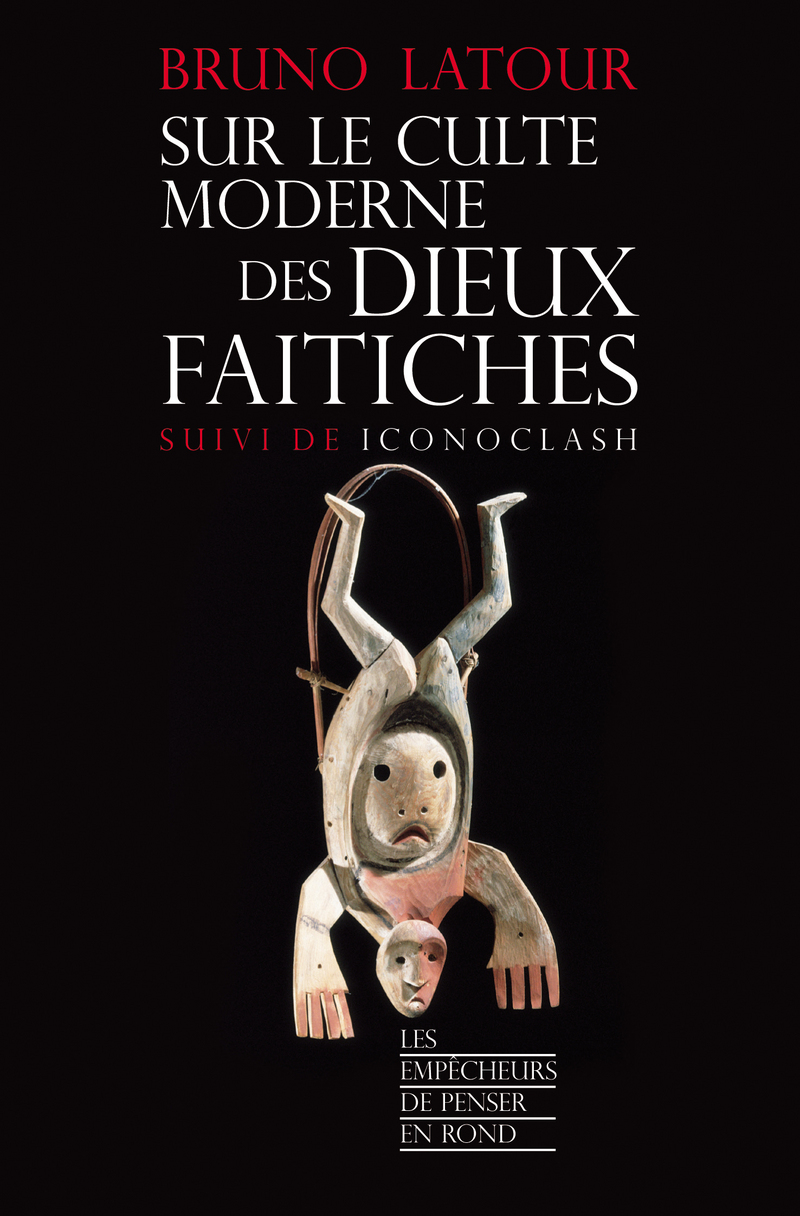Cogitamus
Six lettres sur les humanités scientifiques
Bruno Latour
À l'automne 2009, une étudiante allemande fait part à Bruno Latour de son désarroi devant les disputes qui font rage avant le sommet de Copenhague sur le climat. Il lui signale l'existence d'un enseignement qui porte justement sur les liens multiformes entre les sciences, la politique et la nature. Pour diverses raisons, l'étudiante ne peut pas suivre le cours que le professeur est obligé de lui résumer en six lettres. Au fil de l'actualité, que l'étudiante suit de son côté en tenant son " journal de bord ", voilà qu'elle découvre peu à peu comment se repérer dans ces imbroglios créés par le développement même des sciences et des techniques.
D'Archimède à Avatar, c'est l'occasion pour le lecteur d'un époustouflant galop dans ce domaine étrange des " humanités scientifiques ". Si la nature est entrée en politique, il faut bien que les sciences et les techniques fassent partie de ce qu'on appelait autrefois les " humanités ". Bruno Latour montre pourquoi il est impossible d'aborder les crises écologiques sans comprendre le caractère collectif et concret de l'acte de penser et de prouver. D'où le passage du cogito - le " je pense " cher à Descartes - à ce cogitamus - " nous pensons " -, parce que " c'est grâce au fait que nous sommes nombreux, soutenus, institués, instrumentés que nous accédons au vrai ".
Écrit dans un style alerte, véritable plaidoyer pour la " culture scientifique ", ce bref ouvrage offre la meilleure introduction pour un large public aux recherches d'un auteur traduit, étudié et commenté dans le monde entier.

Nb de pages : 246
Dimensions : * cm
 Bruno Latour
Bruno Latour

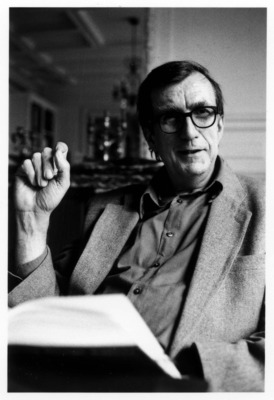
Bruno Latour (1947-2022), sociologue et philosophie, professeur associé au médialab de Sciences Po, a notamment publié Face à Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique (2015), Où atterrir ? Comment s'orienter en politique (2017) et Où suis-je ? Leçons du confinement à l'usage des terrestres (2021).
 Actualités
Actualités

Extraits presse 

" Philosophe et sociologue de forma tion, Bruno Latour a contribué à déve lopper un domaine d'études qu'il nomme les " humanités scientifiques ", et qui correspond au vocable anglais de science studies. Dans son dernier ouvrage, écrit pour répondre au désar roi d'une étudiante devant les disputes autour du sommet de Copenhague sur le climat, B. Latour cherche à expli quer ce que sont les humanités scien tifiques. Epistolaire et nourri de nombreux exemples, le livre est agréable à lire. L'idée centrale qu'il défend est qu'il faut mettre en cause la thèse de l'autonomie des sciences et des techniques, en étudiant ces der nières dans leur imbrication à la société. Ainsi, B. Latour fait d'abord remarquer que les sciences et tech niques sont omniprésentes dans la société moderne, à tel point que leur présence n'est pas toujours interro gée. Les sciences en particulier, sont souvent un moyen de justifier une position, alors que cette dernière est toujours prise sur fond d'une certaine vision du monde, de ce qu'il appelle un " cosmogramme ". Dans le même sens, l'auteur conteste la distinction radi cale entre rhétorique et démonstra tion : dans les faits, il n'y a pas de science sans rhétorique ; et, lors d'un débat scientifique, la distinction rationnel/irrationnel est en partie idéologique. La science est donc un être collectif (cogitamus, et non cogito), indissolublement liée à l'ensemble de la société. "
ÉTUDES
2026-02-13
Table des matières 

Première lettre
Deuxième lettre
Troisième lettre
Quatrième lettre
Cinquième lettre
Sixième lettre
Remerciements
Supplément bibliographique.