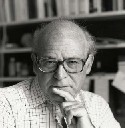Archives
(4015 archives)Denis Sieffert, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Politis, a réalisé plusieurs reportages au Proche-Orient depuis 1986, au Liban, en Palestine et Israël. Il vient de publier La nouvelle guerre médiatique israélienne.
samedi 06 juin 2009
Isabelle Stengers, auteure de Au temps des catastrophes, était l'invité de Laurence Luret sur France Inter
Réécouter l'émission
vendredi 29 mai 2009
Il travaille à l’avant-poste de la production statistique. Mais il a décidé de franchir le pas : pour expliquer comment les chiffres qu’il triture à longueur de journées sont récupérés par le politique. Ou plus exactement par le gouvernement. Alors, sous couvert d’anonymat, parce que tenu à l’obligation de réserve, il a accepté la proposition de plusieurs de ses confrères : «Participer à l’écriture d’un livre, pour expliquer qu’il y a une dérive de l’usage politique des statistiques publiques.» Son nom, ou plutôt son pseudonyme, c’est Lorraine Data. Un nom de code sous lequel s’abritent d’autres fonctionnaires, eux aussi issus de la statistique publique et de la recherche et qui ont écrit collectivement Le Grand Truquage.
Lire l'article
Les Éditions La Découverte et VidéoScopie Production présentent un livre de Bernadette Bensaude-Vincent, Les vertiges de la technoscience.
Augusto Boal, dramaturge, écrivain, théoricien et metteur en scène, est décédé le 1er mai à Rio de Janeiro.
Il était le créateur de la méthode du Théâtre de l’opprimé. Il avait notamment publié Le Théâtre de l’opprimé (La Découverte, Poche, 1996), Jeux pour acteurs et non-acteurs (La Découverte, Poche, 1997 ; nouvelle édition actualisée, 2004) et L'arc-en-ciel du désir (La Découverte, 2002).
A lire l'article de Jean-Pierre Thibaudat sur Rue 89, l'hommage de Jean-Gabriel Carasso et Le Monde.fr
Les éditeurs affichent leur solidarité avec Eric Hazan
Dans une tribune publiée dans l’édition du Monde datée du 21 avril, 18 éditeurs et un libraire apportent leur soutien à Eric Hazan, entendu comme témoin par la sous-direction de l’antiterrorisme, le 9 avril, dans le cadre de l’enquête sur Julien Coupat.
samedi 14 mars 2009
Le développement durable suffira-t-il à éviter la catastrophe écologique ? Afin de répondre à cette question, Bertrand Méheust, auteur de La politique de l'oxymore était l'invité de Laurence Luret sur France Inter.
Réécouter l'émission
Dans L’Ennemi intérieur, Mathieu Rigouste revisite avec brio cinquante années de l’ordre en France. Pour le jeune chercheur, «la guerre coloniale a constitué» rien de moins qu’«une matrice institutionnelle» de la France contemporaine et de certaines de ses techniques policières. De l’immigré aux «nouvelles menaces», de l’Algérie 1958 aux quartiers populaires d’aujourd’hui, il raconte l’évolution des doctrines et des pratiques.
Étonnant revirement du président français du président français depuis son discours prononcé le 26 juillet 2007 à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, qui avait décidé Mme Adame Ba Konaré à entreprendre la réalisation de l’ouvrage collectif Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy. Dans son discours à Brazzaville en mars 2009, il semble en effet avoir (un peu) bénéficié de cette « remise à niveau », en déclarant :
« Je l’affirme, la démocratie et les droits de l’homme font partie de notre héritage commun : ce ne sont pas pour autant des valeurs artificiellement plaquées sur votre société et qu’une arrogance occidentale ou française aurait décrétées universelles. Il s’agit aussi de valeurs africaines.
« Une historienne africaine, Monsieur le Président, m’a dédié un “petit précis d’histoire africaine”. J’ai eu du plaisir à lire ce petit précis, Mme Konaré a pris la peine de le publier. C’est intéressant parce que ce “petit précis d’histoire africaine”, rédigé par une Africaine, décrit bien l’humanisme qui se trouve en Afrique, dès le xiiie siècle, au cœur de la Charte de Kourougan Fouga, au Mali. Cet humanisme du xiiie siècle en Afrique n’a rien à envier aux principes qui ont préfiguré en Europe l’énoncé des droits de l’homme. »
Écouter le discours