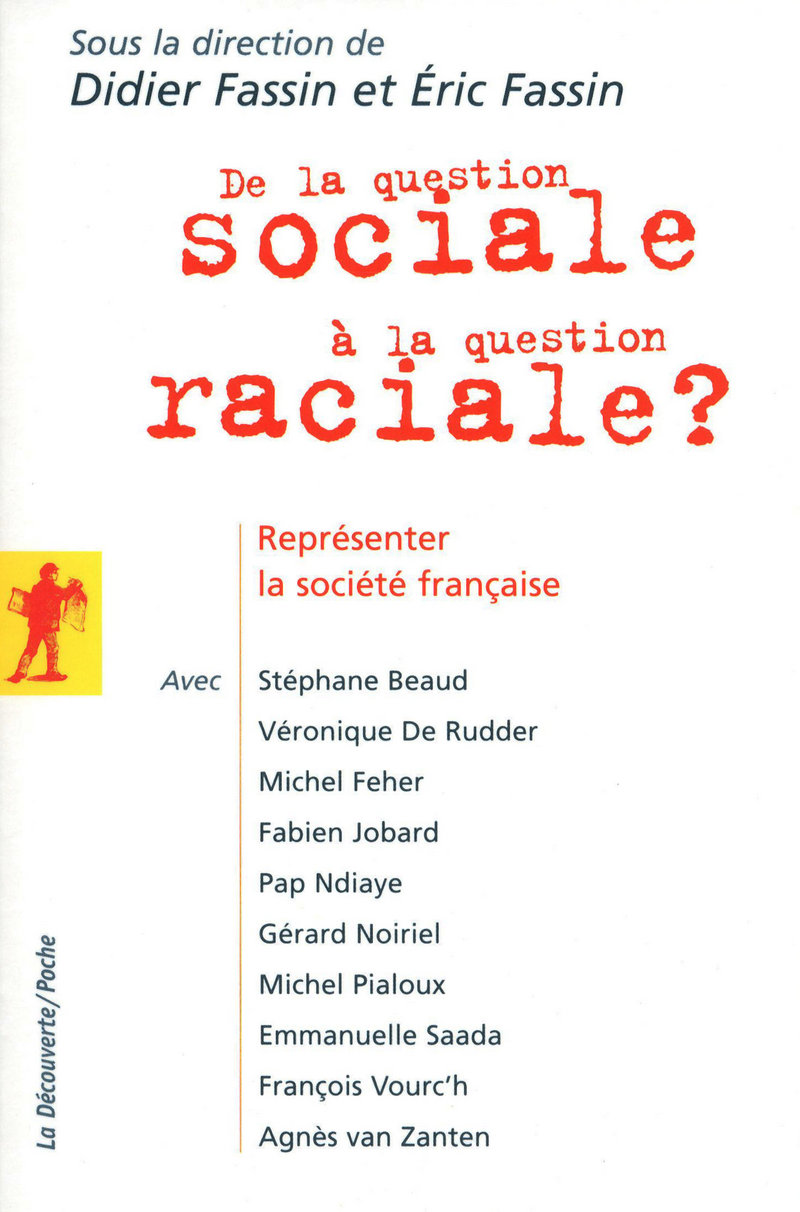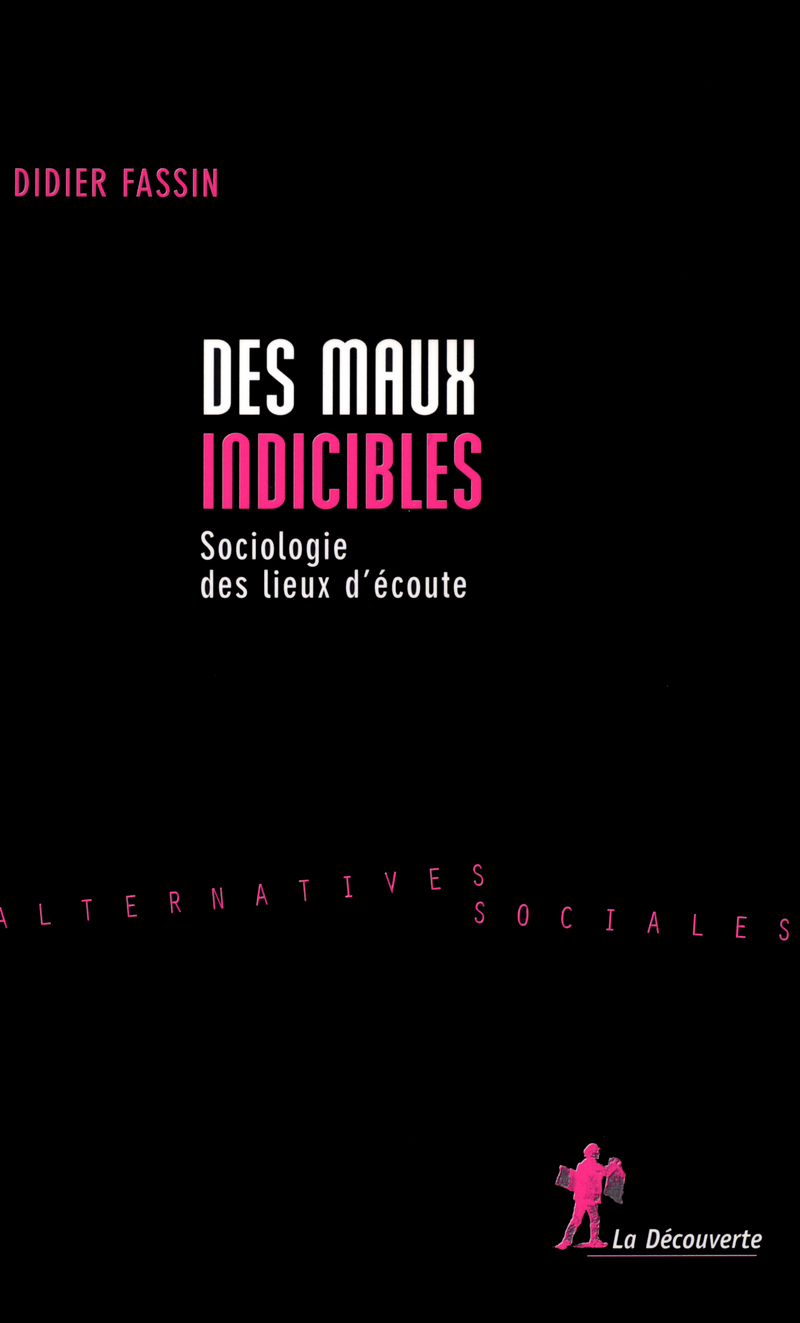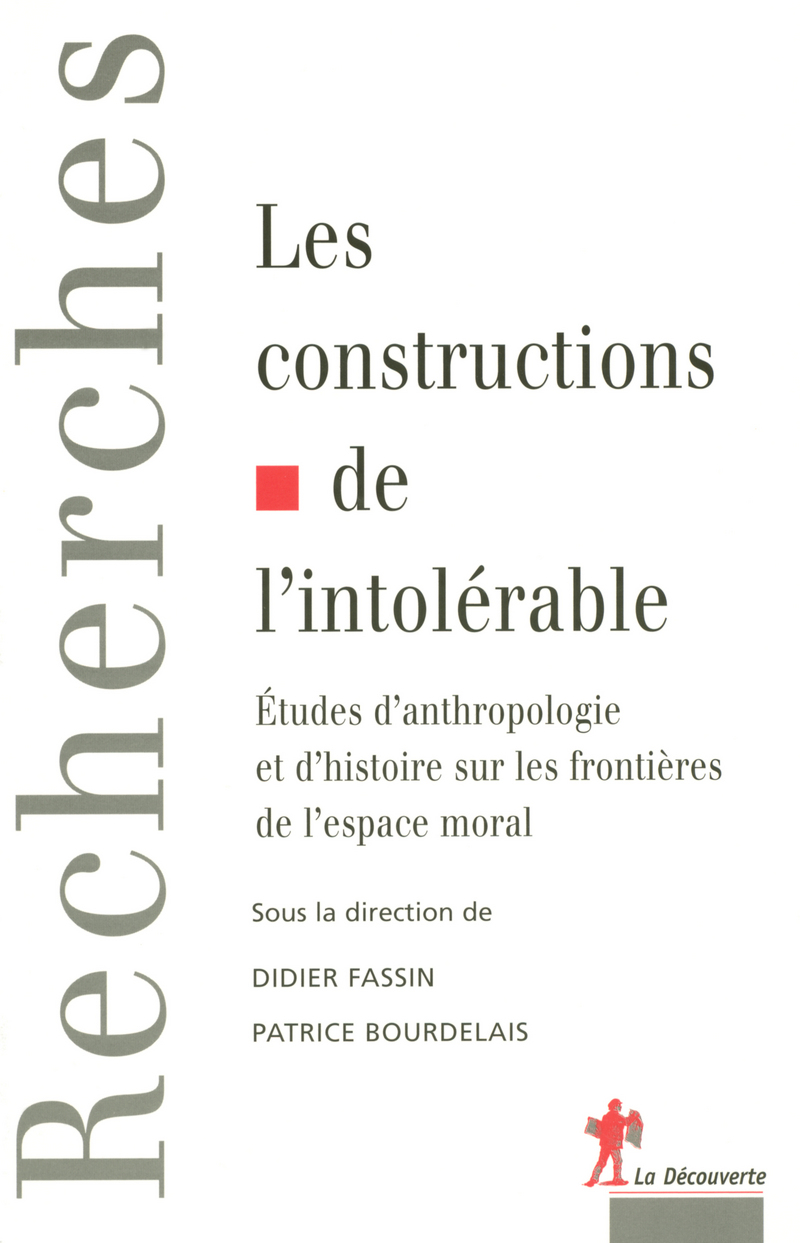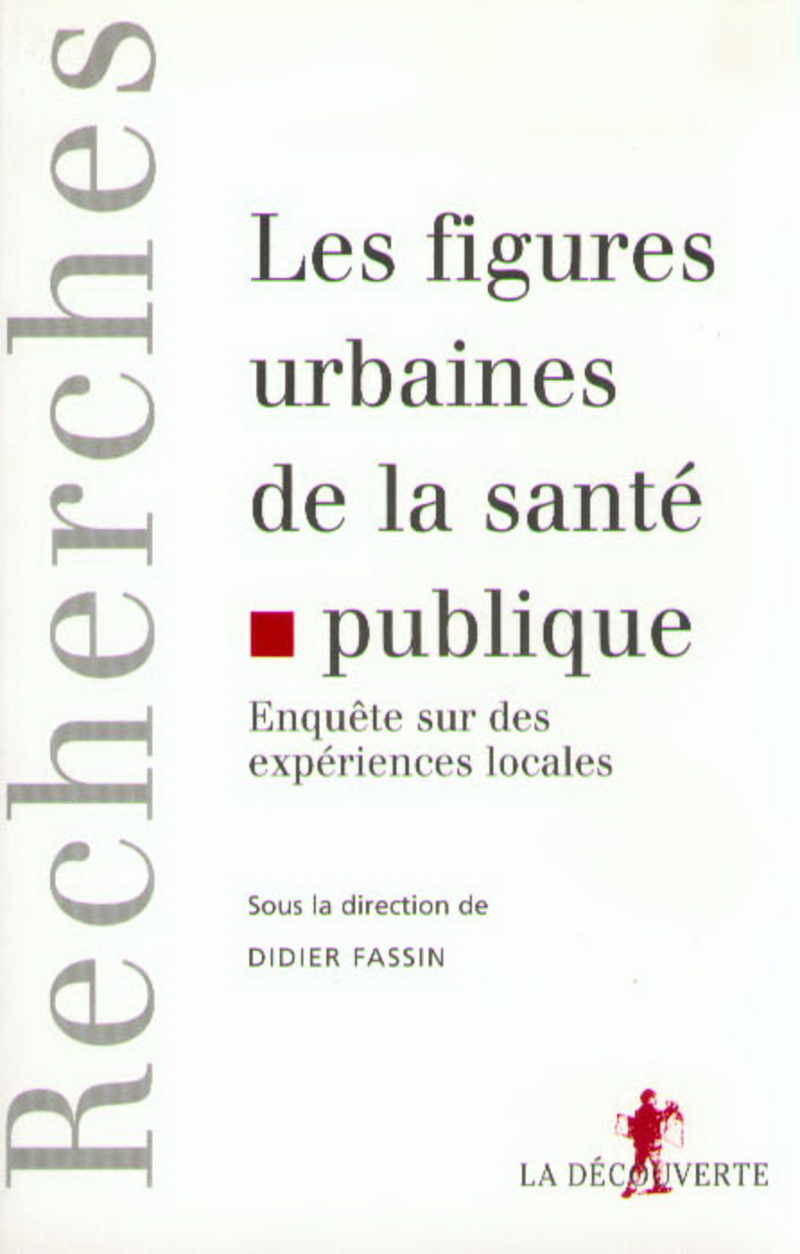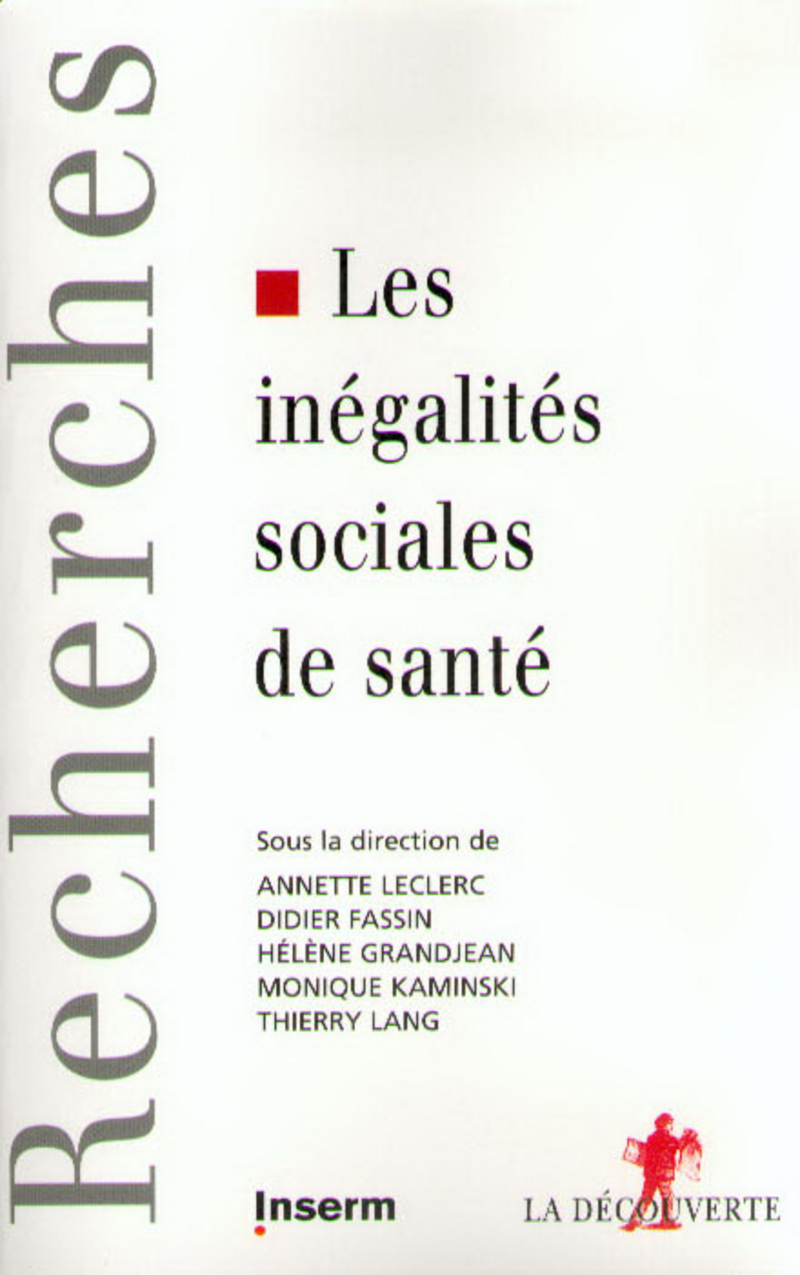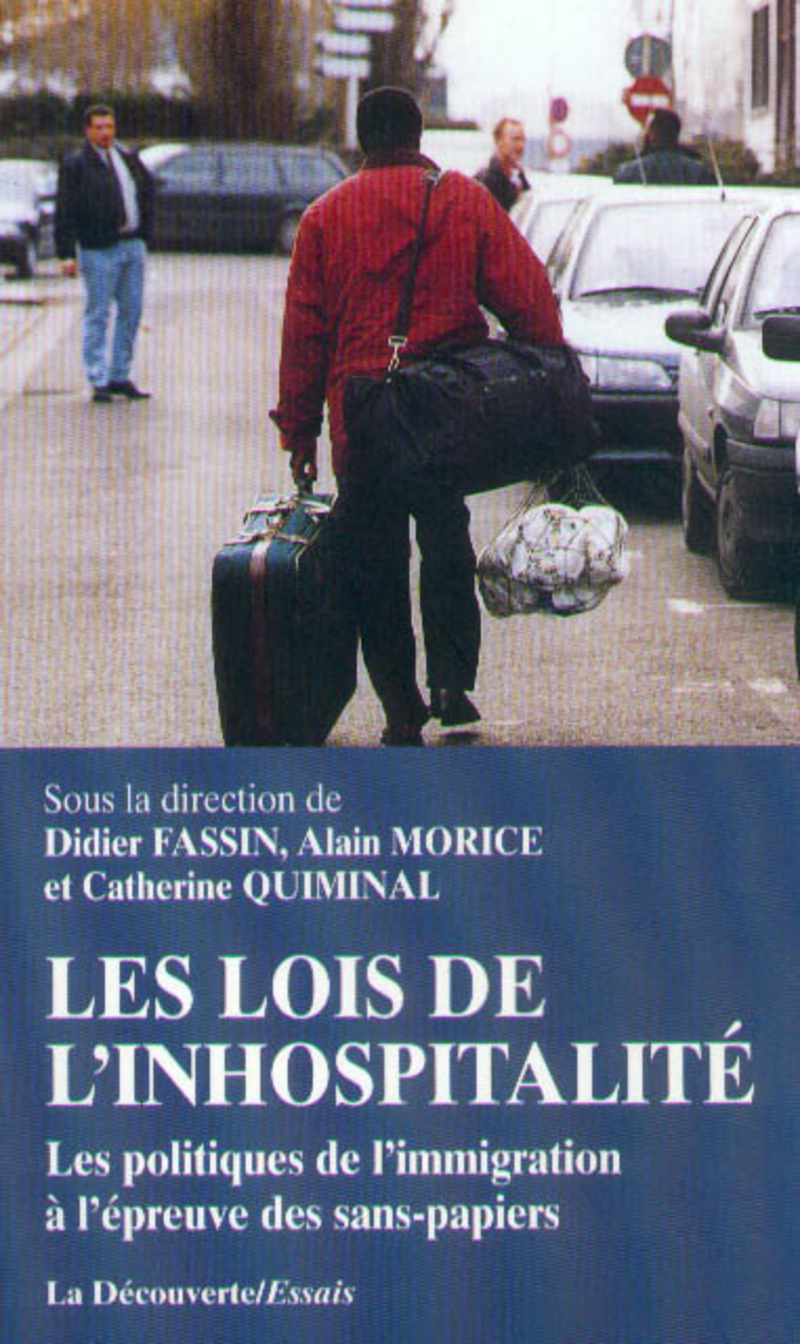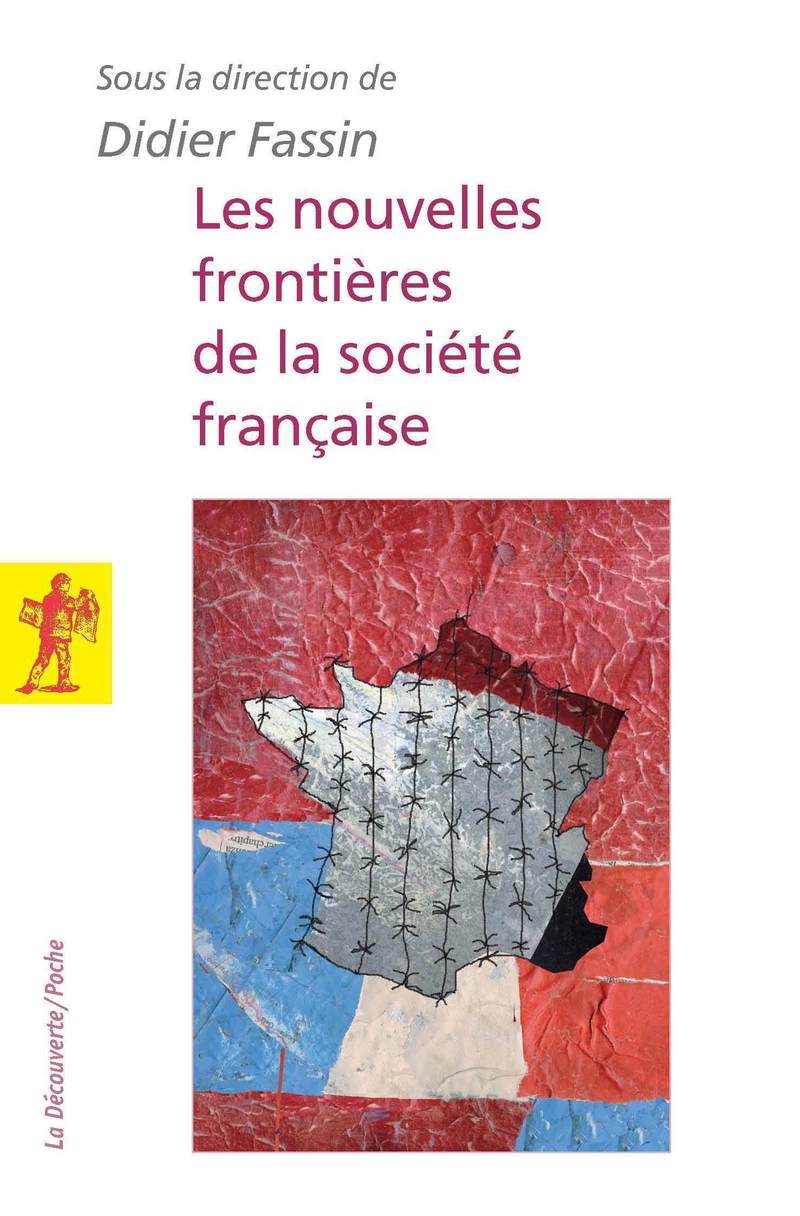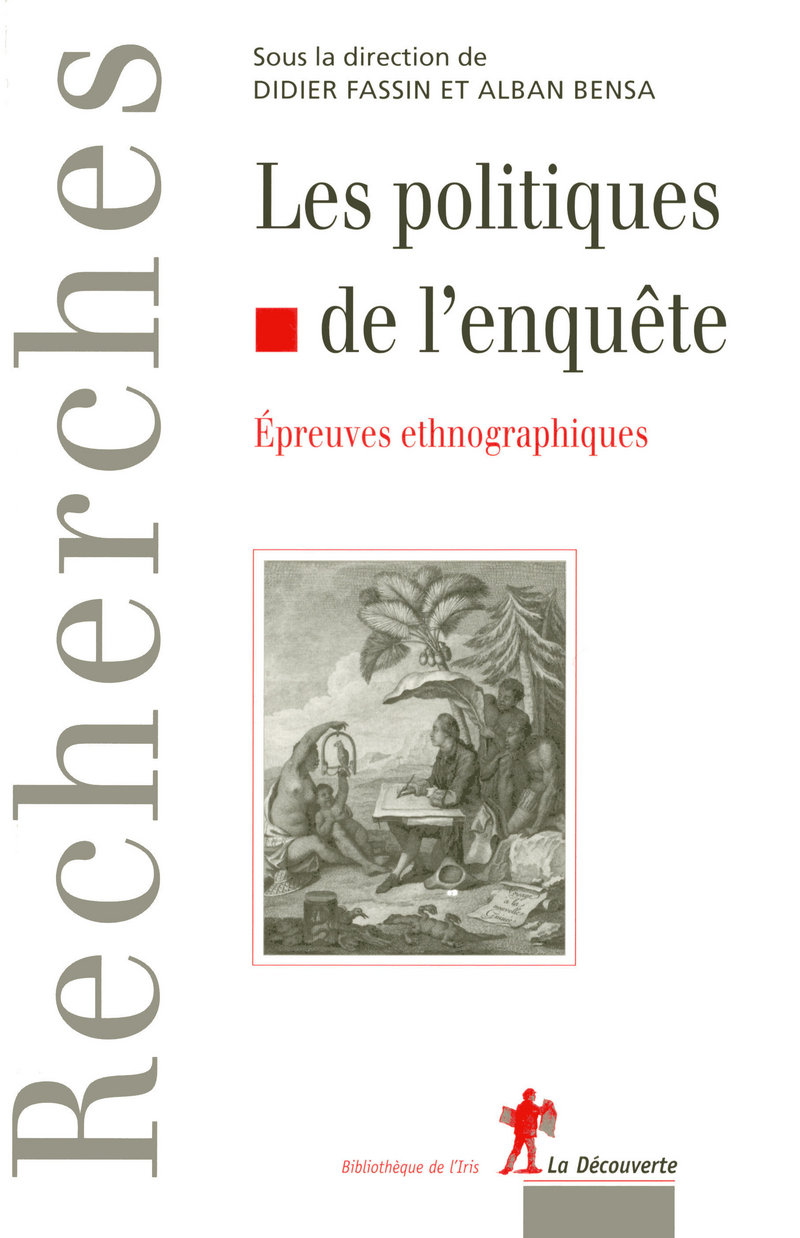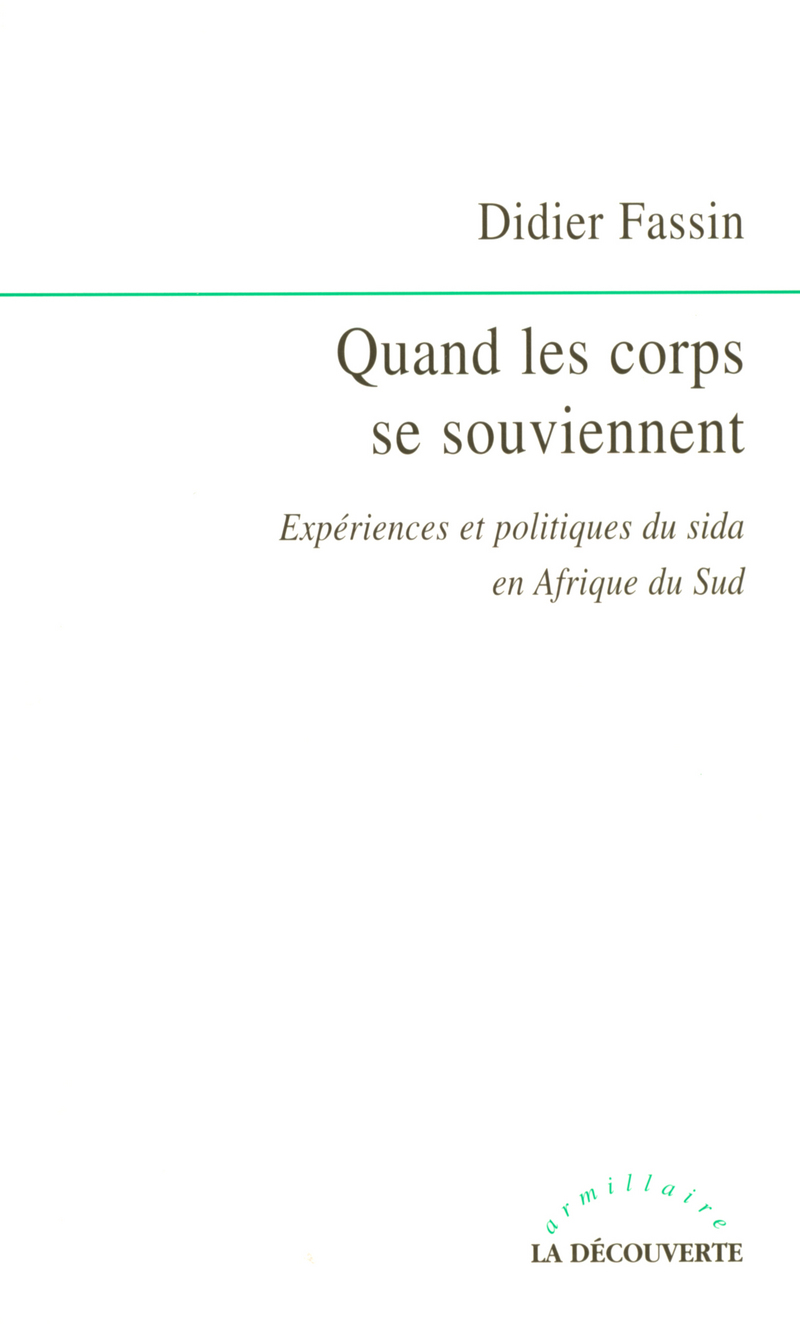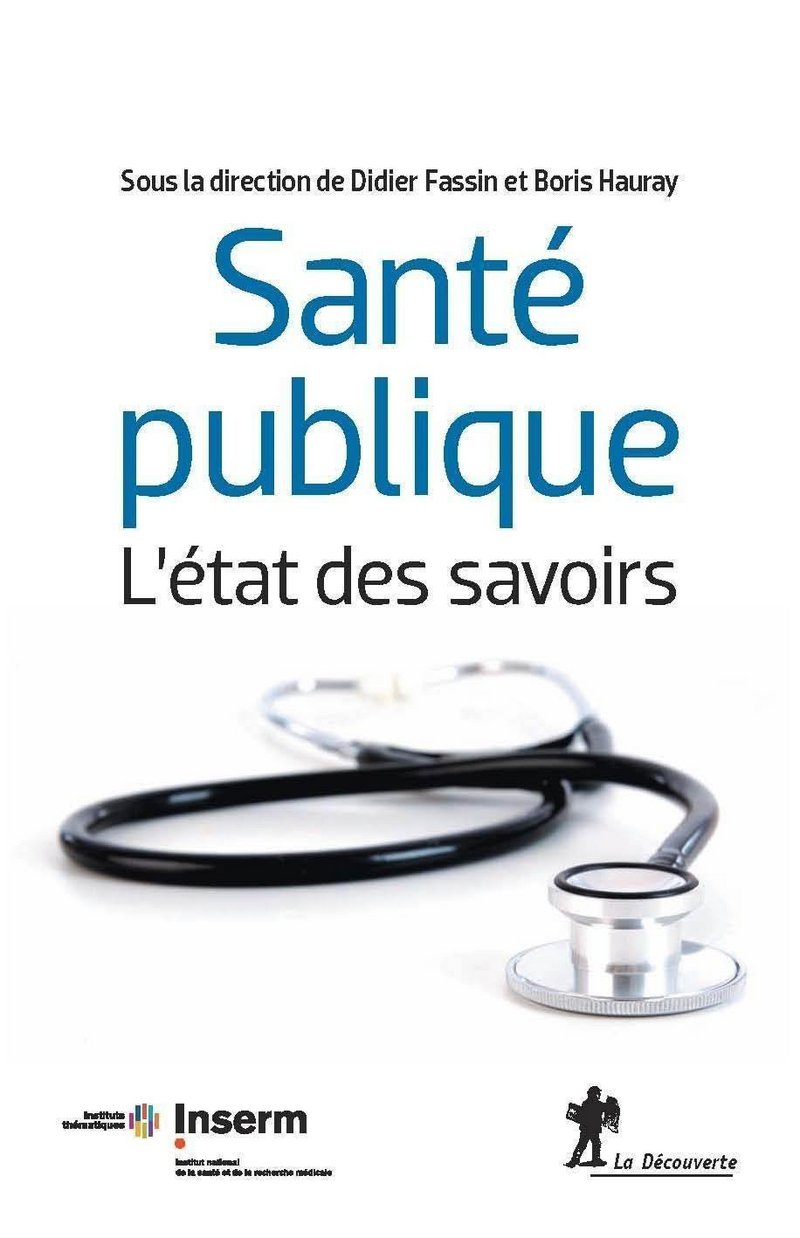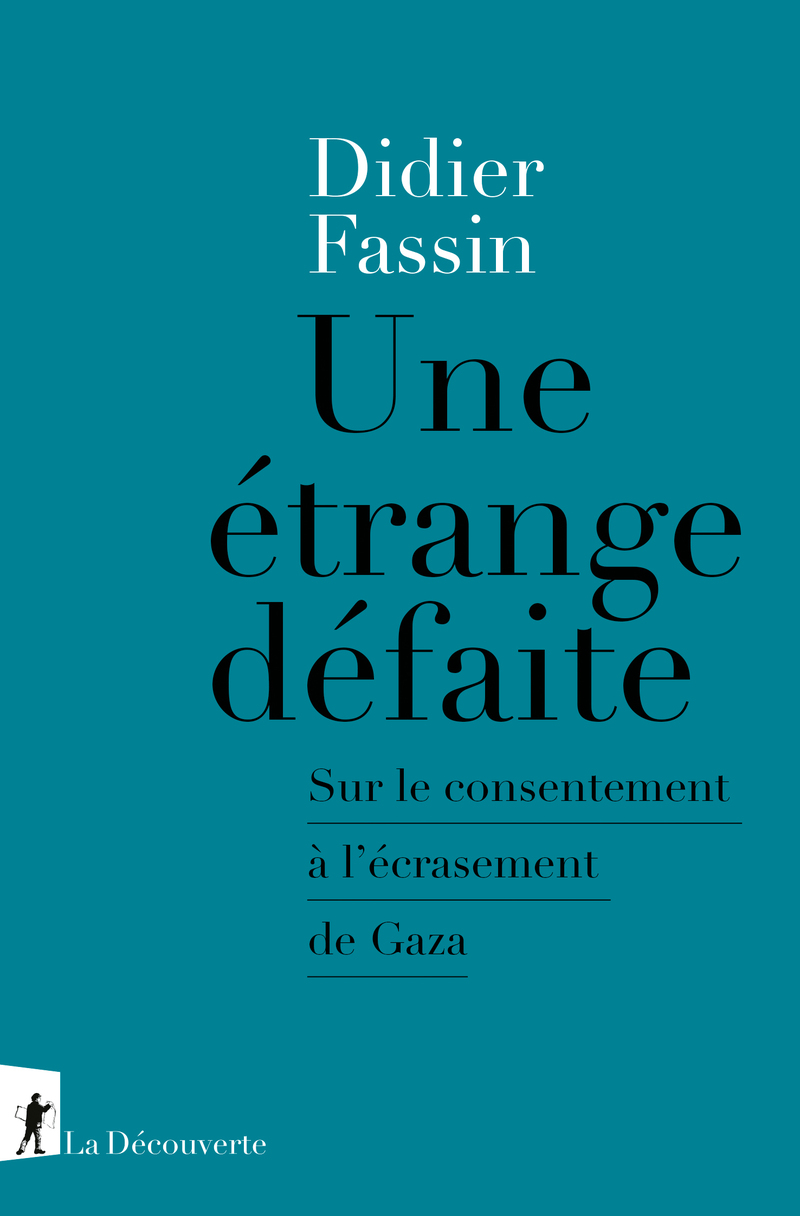Leçons de ténèbres
Ce que la violence dit du monde
Didier Fassin
La violence hante le monde. Des homicides aux génocides, des abus sexuels aux guerres civiles, des répressions de protestations aux persécutions de minorités, des mouvements citoyens qui la dénoncent aux silences institutionnels qui l'occultent, elle est partie intégrante de la vie en société et de l'expérience humaine. Présente dans le discours politique et la production artistique, dans l'espace public et les réseaux sociaux, elle ne cesse d'être questionnée, contestée, redéfinie, par la loi et le droit comme par les mobilisations sociales et le discours savant, dévoilant ses multiples dimensions, symbolique et structurelle, morale et psychique, de genre et d'État.
Paradoxalement, toutefois, les sciences sociales n'ont commencé à l'analyser que tardivement. Inversement, les mythes et récits de ses origines ont sans cesse été réactualisés à des fins idéologiques, tandis que la psychanalyse, l'éthologie et la philosophie politique l'exploraient dans diverses perspectives généalogiques. Mais la violence n'est pas seulement un objet d'étude, elle est aussi une matière vivante dont s'emparent écrivains et cinéastes, juristes et témoins, militaires et militants. Son écriture et ses représentations interrogent les manières de la qualifier et de l'attester, la possibilité de la refuser ou au contraire de la défendre.
En étudiant ses formes, il s'agit d'appréhender ce que le monde dit de la violence et ce que la violence fait au monde.

Nb de pages : 324
Dimensions : 13.5 * 22 cm
ISBN numérique : 9782348089428
 Didier Fassin
Didier Fassin


Didier Fassin est anthropologue et médecin, professeur au Collège de France sur la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines et à l'Institute for Advanced Study de Princeton. Il est l'auteur de vingt-cinq livres traduits en douze langues, dont Une étrange défaite. Sur le consentement à la destruction de Gaza (La Découverte, 2024), et a dirigé une trentaine d'ouvrages collectifs, dont La société qui vient (Seuil, 2022).
 Actualités
Actualités

Extraits presse 

2025-09-08 - Quentin Lafay - France Culture
Un essai salutaire et bienvenu dans le terrible vacarme des armes, et qui interroge la violence sur "ce qu'elle dit du monde" à partir de cinq portes d'entrées : notre façon de l'écrire, de la représenter, de l'attester, de la qualifier et de la refuser. C'est la force de ces Leçons de ténèbres, composées par le médecin et anthropologue Didier Fassin, d'éclairer un peu les " ténèbres " de notre monde, de suspendre un temps les tensions et polémiques sur les conflits qui surgissent partout, et d'ouvrir un espace de réflexion loin du bruit, de la fureur et du renoncement à penser.
2025-09-10 - Olivier Pascal-Moussellard - Télérama
Guerres, orientation scolaire, homicide, viol, contrôle au faciès, condition carcérale, harcèlement, génocide, insultes, attentat... Quoi de commun entre toutes ces réalités sociales ? La violence. Un seul et même mot peut-il les saisir toutes ? L'anthropologue et sociologue Didier Fassin en fait le pari. Non pas pour proposer une théorie générale de la violence mais plutôt pour s'en saisir comme d'un prisme.
"Ce rôle majeur joué par la violence dans les affaires humaines"*. (...)
Leçons de ténèbres est dédié : "aux victimes de violence (...) dont on détourne le regard, dont on protège les auteurs, et condamne celles et ceux qui les dénoncent". Dans cet essai, il interroge les mythes ainsi que les représentations de cette violence ; une violence qui peut être physique, morale, symbolique... Des guerres aux faits divers, le spectre de cette violence est omniprésent. Didier Fassin s'attache à décrire les processus de construction de cet objet de connaissance ; une brutalité qui se dérobe aux tentatives de la définir de manière univoque.
2025-09-11 - Sylvain Bourmeau - France Culture - La suite dans les idées
Un an après son cri d'alarme sur le consentement à l'écrasement de Gaza, le professeur au Collège de France interroge ce que la violence dit du monde et de notre espèce, à l'ombre de la destruction de la Palestine. (...) Leçons de ténèbres est une vaste enquête aussi pluridisciplinaire qu'internationale, sur cette violence qui hante le monde, des homicides aux génocides, des féminicides aux viols, des guerres impériales aux guerres civiles, des crimes étatiques aux violences domestiques. Écrit à l'ombre de Gaza, ce livre essentiel est une invitation à avoir l'intelligence de nos indignations et de nos révoltes, à comprendre ce qui nous arrive, cette catastrophe qui n'est plus à venir mais qui est en cours, sous les yeux du monde entier, pour essayer de trouver le chemin d'une espérance renouvelée et réenchantée.
2025-09-12 - Edwy Plenel - Mediapart
Avec Leçons de ténèbres, un an après la publication d' Une étrange défaite, Didier Fassin interroge la place de la violence comme sa représentation dans nos sociétés. Il y relève notamment le long silence des sciences sociales sur la violence ou encore la hiérarchisation des vies, le génocide de Gaza et le sort des Palestiniens.
2025-10-02 - Diego Chauvet - L'Humanité
Au départ du livre de Didier Fassin, tiré d'un cours donné au collège de France, il y a " un étonnement : la longue absence de la question de la violence en tant que telle dans les sciences sociales ", en anthropologie comme en sociologie. C'est en questionnant les raisons de cette absence que le chercheur essaye de circonscrire cet objet complexe, en s'intéressant davantage à ses expressions collectives qu'à ses manifestations individuelles. (...) Plus que de poser un cadre théorique, l'auteur tente de dessiner " une carte de la violence " et fait " l'examen des différentes manières de l'écrire, de la représenter, de l'attester, de la qualifier voire de la refuser ". On ne ressort pas de cette lecture avec des réponses claires, mais avec des questionnements nourris par les différentes perspectives proposées. Le troisième chapitre raconte ainsi la vaine quête d'une définition de la violence.
" Alors que le sens du mot semble aller de soi lorsqu'on l'utilise dans le langage courant, on voit que dès qu'on s'efforce de le circonscrire, il se délite et se multiplie. " Cet ouvrage est nourri des multiples études de terrain réalisées par Didier Fassin tout au long de sa carrière, et de sources variées allant de la théorie politique aux oeuvres littéraires et aux récits mythologiques. Enfin, l'écriture du livre est traversée par le génocide en cours à Gaza –; comment pourrait-il en être autrement ?
2025-10-10 - Ballast
Dans Leçons de ténèbres, sa réflexion sur la violence éclaire autrement cette charge contre une supposée politisation des sciences sociales résumée en un mot : "wokisme". Le sociologue y analyse une forme d'extension des formes de la violence dans le monde contemporain, à laquelle contribuent les sciences sociales. Comme d'autres acteurs des luttes citoyennes, elles ont rendu visibles, en les documentant et en les disqualifiant, des violences jusque-là laisées dans l'ombre. Un geste qui ébranle profondément les structures du monde tel qu'il va, et tel ,qu'il était pensé.
2025-10-23 - Clémence Mary - Libération
Vidéos 

Table des matières 

Préface. Hantologie
Partie I – Savoir
1. Épistémologie d'une ignorance
La violence, quel périmètre ? – Parcours de recherche. – Une si longue absence. – L'anthropologie et le créneau du sauvage. – Le paradigme de l'ordre social. – La sociologie et l'héritage durkheimien. – La théorie de la pacification du monde. – Un péché originel de la philosophie politique. – Commencements.
2. Naissance d'une question
Manières de voir. – Gangs et mafias : une sociologie interactionniste. – Police et prison : une criminologie critique. – Hostilité et perversité : trouble éthique dans l'ethnologie. – Guerres et révoltes : renouveau de l'anthropologie politique. – Le terrorisme dans tous ses états. – Réflexivité.
3. En quête de définition
Au-delà de la condamnation. – Dilemme méthodologique : l'universel et le relatif. – Impossible définition : plus que l'expression physique, mais jusqu'où ? – La violence structurelle et ses limites. – La violence symbolique et sa critique. – Des étymologies, une philologie. – Problématisation.
4. À la recherche des origines
Des dieux et des humains. – Rituels et croyances. – Du récit national à l'idéologie nationaliste. – Un baptême et une bataille. – Les sources bibliques de la guerre totale. – Mémoire héroïque et mémoire douloureuse. – Communautés imaginées. – Victimes substituées. – Choses consacrées. – Fondation.
5. Sur quelques généalogies
Convergence de la psychanalyse et de l'éthologie. – Pulsion de mort de l'individu et instinct de survie de l'espèce. – Sciences cognitives et psychologie évolutionniste. – Des sociétés moins violentes ? – Réalisme hobbesien et nostalgie rousseauiste. – Une fable sombre. – Une critique de la violence. – Démocratie.
Partie II – Faire
6. Écrire
Cinq écueils, une révélation. – Fiction et ethnographie, entre vérité et réalité. – Un testament. – Deux romancières, deux grammaires. – Ce qui peut être dit et ce qu'on doit taire. – Tortionnaires et meurtriers. – Au-delà du triangle de la violence. – Quatre reconstitutions d'un massacre. – Enquête et contre-enquête. – Voix.
7. Représenter
La violence coloniale : un roman, deux rapports. – Affecter ou convaincre. – Transmissions : la philosophe et l'anthropologue. – La violence guerrière :
hubris et brutalisation. – L'effroi et l'indignation. – Images : exaltation de la destruction et expérience de la perte. – Absence.
8. Attester
Cinq figures du témoin – Le tiers et le survivant : une distinction contestée. – Styles de la littérature concentrationnaire. – Le crédit de l'auteur et l'enquête de l'historien. – Récits des mille collines. – Martyrs chrétiens et palestiniens. – Innovations technologiques dans le témoignage. – Vérité.
9. Qualifier
Deux ordres : reconnaissance et caractérisation. – Esthétique morale et chirurgie génitale. – Bouffonnerie rituelle et souffrance intime. – Déni, dissimulation, justification. – Le conflit des interprétations. – Deux significations d'un événement. – Une qualification controversée. – Batailles.
10. Refuser
Jugement moral et réalité politique. – Trois apôtres de la non-violence. – Quand la violence devient légitime. – Métamorphoses de la terreur. – Protestation publique et résistance silencieuse. – Tactiques de l'opprimé et stratégies de l'oppresseur. – Politiques du refus. – Responsabilité.
Remerciements
Notes
Index.