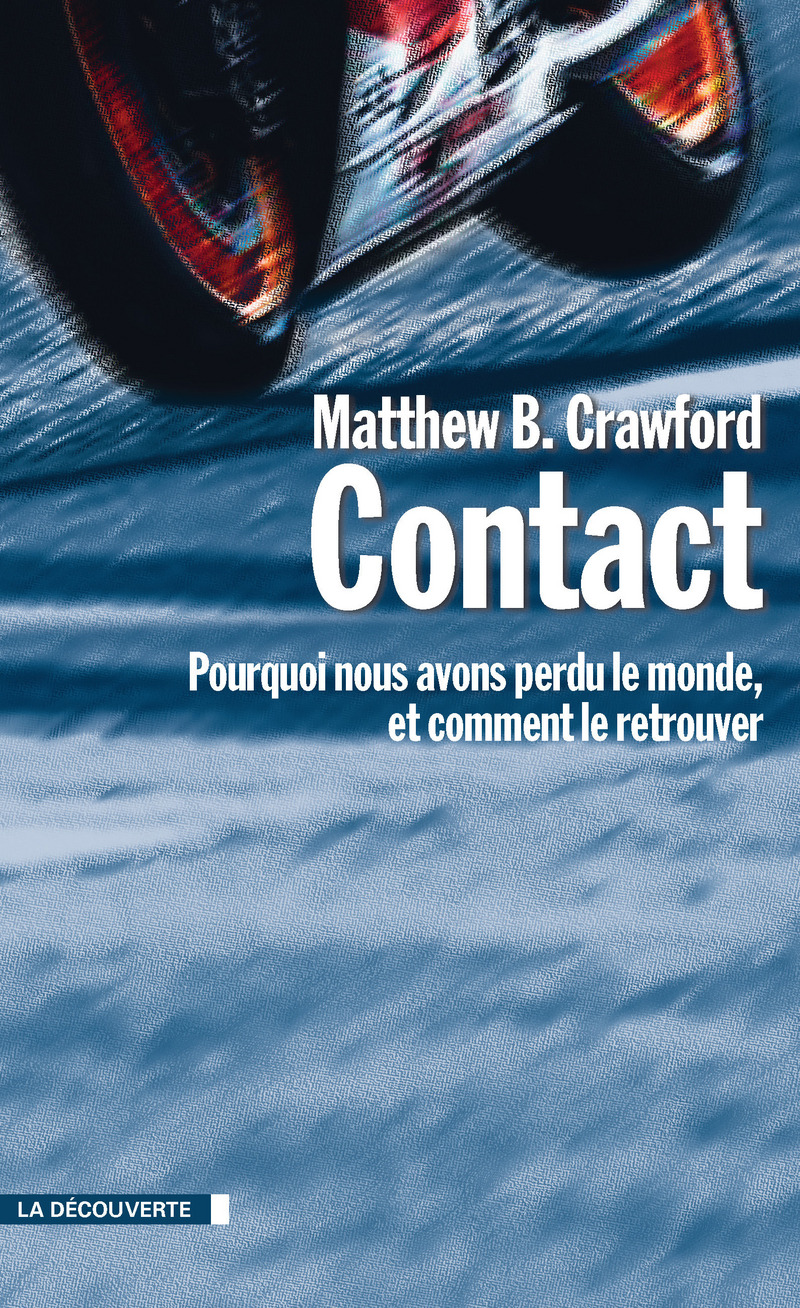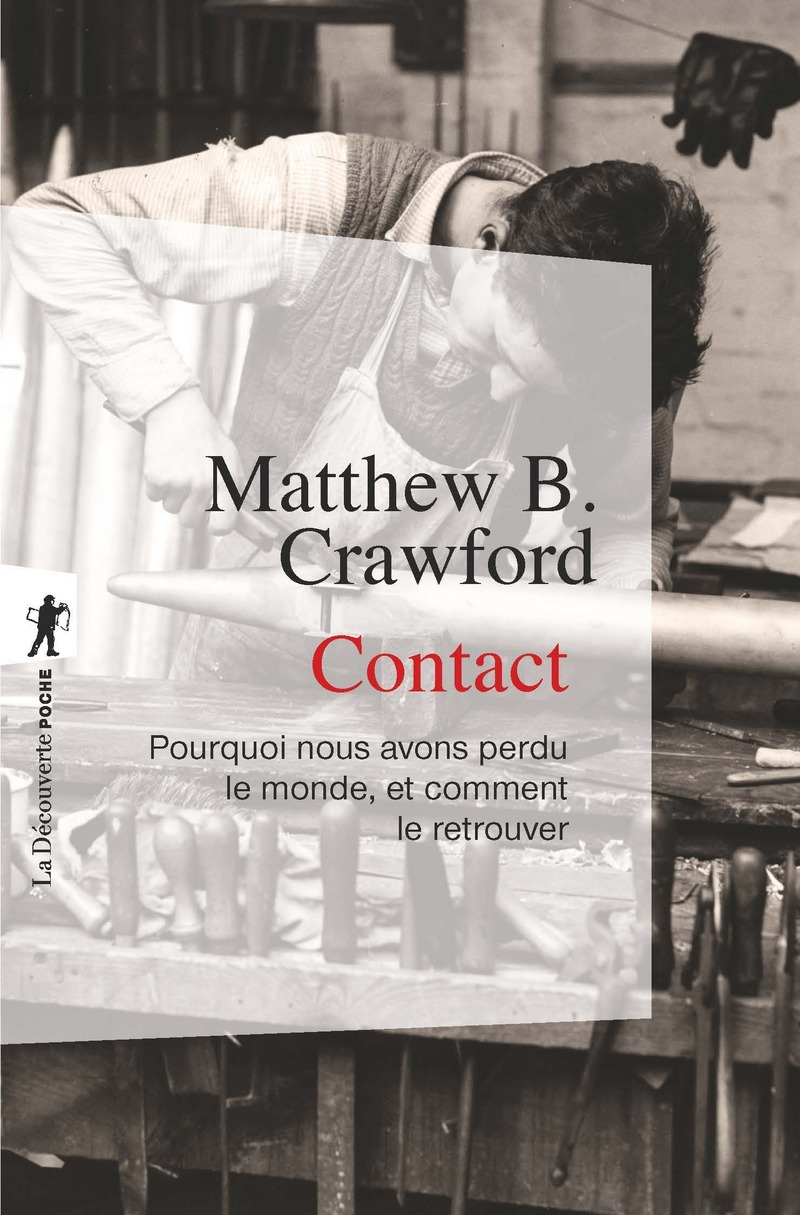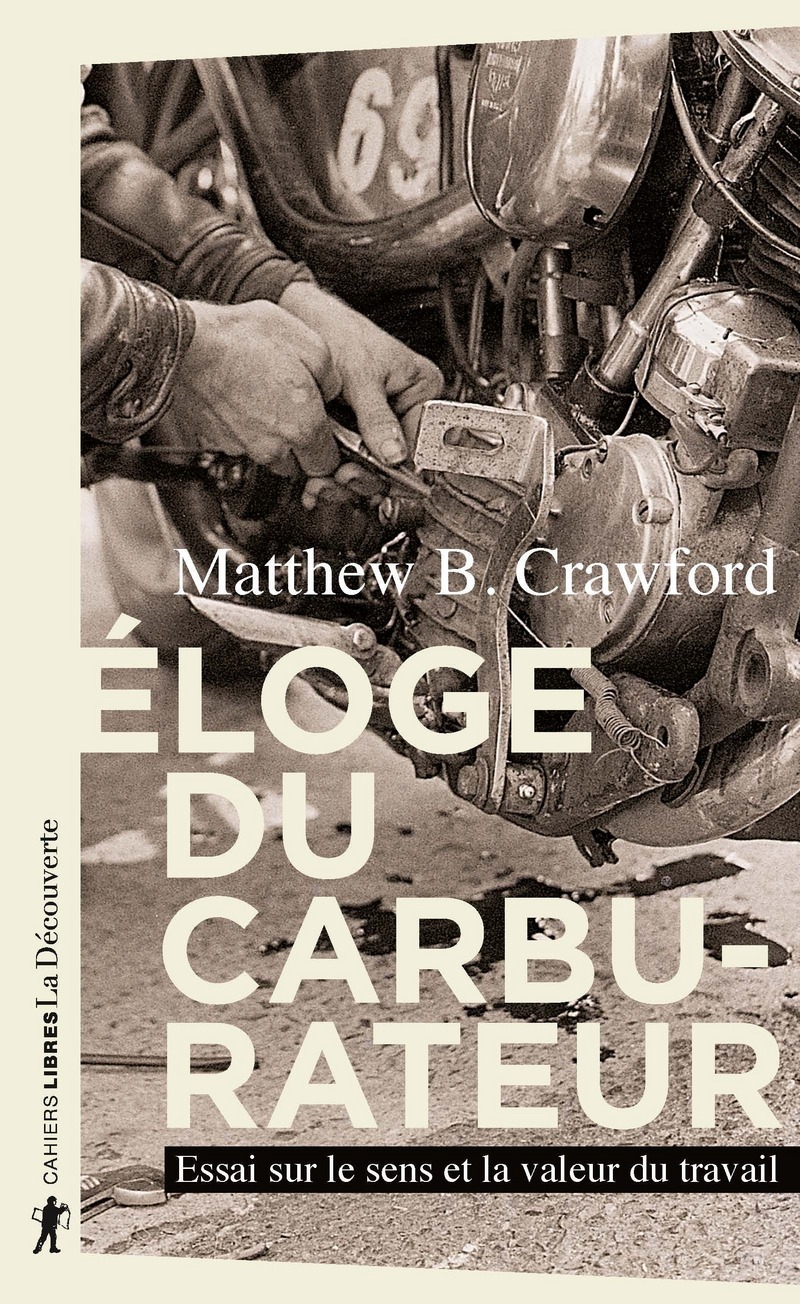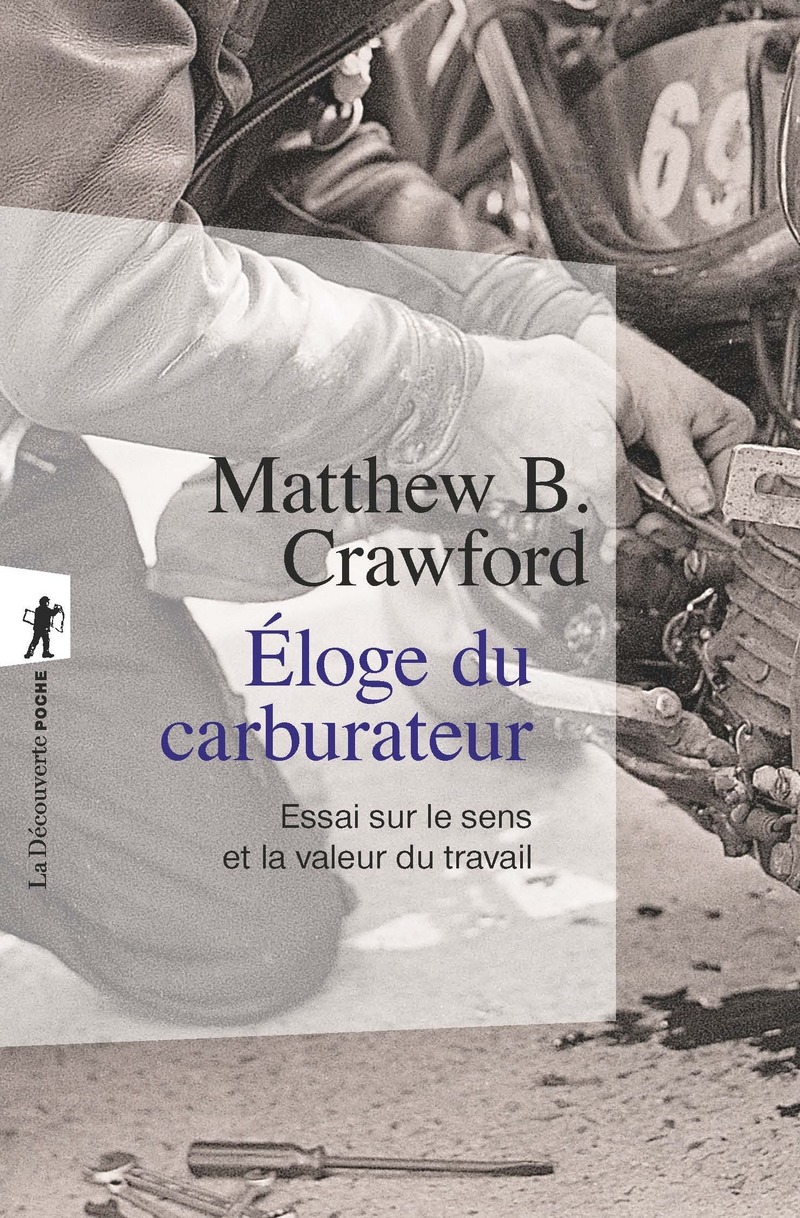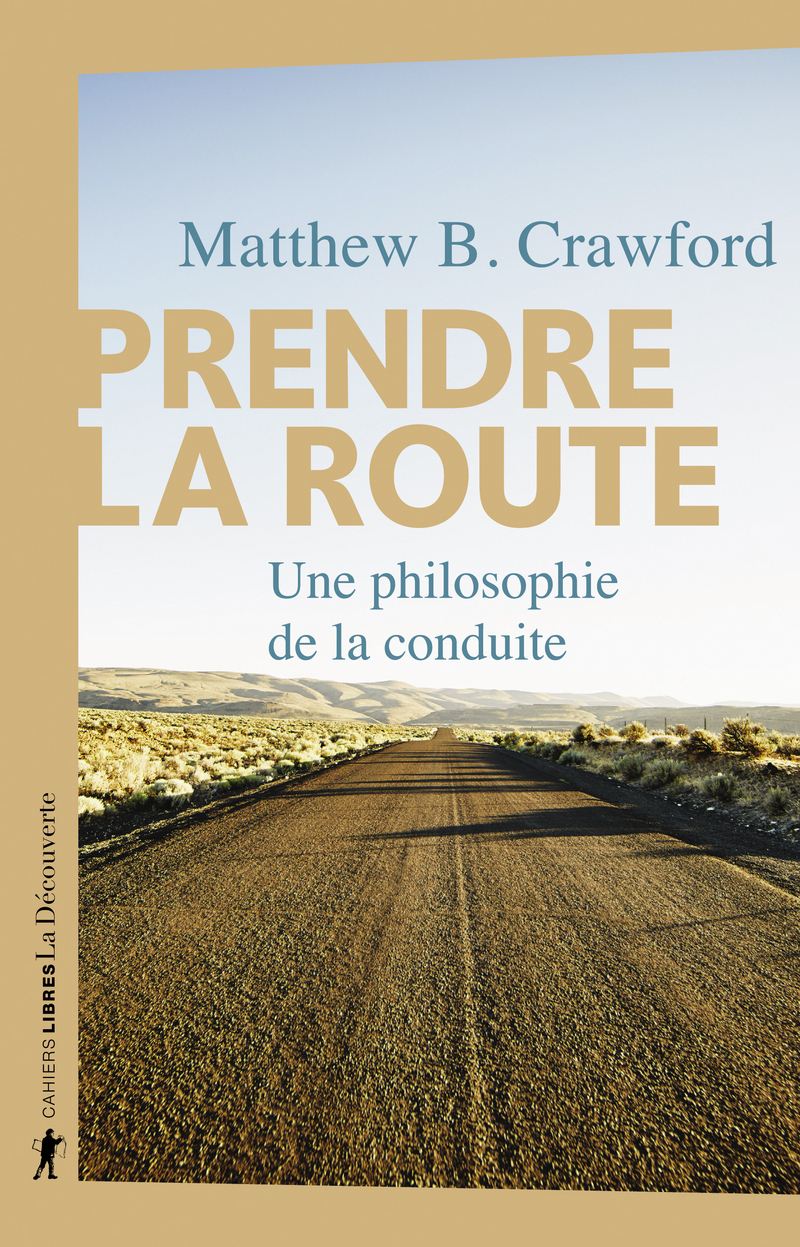Contact
Pourquoi nous avons perdu le monde, et comment le retrouver
Matthew B. Crawford
Après le succès d' Éloge du carburateur, qui mettait en évidence le rôle fondamental du travail manuel, Matthew B. Crawford, philosophe-mécanicien, s'interroge sur la fragmentation de notre vie mentale. Ombres errantes dans la caverne du virtuel, hédonistes abstraits fuyant les aspérités du monde, nous dérivons à la recherche d'un confort désincarné et d'une autonomie infantile qui nous met à la merci des exploiteurs de " temps de cerveau disponible ".
Décrivant l'évolution des dessins animés ou les innovations terrifiantes de l'industrie du jeu à Las Vegas, Matthew B. Crawford illustre par des exemples frappants l'idée que notre civilisation connaît une véritable " crise de l'attention ", qu'il explore sous toutes les coutures et avec humour, recourant aussi bien à l'analyse philosophique qu'à des récits d'expérience vécue. Il met ainsi au jour les racines culturelles d'une conception abstraite et réductrice de la liberté qui facilite la manipulation marchande de nos choix et appauvrit notre rapport au monde.
Puisant chez Descartes, Locke, Kant, Heidegger, James ou Merleau‐Ponty, il revisite avec subtilité les relations entre l'esprit et la chair, la perception et l'action, et montre que les processus mentaux et la virtuosité des cuisiniers, des joueurs de hockey sur glace, des pilotes de course ou des facteurs d'orgues sont des écoles de sagesse et d'épanouissement. Contre un individualisme sans individus authentiques et une prétendue liberté sans puissance d'agir, il plaide avec brio pour un nouvel engagement avec le réel qui prenne en compte le caractère " incarné " de notre existence, et nous réconcilie avec le monde.

Nb de pages : 348
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782348054952
 Matthew B. Crawford
Matthew B. Crawford

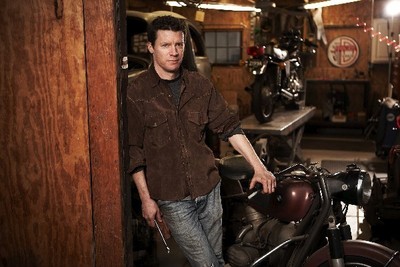
Extraits presse 

2016-02-05 - Laurent Lemire - Livres Hebdo
L'Américain Matthew Crawford est un philosophe original. Du genre à abandonner son emploi universitaire pour s'en aller réparer des motocyclettes, comme il le racontait dans Éloge du carburateur, consacré aux vertus édifiantes du travail manuel. Ce second opus, ambitieux, prend pour point de départ la fragmentation menaçante du moi provoquée par l'actuelle " crise de l'attention ". La faute aux sollicitations technologiques incessante ? Pas exactement. Car si nous voulons vraiment comprendre ce qui nous arrive, argumente Crawford, il nous faut d'abord déconstruire l'idée de l'homme comme volonté libre, autonome, rationnelle, héritée de la philosophie des Lumières, de Locke à Kant. Notre puissance d'agir nous vient moins de notre capacité de délibérer intérieurement et à mettre à distance le réel, que de la possibilité de nous ancrer dans l'expérience vécu via nos compétences pratiques.
2016-02-17 - Philippe Nassif - Philosophie Magazine
Crawford revient à la charge avec Contact, un livre au propos plus ample et ambitieux qui, en s'appuyant sur "certains courants de pensée dissidents de notre tradition philosophique", veut "retrouver le monde" que "nous avons perdu", et donner une "image plus juste de notre rapport au réel et à autrui", afin de "mieux penser la crise contemporaine de l'attention et retrouver certaines possibilités d'épanouissement humain. (...) Matthew B. Crawford, dans une visée clairement affichée comme politique, propose des " instruments tranchants " qui puissent " briser cette chape doctrinale ", afin qu'on retrouve un accès sensible au monde et une " intelligibilité plus immédiate de l'existence ". Des outils aussi efficaces que ceux que " prend en main " un médecin légiste, un électricien ou le mécanicien qui installe de nouveaux joints de fourche sur une Honda Magna V45.
2016-02-25 - Robert Maggiori - Libération
Bref, il s'agit de mettre en place une " écologie de l'attention " qui permette d'aller à la rencontre du monde, tel qu'il est, et de redevenir attentif à soi et aux autres – un véritable antidote au narcissisme et à l'autisme. Est-ce aussi un appel à mettre plus de zen ou de " pleine conscience " dans nos vies, comme le faisait déjà un autre auteur-réparateur de motos, l'Américain Robert Pirsig dans un roman devenu culte, le Traité du zen et l'entretien des motocyclettes ? Non, rétorque Crawford, car l'enjeu n'est pas qu'individuel. Il est foncièrement politique. " L'attention bien sûr, est la chose la plus personnelle qui soit : en temps normal, nous sommes responsables de notre aptitude à la concentration, et c'est nous qui choisissons ce à quoi nous souhaitons prêter attention. Mais l'attention est aussi une ressource, comme l'air que nous respirons, ou l'eau que nous buvons. Leur disponibilité généralisée est au fondement de toutes nos activités. De même, le silence, qui rend possible l'attention et la concentration, est ce qui nous permet de penser. Or, le monde actuel privatise cette ressource, ou la confisque. " La solution ? Faire de l'attention, et du silence, des biens communs. Et revendiquer le droit à " ne pas être interpellé ".
2016-03-05 - Télérama
" Pour ma part, il suffit que le téléviseur soit en vue pour que je n'arrive plus à détacher mes yeux de l'écran. " L'intuition du prochain livre est là : il faut faire attention à l'attention. Car elle est un bien précieux, un bien commun même, une ressource que le capitalisme veut s'accaparer. Et de raconter cette notable et alarmante différence entre les salles d'attente communes et les lounges de première classe : dans ces espaces de confort conçus pour les cadres en voyage, le silence règne, on entend tinter les petites cuillères contre les tasses. Or, de ce silence devenu un luxe découle en partie notre capacité de concentration, dont dépend beaucoup cette chose fragile qu'est l'indépendance de la pensée et du sentiment. Crawford entend démontrer ainsi l'importance d' " une économie politique de l'attention ". (...) Le remède à cet éparpillement intellectuel ? Il réside, on l'aura compris, dans le corps et la moto. Plus précisément dans la prise de conscience qu'on ne peut maîtriser le monde, mais qu'on peut faire corps avec lui, au sens propre. À condition de se laisser absorber par une tâche manuelle ou par la musique ou encore le sport, on quitte ce moi triomphant qui prétend tout choisir et qui se laisse en réalité distraire par des expériences préfabriquées. La grande concentration nous mène ailleurs. " Quand je regarde les musiciens de jazz ou des joueurs de hockey, je vois des êtres qui se sont retirés d'eux-mêmes. " (...) Ayant abandonné toute rencontre avec les aspérités du monde, ne le percevant que comme menace à notre liberté – Crawford glisse ici une critique de la philosophie des Lumières -, nous ne savons plus reconnaître les bienfaits de l'attention, cette faculté qui, précisément " nous rapporte au réel ". A l'opposé, c'est une conception de l'homme situé dans le monde qu'il défend. Paradoxalement, c'est dans notre faculté à nous extraire de nous-mêmes, à nous absorber dans une tâche, que nous sommes pleinement humains.
2016-03-11 - Julie Clarini - Le Monde des Livres
Comme on tente parfois de " reprendre contact " avec d'anciens amis, Matthew B. Crawford nos invite à reprendre contact avec le monde, avec l'idée que nous nous faisons de réel, en dehors duquel nous ne sommes plus que des citoyens tournant en rond dans la nuit, dévorés par le feu.
2016-03-23 - Jean-Marie Durand - Les Inrockuptibles
L'auteur mêle scènes de vie et références philosophiques pour nous inviter à nous opposer à la privatisation des biens communs : air, parole, soin, etc. Pour enfin s'autoriser à penser et vivre. Un livre mené à toue allure, dans lequel le motard vaut comme modèle de " l'homme gyroscopique " : son attention démultipliée lui permet de faire en sorte que sa vie mentale ne soit plus " radicalement exposée à se transformer en ressource exploitable ".
2016-03-25 - L'Humanité
Liberté, égalité : voilà deux piliers qui soutiennent toutes les réflexions politiques de la modernité. À bien y regarder, on remarque une absence étrange : le bonheur. La recherche du bonheur, la quête de l'épanouissement et l'idéal d'une vie bonne, voilà qui parait aujourd'hui parfaitement prosaïque. C'est certainement pour cette raison que le deuxième livre de Matthew B. Crawford, Contact, est si rafraichissant. Critiquant les principes et concepts érigés en étoiles polaires, il pose cette question toute simple : comment, dans le monde actuel, trouver la joie authentique ? Réponse : en retrouvant le monde.
2016-06-03 - Philippe Vion-Dury - Socialter
Vidéos 

L'auteur d'Éloge du carburateur revient en librairie avec Contact
Table des matières 

Avant-propos
Introduction. L'attention comme problème culturel
De l'attention comme bien commun
De l'attention comme pratique ascétique
De l'individualité
À la recherche d'un moi cohérent
Le moi situé
I / À la rencontre du réel
1. Du gabarit au coup de pouce : une écologie de la cognition
Nudge : la théorie du coup de pouce
Des gabarits culturels
Gabarits à louer
2. La perception incarnée
La perception incarnée
Faire de la moto : l'homme gyroscopique
Le rôle du langage et de la connaissance propositionnelle dans l'acquisition des compétences pratiques
3. La réalité virtuelle comme idéal moral
La " Maison de Mickey "
La métaphysique kantienne de la liberté
Le décideur docile
4. Attention et design
Le meilleur modèle du monde, c'est le monde
Zones de portée et représentations
5. Quand le capitalisme encourage l'autisme, ou comment stimuler l'addiction au jeu
Une ingénierie de l'addiction
Pulsion de mort
La réponse des libertariens
Interlude
Une brève histoire de la liberté
Les origines contrefactuelles du libéralisme
La liberté comme responsabilité individuelle
La vérité comme représentation
II / Nous et les autres
6. Savoir sortir de soi
Quand l'obéissance est source de puissance
Attention et coopération chez les maîtres verriers
La découverte scientifique en tant qu'expérience personnelle
L'éducation libérale en tant que forme d'apprentissage
7. Nous ne sommes pas seuls au monde
Des affordances à l'outillage
De l'attention conjointe
Qu'en est-il de l'individualité ?
8. La conquête de l'individualité
La confrontation comme source de justification
Le problème du dissident
Sur le " qui " et le " quoi " de la justification des normes
9. La culture de la performance
La culture de la performance
Mobilité sociale et condition démocratique
Les usages du conflit
Au-delà de la liberté
10. Une érotique de l'attention
Trouver ou construire : entre l'attention et l'imagination
Agir ou ruminer
Autodéfense
11. Le nivellement
Le subjectivisme
Chacun est tout le monde
Devenir un tiers à soi-même
12. Le moi statistique
La " fabrique de l'Américain moyen "
Le moi empilable
L'individualité, c'est du passé
Voir au-delà du présent
III / Héritage
13. L'atelier du facteur d'orgues
Taylor and Boody
L'entrepreneur
La guerre des orgues
" L'électricité est là pour longtemps "
Les Anciens et les Modernes
Corroyage, limage et tempéraments
Le patron
" Je n'ai rien à voir avec l'Organ Historical Society "
L'harmoniste
La dialectique de la tradition
Épilogue. Retour vers le réel
Ce que j'ai voulu dire
Retour vers le réel
Pour une démocratie sans nivellement
Savoir sortir de soi : reprise
Remerciements.