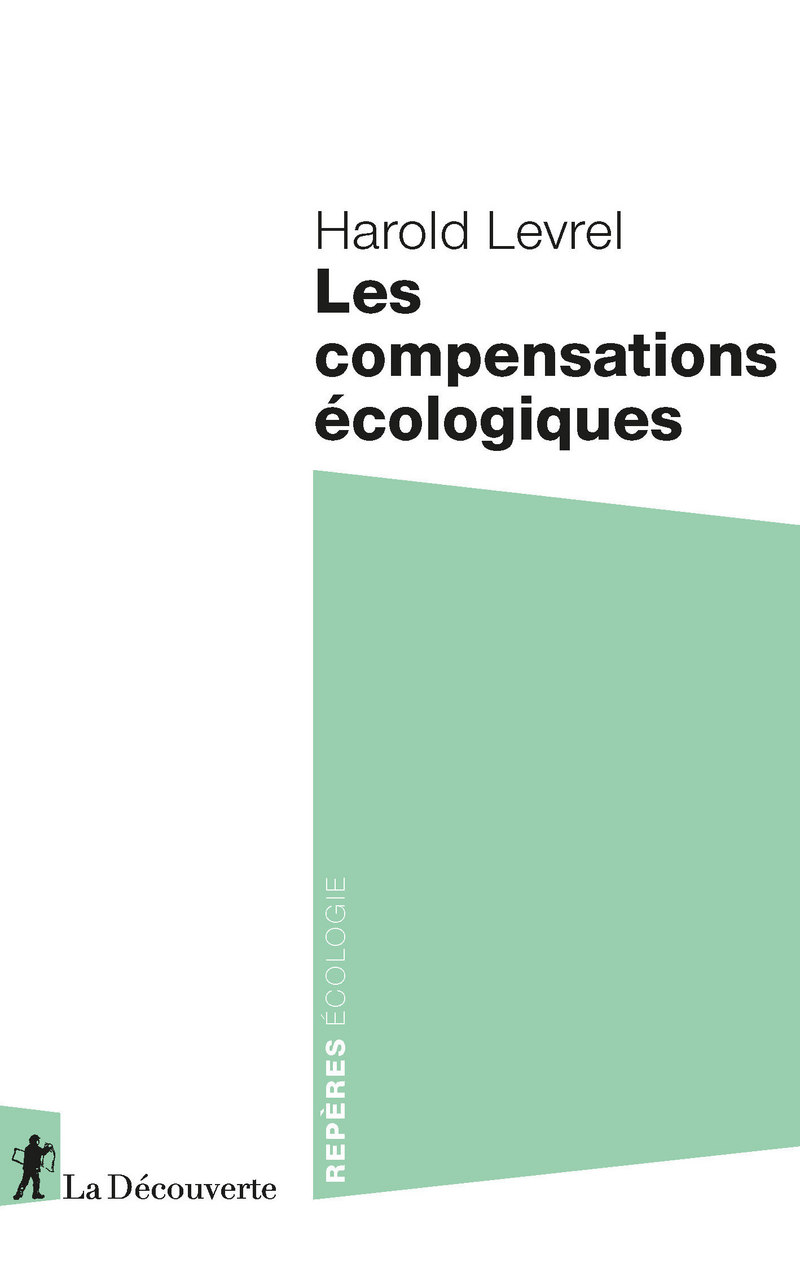Les compensations écologiques
Harold Levrel
La compensation est l'un des plus anciens dispositifs utilisés pour réparer un préjudice subi par une personne, dans l'objectif de recouvrer un certain équilibre au sein d'une structure sociale. Depuis les années 1970, les compensations écologiques étendent ce mécanisme aux espèces et habitats naturels dans le cadre des lois relatives aux études d'impact et au préjudice écologique. La " neutralité écologique " que ces compensations sont censées permettre d'obtenir appelle toutefois un diagnostic critique concernant la portée et les limites de cet outil.
Pour ce faire, cet ouvrage décrit les contextes institutionnels dans lesquels les compensations écologiques sont mobilisées et les ruptures historiques qu'elles induisent ; les principes éthiques et les logiques économiques sur lesquels elles reposent ; les acteurs et les formes organisationnelles permettant d'en définir les modalités de mise en œuvre ; la faisabilité des actions de restauration écologique et les critères d'équivalence qui s'y rapportent ; enfin, les outils juridiques et d'évaluation qui en facilitent la réalisation.

Nb de pages : 126
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782348065354
 Harold Levrel
Harold Levrel

Extraits presse 

2020-11-20 - Marie Bellan - Les Echos
Dans ce petit ouvrage précis et passionnant, Harold Levrel, économiste de l'environnement, nous éclaire sur l'histoire et les modalités des compensations des préjudices que l'homme fait subir à la nature. [...] L'auteur traite de l'histoire et des fondements théoriques de la compensation écologique, des difficultés méthodologiques de son évaluation, des réalités de sa mise en œuvre. Elles peuvent être un instrument très efficace pour lutter contre l'artificialisation des sols et la destruction de la nature. Mais adoptées dans un contexte où la réglementation environnementale est insuffisante ou inappliquée, comme en France, " elles resteront des sources de dérogations indûment octroyées en matière d'impact sur la nature ".
2021-04-01 - Antoine de Ravignan - Alternatives Économiques
Table des matières 

Introduction
I / Paysage institutionnel des compensations écologiques
Typologie des compensations écologiques
Les compensations dans le cadre des lois sur la responsabilité environnementale et le préjudice écologique
Les compensations écologiques liées aux études d'impact
Les compensations écologiques comme un processus de marchandisation et de fourniture de droits à détruire ?
II / Les principaux acteurs des compensations écologiques
Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureaux d'études en ingénierie écologique
Les administrations, les services déconcentrés de l'État et les établissements publics
Organismes privés ayant des missions d'intérêt public
Les agriculteurs au cœur des compensations écologiques
Des juges et des préfets encore peu enclins à appliquer des sanctions dissuasives
Les acteurs en charge de défendre les intérêts de la nature et le patrimoine collectif qu'elle représente
III / Des compensations économiques aux compensations écologiques
Le principe des compensations économiques du dommage environnemental
L'évaluation monétaire des dommages accidentels et la prise en compte des valeurs non marchandes dans la compensation : l'exemple des marées noires
Des compensations économiques aux compensations écologiques dans le cadre des dommages accidentels
Les fondements éthiques des référentiels normatifs pour les compensations écologiques
IV / Les compensations écologiques pour les dommages autorisés
Une histoire des compensations écologiques pour les dommages autorisés aux États-Unis
Une histoire des compensations écologiques pour les dommages autorisés en France
V / Définir les frontières des compensations écologiques à partir de la faisabilité des actions de restauration
Typologie des actions de compensation écologique
Les taux de succès des actions de restauration et les conséquences opérationnelles pour les compensations écologiques
Quels référentiels pour fixer des objectifs d'équivalence aux compensations écologiques ?
VI / Les formes organisationnelles des compensations écologiques
La mise en œuvre des compensations écologiques par le porteur de projet
Les banques de compensation
Les rémunérations de remplacement
VII / Les grands principes des compensations visant la neutralité écologique
Où en est-on de l'équivalence écologique et de l'absence de perte nette de biodiversité ?
Une tension entre la proximité spatiale et la taille des projets de compensation
La minimisation des pertes temporelles : une tension entre temps économique et temps écologique
Le non-respect du principe d'additionnalité des mesures compensatoires
VIII / Les outils de mise en œuvre des compensations écologiques
Les instruments juridiques de maîtrise du foncier et de pérennisation des pratiques favorables à la biodiversité
Les outils d'évaluation de l'équivalence écologique
L'évaluation des coûts des compensations écologiques
Conclusion
Repères bibliographiques.