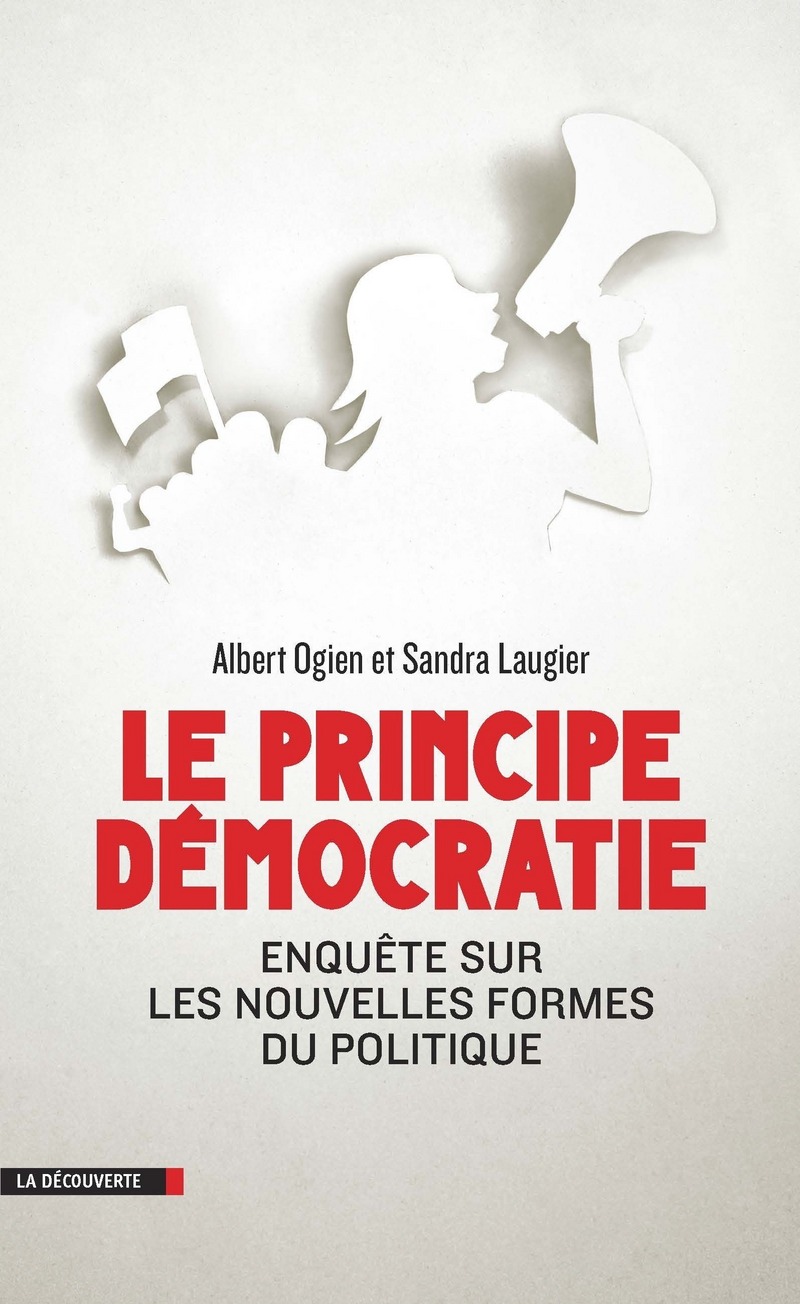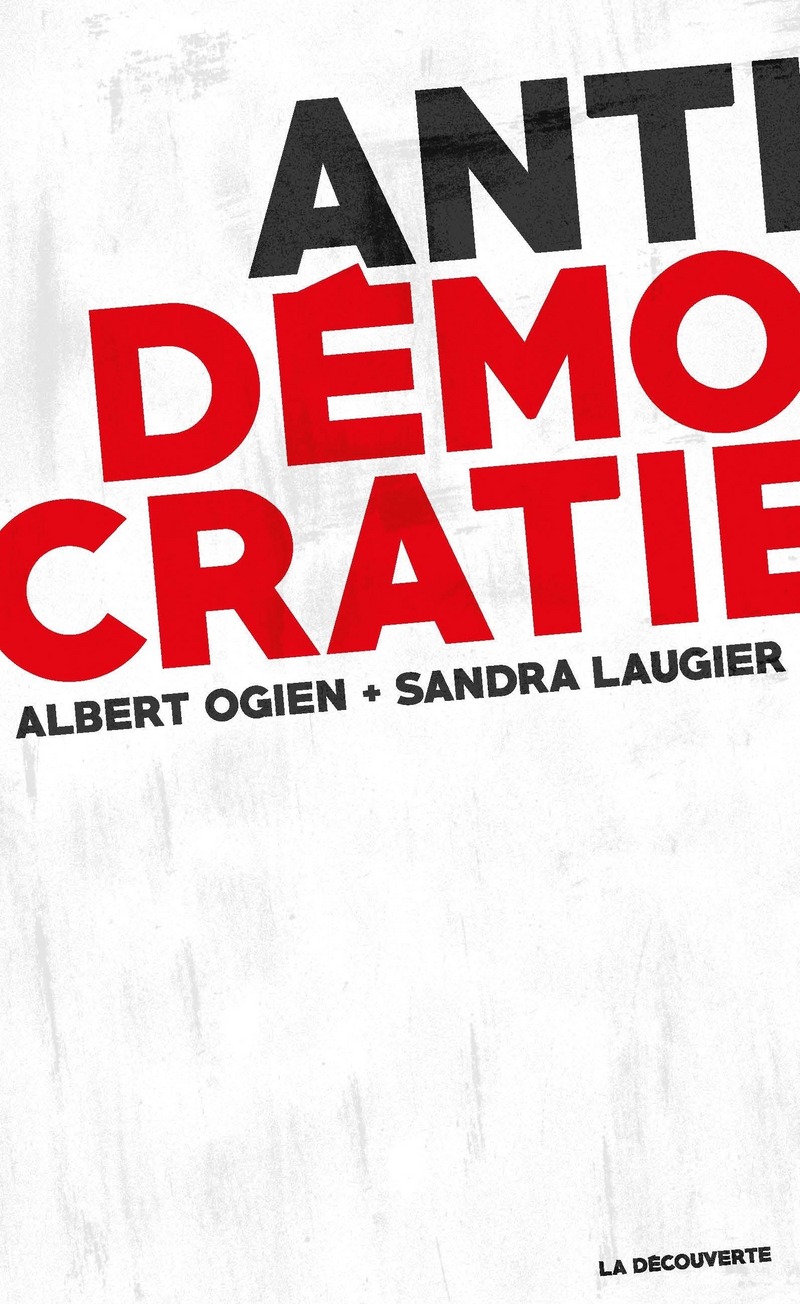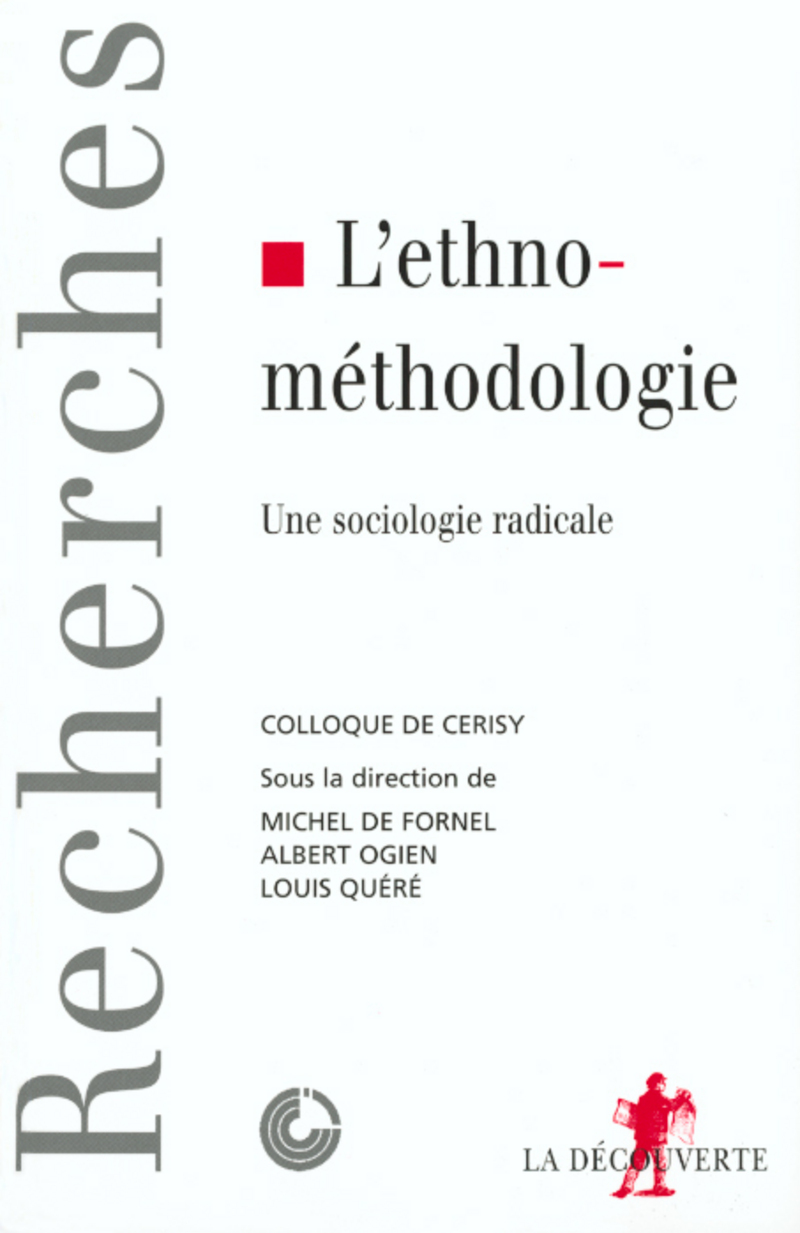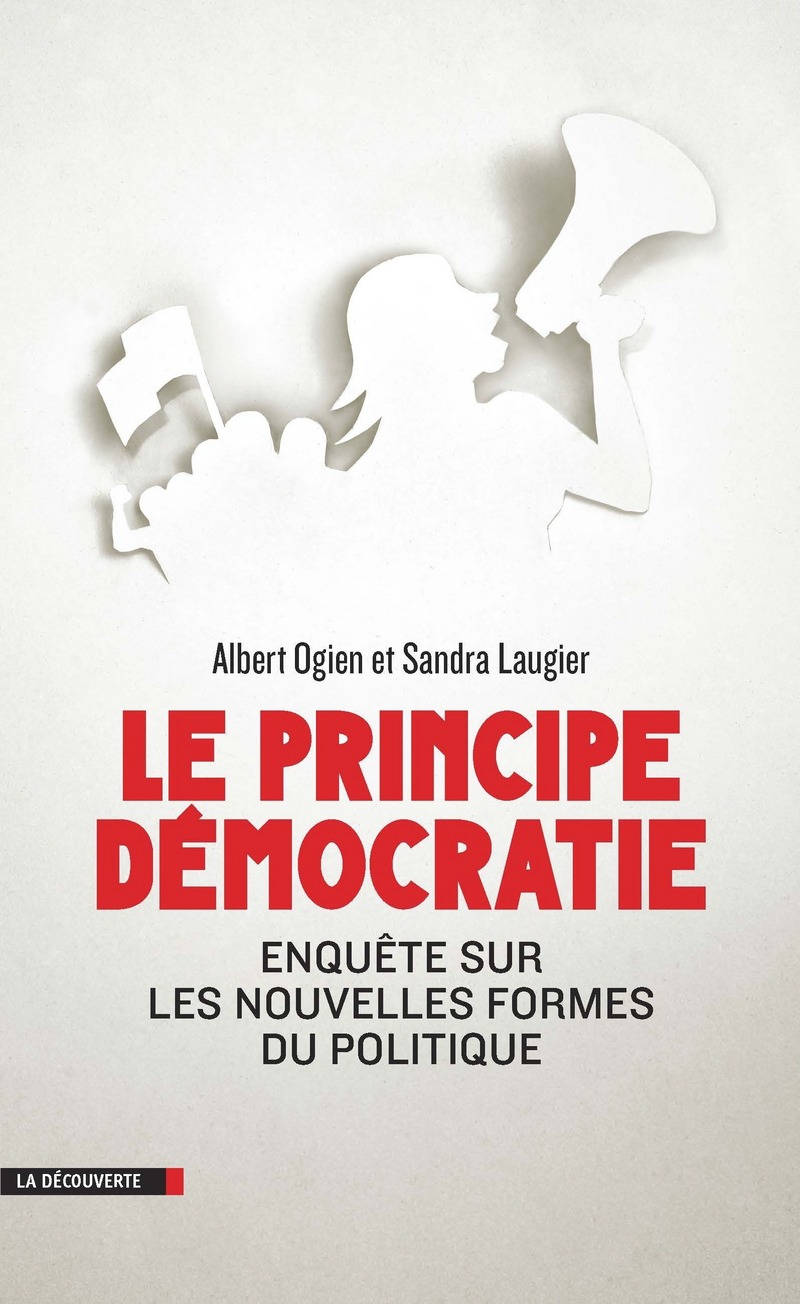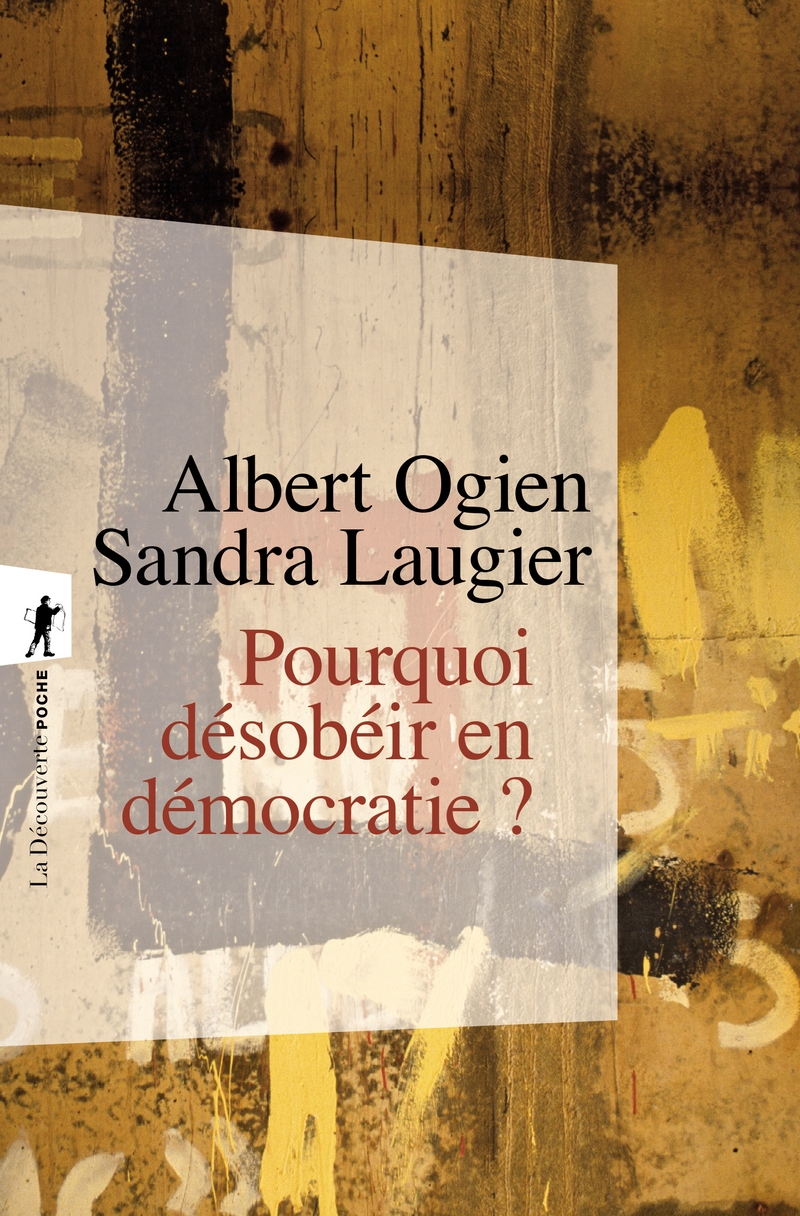Le principe démocratie
Enquête sur les nouvelles formes du politique
Albert Ogien, Sandra Laugier
Le monde est entré, depuis quelques années, dans une période d'effervescence politique. Rassemblements et occupations, contestations des pouvoirs, mobilisations transnationales, insurrections civiles, activisme informatique, désobéissance civile, création de nouveaux partis : ces mouvements expriment certes un mécontentement, un sentiment d'injustice, de colère et de désespoir. Mais ils révèlent aussi la volonté des citoyens de s'organiser pour contrôler directement ce que font leurs dirigeants. Dans leur précédent ouvrage, Pourquoi désobéir en démocratie ?, les deux auteurs analysaient la multiplication des actes de désobéissance civile en régime démocratique. Dans ce nouveau livre, ils scrutent, d'un double point de vue sociologique et philosophique, cette extension du domaine de la désobéissance en examinant les nouveaux mouvements de protestation, les révoltes contre les dictatures, et les mobilisations globales revendiquant la " démocratie réelle ".
Ce livre dessine ainsi les contours de ces manières d'agir qui traduisent une nouvelle forme de vie politique et morale, où la question du " comment " remplace celle du " pourquoi ". Il approche cette transformation en étudiant ces formes émergentes et pragmatiques du politique qui prennent la démocratie pour principe afin d'élargir la sphère du politique, le pouvoir des citoyens, les capacités de tous.

 Albert Ogien
Albert Ogien


 Sandra Laugier
Sandra Laugier


Extraits presse 

2014-06-01 - Le journal du CNRS
Le titre pourrait prêter à confusion, il ne s'agit pas d'une formulation plus ou moins métaphysique d'un idéal politique, mais, au contraire, d'une stimulante enquête sociologique et philosophique sur les mouvements de contestations, de luttes, de désobéissance civile qui, notamment depuis 2011, contaminent une partie de la planète - de la place Tahir à Occupy Wall Street, en passant par l'Amérique du Sud ou Notre-Dame-des-Landes. Le tout est orienté par une double et convaincante intuition. D'une part, si ces mouvements sont souvent décriés comme naïfs, improductifs ou limités, c'est qu'ils engagent une redéfinition même du cadre de référence - actuellement, "pouvoirs + partis + urnes" - à travers lequel nous envisageons la chose politique. D'autre part, ces mouvements apparaissent comme le creuset où s'expérimentent les formes majoritaires du politique à venir, une exigence de reconnaissance et d'autonomie, une convergence entre expression de soi et expression populaire. Moins un système donc, qu'un genre de "boîte à outils" - d'où l'on pourra tirer des concepts comme le "care" ou l'"empowerment" - a l'usage d'un nouveau "romantisme réaliste" animé par la certitude que la démocratie est toujours à recommencer.
2014-09-01 - Philippe Nassif - Philosophie magazine
Sandra Laugier et Albert Ogien prennent l'habitude, non dénuée d'intérêt pour nous, d'enquêter sur des pratiques politiques souvent laissées dans l'ombre. Après la désobéissance civile, objet d'un précédent ouvrage, ils se saisissent, avec Le Principe démocratie, des mouvements de protestation qui ont germé dans le sillage des révolutions arabes. Ils posent qu'il existe, entre eux, des traits communs et que cet air de famille exprime autre chose que la viralité des tech niques de lutte à l'heure d'Internet. Si le livre est parfois discutable, toujours stimulant – quelquefois répétitif –, il pointe parfaitement l'exigence de " démocratie réelle " au cœur de ces mouvements, cette exigence d'une réalisation effective des promesses démocratiques qui porte la marque d'une sensibilité nouvelle, au ras de la vie ordinaire et de ses indignations dans le respect de la capacité de chacun à décider. Ce nouveau rapport au politique se double d'une grande indifférence à la prise de pouvoir comme à la vie politique orchestrée par les institutions. Autant dire, une fois rappelé leur refus de la violence et de tout projet programmatique, que ces contestations, dont les traits majeurs se trouvent ici saisis et décryptés, ont des destins politiques divers. Avant-garde insurrectionnelle comme à Kiev, en Ukraine ou, plus souvent, crises sporadiques et tolérées dont l'influence se fera sentir, comme le pensent les auteurs, sur le temps long des sociétés ?
2014-09-05 - Julie Clarini - Le Monde des livres
De Kiev, cet hiver, aux révolutions arabes en 2011, en passant par les Indignés à Madrid ou le mouvement Occupy Wall Street à New York, la rue est-elle devenue une contre-arène politique alors que les électeurs désertent de plus en plus l'exercice électoral et restent perplexes devant les actuels jeux du pouvoir ? Pour la philosophe Sandra Laugier, professeure à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, membre de la direction scientifique du CNRS et le sociologue Albert Ogien, directeur de recherche au CNRS, de nouvelles pratiques ont vu le jour dans ces mobilisations, en dehors du cadre classique des partis. Dans le Principe démocratie, qu'ils viennent de publier, ils essaient de rendre légitimes ces tentatives de rénovation démocratique. Ces mouvements contredisent les discours déclinistes sur une dépolitisation généralisée.
2014-09-06 - Cécile Daumas - Libération
En 2011, le monde est entré dans une période d'effervescence politique. Au "dégage", scandé en Tunisie et en Egypte ont fait écho le "Y en a marre" de Dakar, le "Nous existons" des Russes et le "Nous sommes tous des manchots" à Istanbul. Ces mouvements se sont crées hors des institutions politiques en place. Les auteurs du livre, un sociologue et une philosophe scrutent les contours de ces nouvelles revendications, aspirations et stratégies de luttes qui se dessinent dans le monde. Plutôt optimiste, ce qui est assez rare pour être souligné, le livre, sans prétendre dégager de nouvelles perspectives sur un temps si court, se termine sur la relation positive d'expériences de démocratie directe et la revendication d'un romantisme réaliste.
2015-01-01 - Silence
Table des matières 

Introduction - La démocratie comme forme de vie
I / Le monde change, les formes du politique aussi
1. 1968, 1989, 2011
2. Dynamique du politique
II / Politique du pourquoi, politique du comment
3. Le motif de la démocratie
4. Oublier la nostalgie
III / Politiques de l'ordinaire
5. Le politique décentré
6. Le
care comme outil de démocratie
7. L'attention au particulier
8. Le souci du détail
IV / La liberté de faire
9. Les conditions de la dignité
10. La force de la rue
V / Vouloir la démocratie
11. La démocratie directe n'est plus ce qu'elle était
12. La revendication comme romantisme réaliste
Conclusion - Demain, le politique.