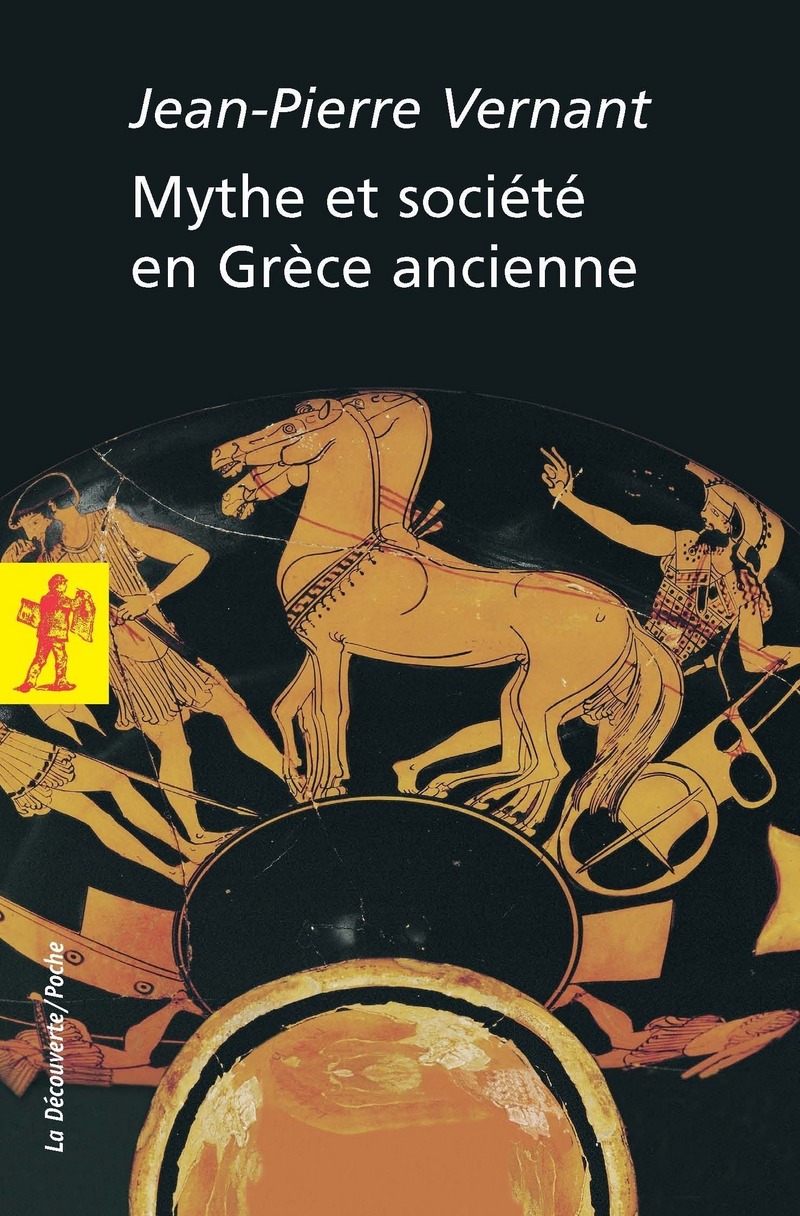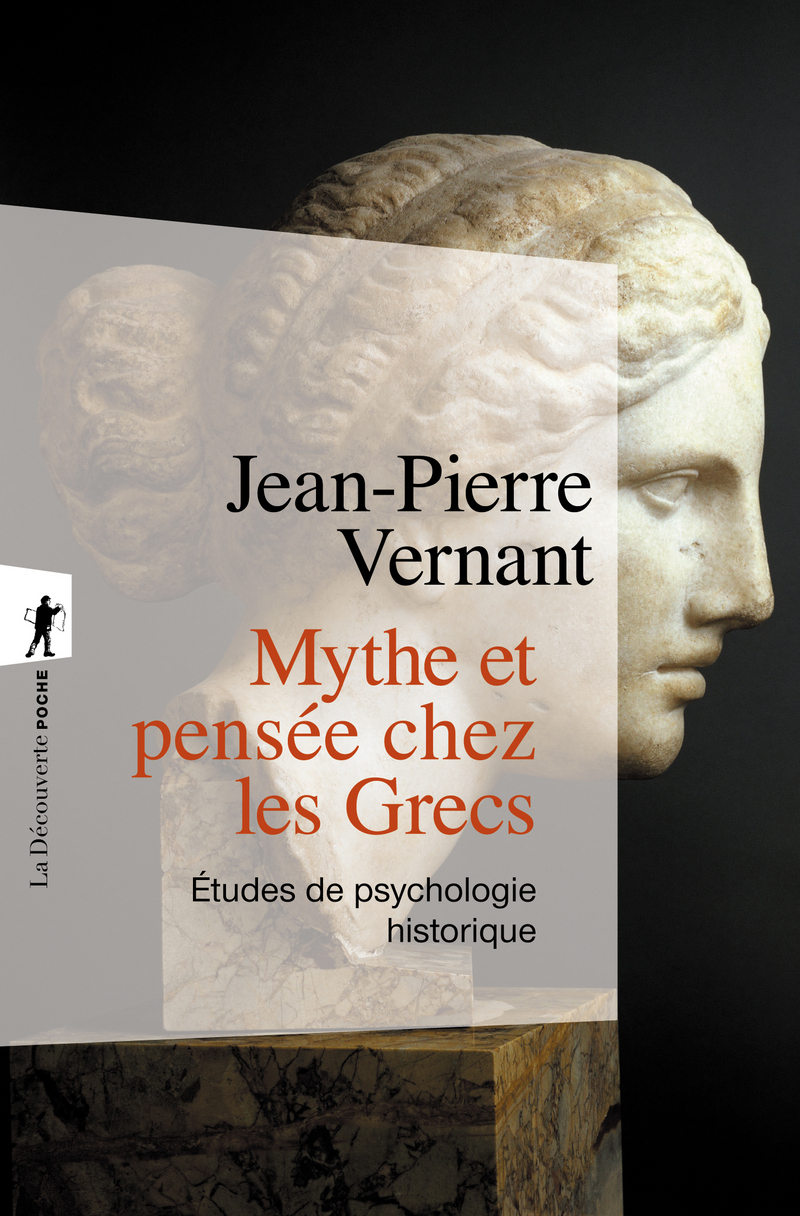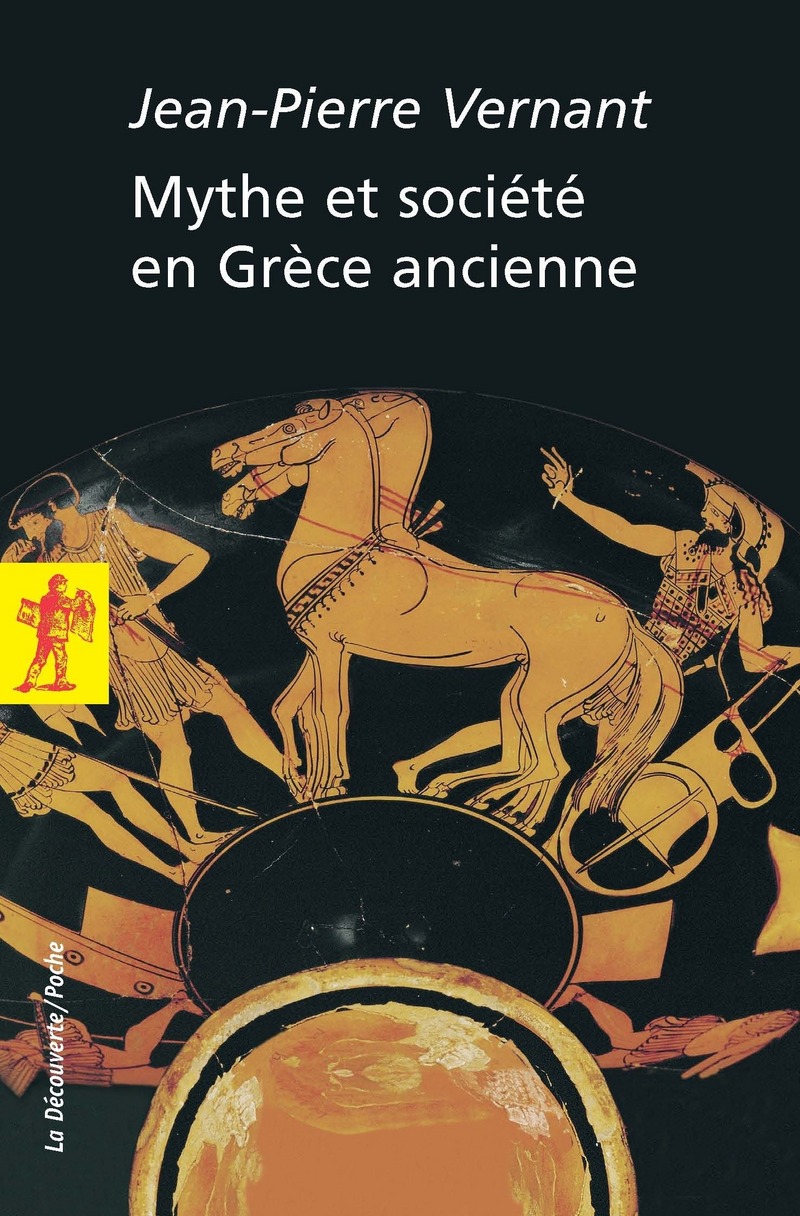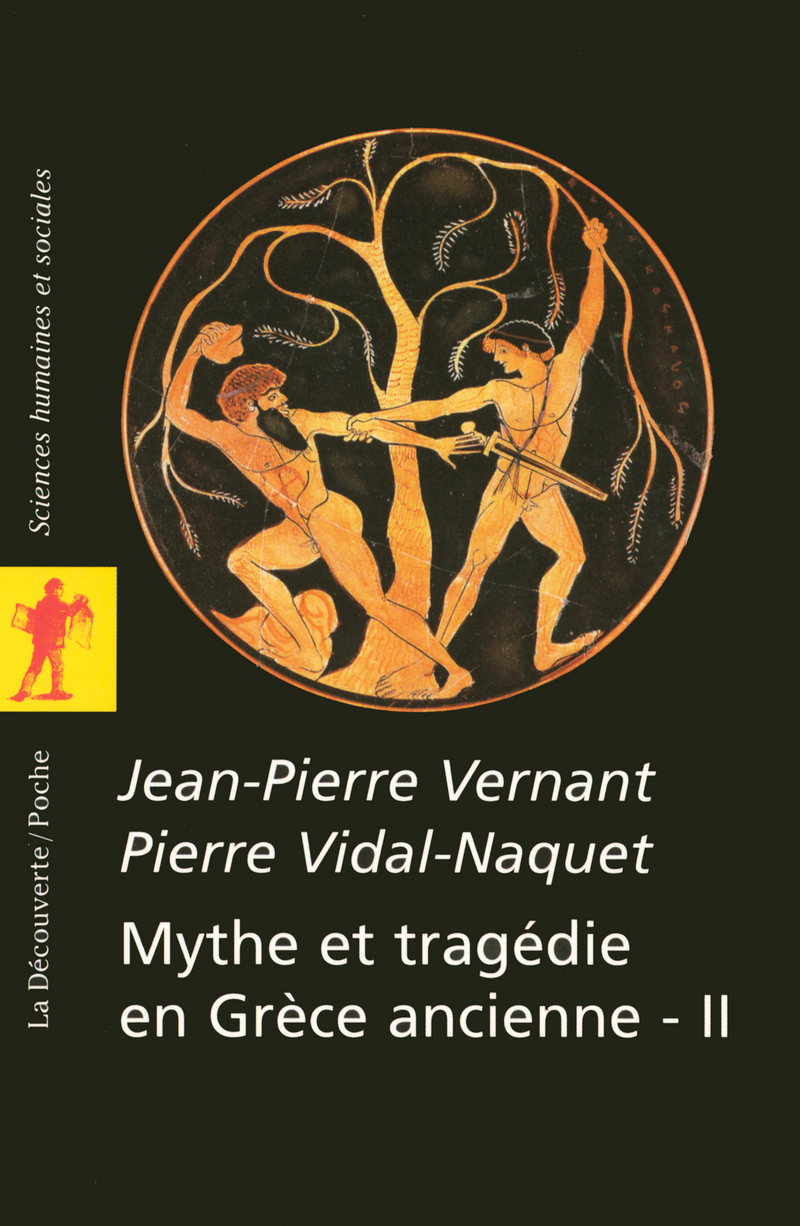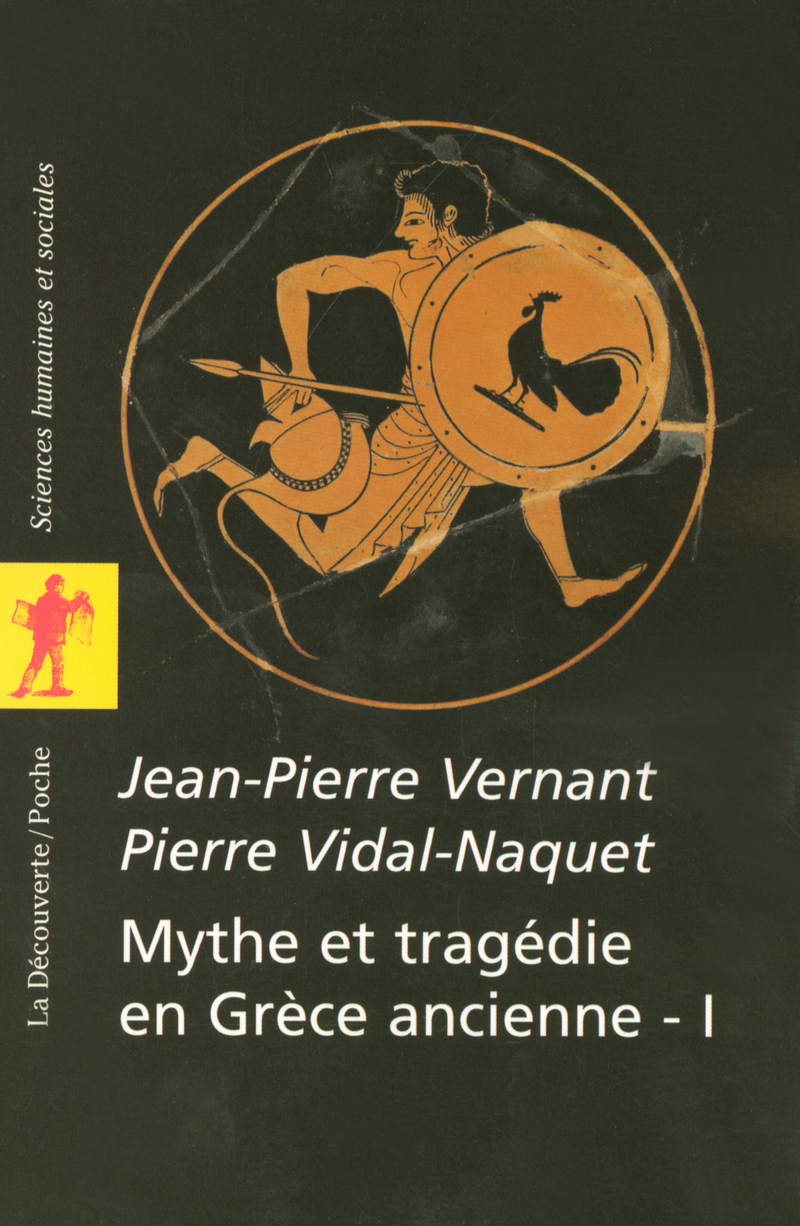Mythe et société en Grèce ancienne
Jean-Pierre Vernant
Le mythe ne se définit pas seulement par sa polysémie, par l'emboîtement des différents codes les uns dans les autres. Entre les termes mêmes qu'il distingue ou qu'il oppose dans son armature catégorielle, il ménage dans le déroulement narratif et dans le découpage des champs sémantiques des passages, des glissements, des tensions, des oscillations, comme si les termes, tout en s'excluant, s'impliquaient aussi d'une certaine façon. Le mythe met donc en jeu une forme de logique qu'on peut appeler, en contraste avec la logique de non-contradiction des philosophes, une logique de l'ambigu, de l'équivoque, de la polarité. Quel est d'autre part le lien entre le cadre intellectuel dégagé par l'analyse structurale et le contexte socio-historique où le mythe a été produit ? Comment s'articulent, dans le travail concret de déchiffrement, une recherche en synchronie où chaque élément s'explique par l'ensemble de ses relations au système et une enquête en diachronie où les éléments, insérés dans des séries temporelles, s'expliquent par leurs rapports à ceux qui les ont précédés dans les séquences ainsi définies ? La réponse consisterait sans doute à montrer que, pas plus dans l'enquête historique que dans l'analyse en synchronie, on ne rencontre d'éléments isolés, mais toujours des structures, liées plus ou moins fortement à d'autres, et que les séries temporelles concernent des remaniements, plus ou moins étendus, de structures au sein de ces mêmes systèmes que vise l'étude structurale.

Parution : 25/06/2020
Format : EPub
 Jean-Pierre Vernant
Jean-Pierre Vernant

Jean-Pierre Vernant (1914-2007), hélléniste, fondateur du Centre Louis-Gernet, a été professeur au Collège de France. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages sur l'Antiquité dont, aux Éditions La Découverte, Mythe et pensée chez les Grecs et, avec Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne.
Table des matières 

Introduction
La lutte des classes
La guerre des cités
Le mariage
Histoire sociale et évolution des idées en Chine et en Grèce du VIe siècle avant notre ère
I / En Chine
II / En Grèce
La société des dieux
Le pur et l'impur
Entre bêtes et dieux
Le mythe prométhéen chez Hésiode
II / Second niveau : analyse des contenus sémantiques
III / Troisième niveau : le contexte socio-culturel
Raisons du mythe
I / Muthos et logos
A. Parole et écriture
B. Du mythe à l'histoire et à la philosophie
C. Formes et niveaux du mythe
D. Mythes et mythologie
E. Le mythe entre le non-sens et l'allégorie
F. Mythologie grecque et pensée occidentale
II / Ébauche d'une science des mythes
A. Mythe et langage : l'école de mythologie comparée
B. Mythe et évolution sociale : l'école anthropologique anglaise
C. - Mythe et histoire littéraire : la philologie historique
D. L'horizon intellectuel des recherches sur le mythe
III / Le mythe aujourd'hui
A. Symbolisme et fonctionnalisme
B. Approche nouvelle : de M. Mauss à G. Dumézil
C. Le structuralisme de Cl.Lévi Strauss
IV / Lectures et problèmes du mythe.