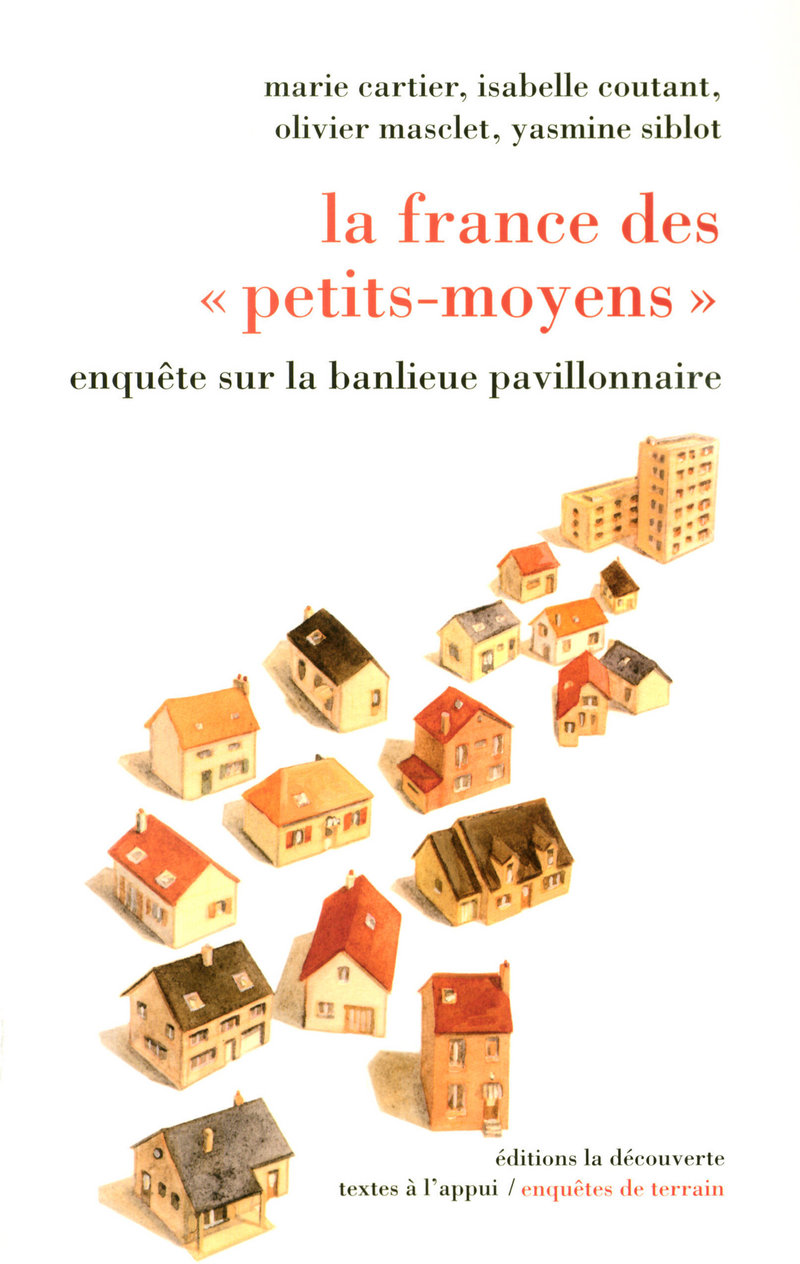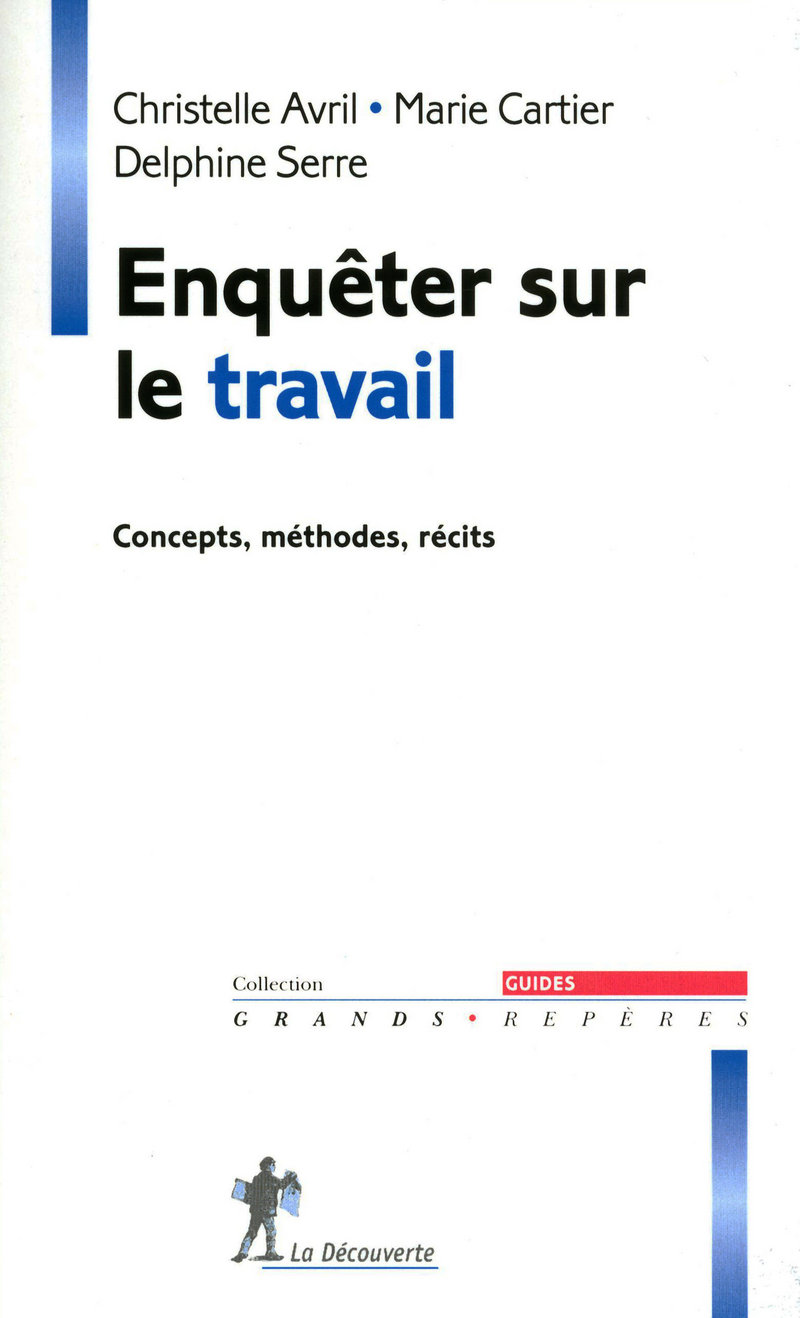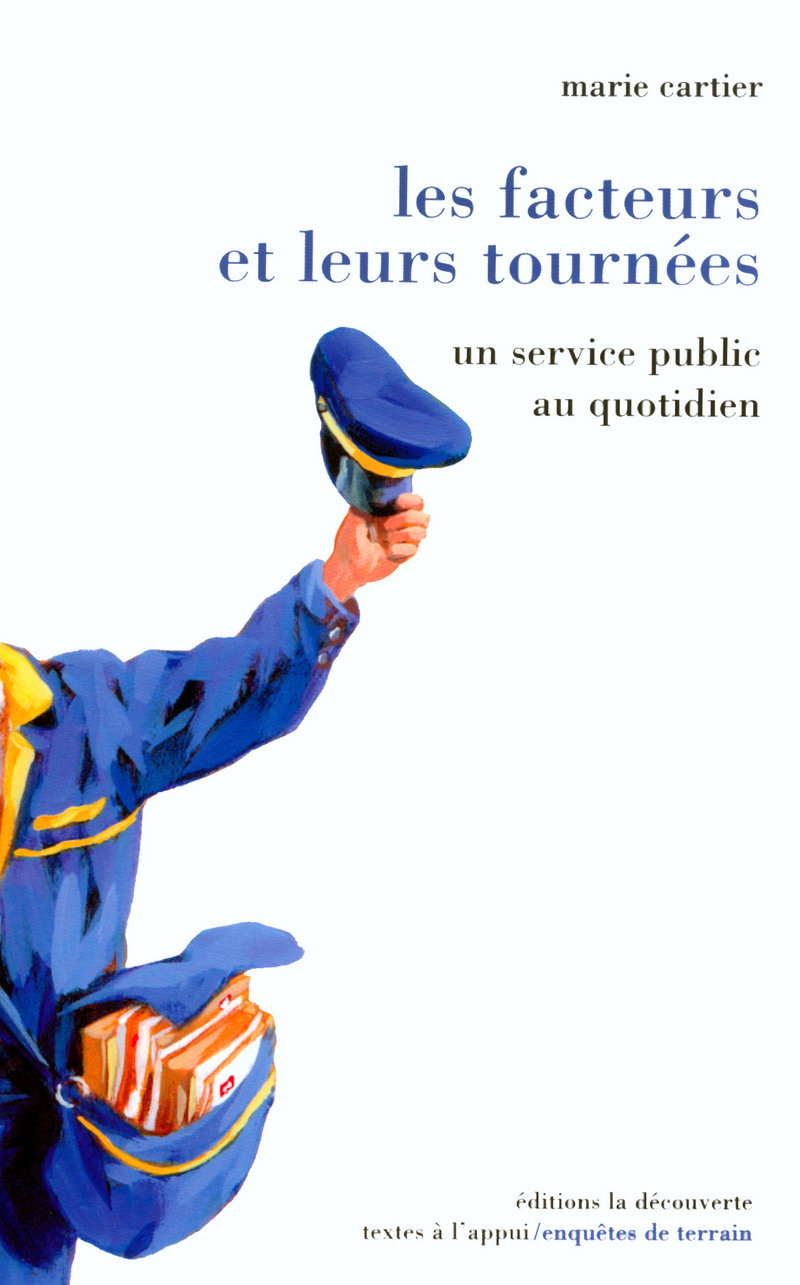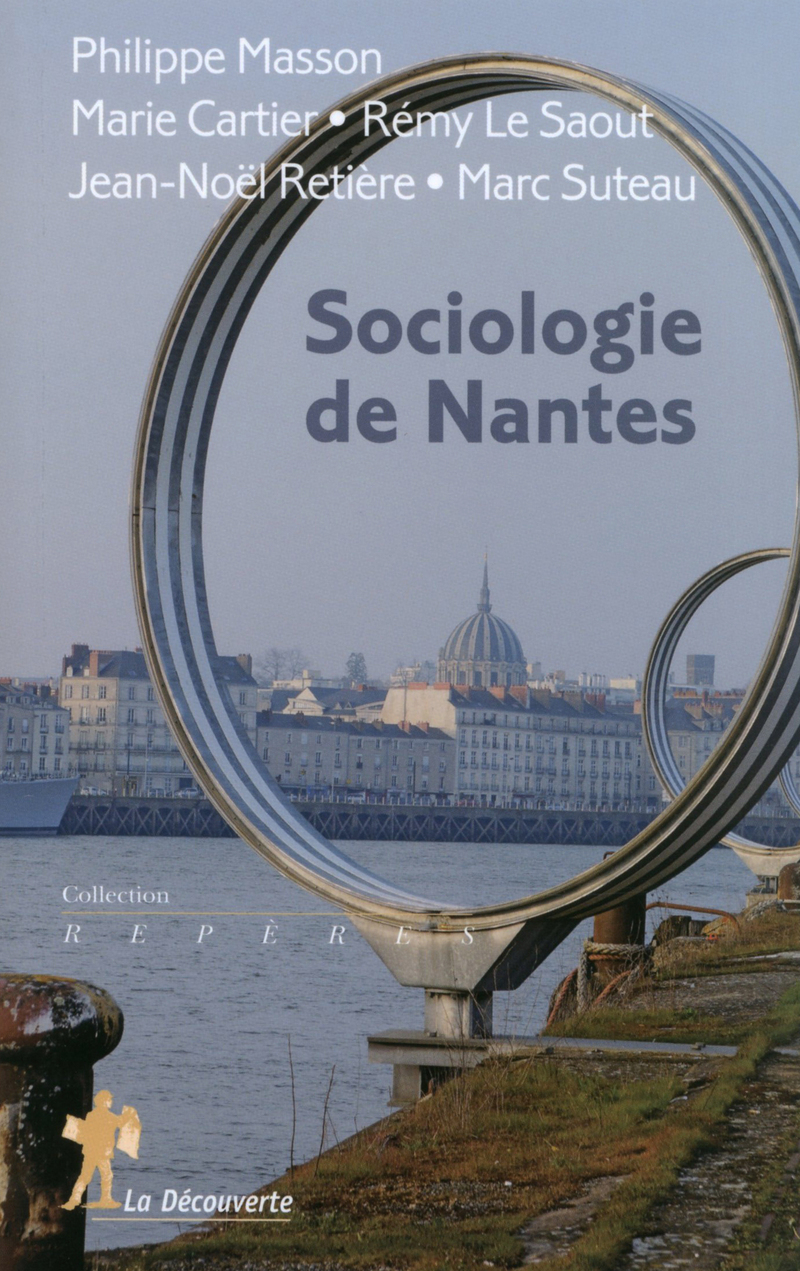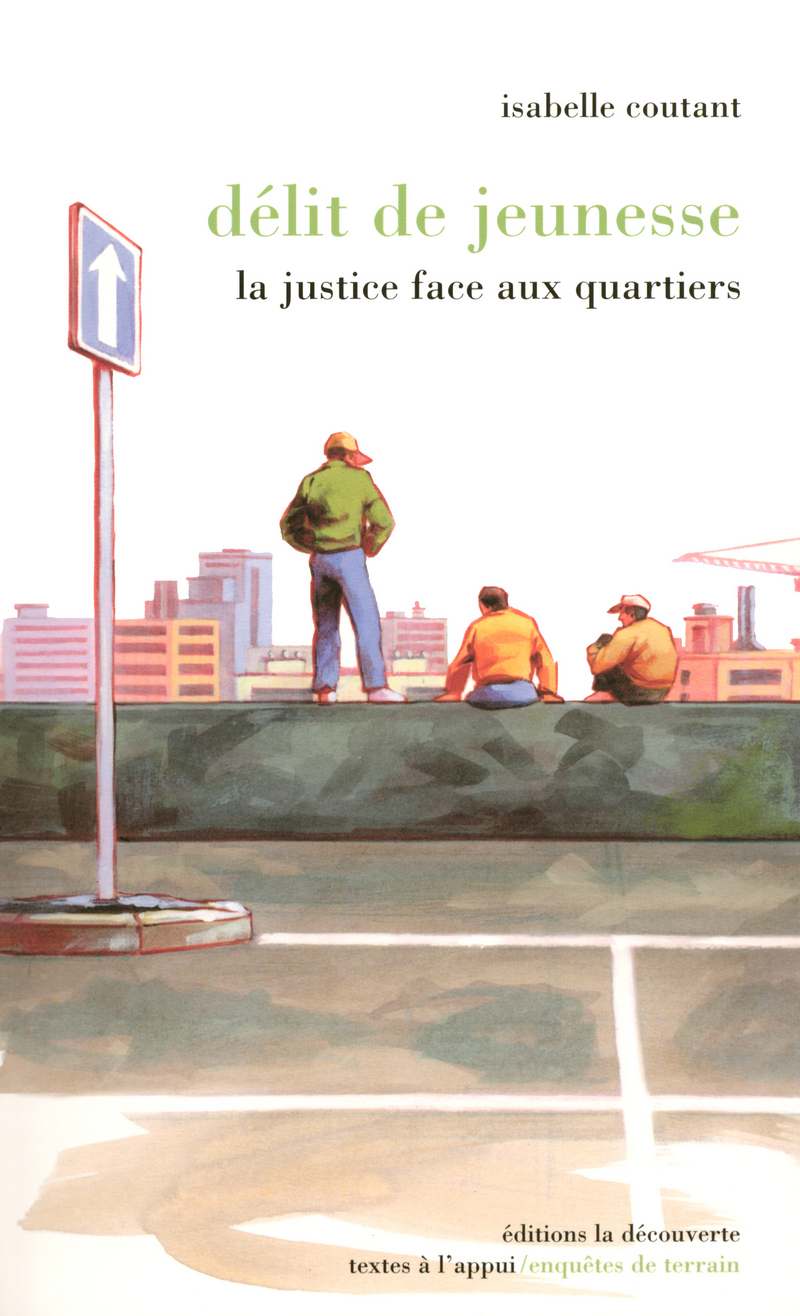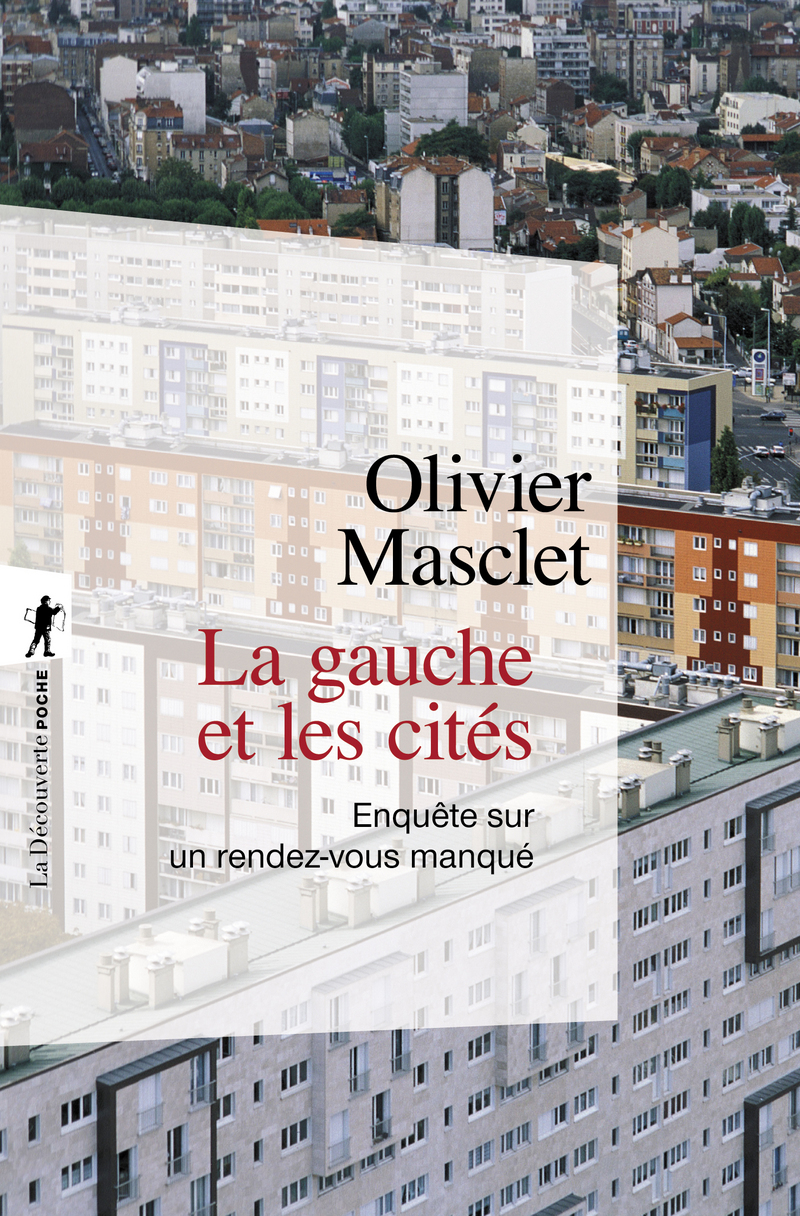La France des " petits-moyens "
Enquête sur la banlieue pavillonnaire
Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet, Yasmine Siblot
Dans les médias, les banlieues françaises sont souvent réduites aux cités, aux grands ensembles, quand ce n'est pas aux émeutes des " quartiers ". Il est pourtant une " autre " banlieue, celle des pavillons, qui abrite une population au moins aussi importante, mais paradoxalement beaucoup moins visible et connue.
Fruit d'une longue enquête, ce livre restitue l'histoire et la vie quotidienne d'un quartier pavillonnaire de la région parisienne, situé à mi-chemin entre l'univers des cités et les lotissements aisés. Sans être séparé des zones de pauvreté, il n'en matérialise pas moins des parcours d'ascension sociale. On découvre alors les conditions, les effets et les figures de la promotion sociale,du couple d'agents EDF arrivant de province dans les années 1960 au couple d'enfants d'immigrés sortant des cités dans les années 2000.
Si les ressources acquises par ces ménages les éloignent des classes populaires, leur appartenance aux classes moyennes n'est pas plus évidente. Ces " Petits-moyens ", comme ils se désignent parfois eux-mêmes, aspirant à " vivre comme tout le monde " sont au coeur de ce livre, qui en dresse les contours et le style de vie. Les auteurs montrent notamment que, dans ces quartiers longtemps partagés politiquement, où la vie associative est ancienne, de nouvelles formes de division et de compétition sociale les font aujourd'hui nettement basculer à droite. Ils s'efforcent d'expliquer pourquoi, après le Front national, la droite de Sarkozy séduit une large fraction de la France des " petits-moyens ".

Nb de pages : 317
Dimensions : * cm
 Marie Cartier
Marie Cartier

Marie Cartier, maître de conférences, enseigne la sociologie à l'université de Nantes. Les recherches qu'elle mène au sein du CENS portent sur les salariés d'exécution dans une perspective de sociologie du travail et des groupes sociaux. Elle a écrit Les Facteurs et leurs tournées. Un service public au quotidien (La Découverte, 2003) et a coécrit La France des " petits-moyens ". Enquête sur la banlieue pavillonnaire (avec I. Coutant, O. Masclet, Y. Siblot, La Découverte, 2008).
 Isabelle Coutant
Isabelle Coutant


Isabelle Coutant, CNRS, est chargée de recherches à l'IRIS. Elle est l'auteur de Politiques du squat (La Dispute, 2000).
 Olivier Masclet
Olivier Masclet

Olivier Masclet est professeur de sociologie à l'université de Limoges et membre du Groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines. Il est notamment l'auteur d'une Sociologie de la diversité et des discriminations (Armand Colin, rééd. 2017) et co-auteur de Être comme tout le monde. Employées et ouvriers dans la France contemporaine (Raisons d'agir, 2020).
 Yasmine Siblot
Yasmine Siblot

Yasmine Siblot, Université Paris 1, G. Friedmann-CNRS et CSU-CNRS, est l'auteure de Faire valoir ses droits au quotidien. Les services publics dans les quartiers populaires (Presses de Sciences Po, 2006).
Extraits presse 

2008-04-29 - Sylvia Faure - Liens socio
Dans leur ouvrage, Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet et Yasmine Siblot consacre un chapitre à des trajectoires de femmes issues des cités HLM qui se sont installées avec leur famille dans les pavillons " chics " des Peupliers. Filles d'immigrés nées en France, elles et leurs maris ont connu une petite mobilité sociale ascendante pour devenir employés administratifs, machiniste, comptable puis cadre par promotion interne. Les entretiens révèlent la force de leur désir de quitter la cité pour se hisser socialement et offrir " autre chose " à leurs enfants...
2008-07-08 - Xavier Molénat - Sciences Humaines
La France des petits moyens est un ouvrage doublement d'actualité. Il paraît un an après la victoire du candidat Sarkozy, présenté par les médias comme le candidat de l'ordre, de la valeur "travail", mais aussi des résidents "pavillonnaires". En second lieu, il manifeste un renouveau des études sur les classes sociales, lues notamment par le biais des mobilités sociales...
2008-07-26 - Mathieu Fonvieille - Non fiction
Une contribution passionnante à une meilleure approche, au delà des clichés, des espaces périurbains et de leurs populations marquées par la mobilité, et une approche sociologique qui peut, indirectement, enrichir les cours sur la géographie urbaine de la France.
2008-07-29 - Nathalie Quillien - Les clionautes
" Dans un livre La France des petits-moyens, des sociologues tordent le coup à une idée largement répandue, très souvent relayée par les médias, selon laquelle les habitants des pavillons voteraient mécaniquement à droite. Victimes de leur illusion naturaliste, les journalistes qui ont réalisés des reportages dans les quartiers populaires lors des dernières élections présidentielles, ont opposé un monde supposé blanc des pavillons à celui des HLM. Les premiers ayant voté en faveur de Nicolas Sarkozy, les seconds pour Ségolène Royal. Les pavillonnaires ont, une nouvelle fois, été décrits comme des archétypes du conservatisme. Munis de leur méthodologie ethnologique, les sociologues réunis autour de cet ouvrage ont multiplié à partir de 2004, les enquêtes de terrains dans le quartier pavillonnaire des Peupliers, à Gonesse. Située à la limite de l'agglomération parisienne, la ville comprend des grands ensembles et des quartiers résidentiels, "qui contribuent à fixer localement les ménages disposant de revenus suffisants pour accéder à la propriété". Cette co-existence se retrouve au sein même des Peupliers où vivent, côte à côte, des ménages en ascension sociale et d'autres hantés par le déclassement. [...] Au final, il y a moins de distance entre les habitants du quartier des Peupliers et leurs voisins vivant en HLM que d'écart entre un travail journalistique et une étude sociologique. Surtout, quand celle-ci mobilise, en plus des données recueillies sur le terrain, dans la durée, les études faisant référence à des domaines aussi larges que les "pavillonnaires", les politiques du logement, les forces s'exerçant sur les classes populaires ou les évolutions de leur représentation politique. Un tel travail évite de redonner vie à l'un des mythes les plus faux, qui hante la vie politique depuis 150 ans. "
BAKCHICH
" Voici un livre essentiel pour qui veut réfléchir sur les ressorts de la victoire de Sarkozy, en 2007, et sur les différenciations sociales qui existent au sein des catégories populaires. Une équipe de sociologues a mené l'enquête, pendant plusieurs années, dans un quartier pavillonnaire de la banlieue nord de Paris, à Gonesse. L'objectif affiché du livre est de travailler sur les petites mobilités sociales, qui touchent de nombreuses familles. [...] Cet ouvrage éclaire donc les aspirations et les styles de vie de ces "petits-moyens" et explicite les mécanismes de tension et de division qui peuvent, aujourd'hui, faire pencher une partie d'entre eux à droite. "
ROUGE
2026-02-18 - PRESSE
Table des matières 

Remerciements
Introduction
Introuvables " classes moyennes "
Des " petits moyens " : une ethnographie des petites mobilités sociales
Un quartier pavillonnaire de la banlieue nord
Une enquête collective en milieu pavillonnaire
1. Un quartier de promotion
Un espace charnière entre précarité et périurbain aisé
Une succession d'opérations immobilières
Les pavillons en bandes : des " pionniers " aux " étrangers "
La formation de nouvelles zones de promotion
2. La " belle époque "
Les " pionniers " des pavillons en bandes : une ambiance d'" égalité "
La " belle époque " : un quartier animé par d'intenses sociabilités entre familles
Urbanisation, déménagements et vieillissement : le retour des inégalités
3. Des enfants de cité en quête de respectabilité
Les conditions sociales d'ascensions modestes
En quête de respectabilité et de bien-être pour la famille
L'angoisse de la perte de statut social et l'enjeu de l'école
4. Jeunes des pavillons
Grandir dans un lotissement pavillonnaire
Les relations ambivalentes avec les " jeunes des cités "
Rester dans le quartier : le lotissement comme refuge face à des destins sociaux incertains
5. " Ils sont très gentils mais quand même... " : face aux nouveaux voisins étrangers
" Sauver son honneur "
Des échanges et leurs limites
6. La droitisation des pavillonnaires ?
Un quartier mobilisé et politiquement mêlé
La protestation des petits pavillonnaires de droite : la présidentielle de 2007
Le travail militant à gauche
Conclusion
Annexe 1. Entretiens cités dans l'ouvrage
Annexe 2. Documents et sources utilisés.