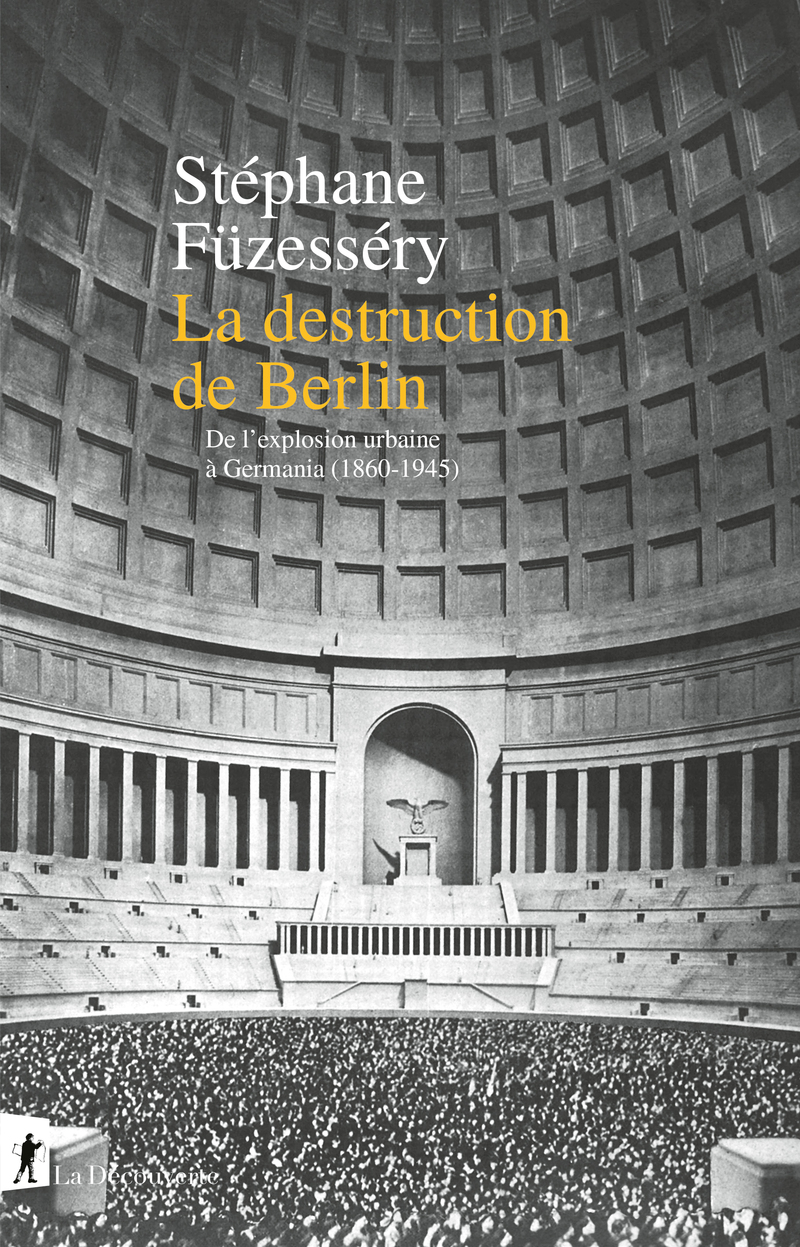La destruction de Berlin
De l'explosion urbaine à Germania, 1860-1945
Stéphane Füzesséry
La croissance explosive de Berlin entre 1860 et 1910 a-t-elle favorisé la réception du nazisme ? La " décivilisation " qu'a connue l'Allemagne après 1933 est-elle née en réaction à la nouvelle civilisation urbaine apparue en plein cœur du Brandebourg au début du XXe siècle ? Pourquoi les nazis, qui n'ont pourtant cessé de clamer leur haine de la très grande ville, ont-ils voulu transformer leur capitale en une mégalopole de dix millions d'habitants ? Et dans quelle mesure la mise en œuvre de ce projet à partir de 1938 a-t-elle préfiguré la destruction de Berlin par les bombes alliées ?
Le livre tente de répondre à ces questions. Envisageant à nouveaux frais l'histoire convulsive de Berlin entre 1860 et 1945, il observe comment deux générations d'Allemands, confrontés au brutal changement d'échelle de leur capitale et aux formes inédites empruntées par la vie métropolitaine, sont parvenus à en surmonter les effets les plus déstabilisants tout en nourrissant de profonds doutes sur la viabilité à long terme de la très grande ville – une forme de peuplement en rupture complète avec la tradition urbaine allemande.
Il apporte ainsi un éclairage neuf sur la détestation nazie de Berlin et sur la manière dont, une fois au pouvoir, les dirigeants du IIIe Reich ont voulu reconstruire leur capitale. Revenant sur la genèse et la mise en œuvre de ce projet connu sous le nom de Germania, il montre que la destruction de Berlin a commencé avant les bombardements alliés et que le chantier de la mégalopole nazie – par ses besoins en main-d'œuvre et en matériaux – a participé à la fuite en avant du régime vers la guerre, entraînant en retour l'une des plus vastes campagnes de dévastation jamais entreprises contre une ville.

Nb de pages : 376
Dimensions : 15.4 * 24 cm
ISBN numérique : 9782348088001
 Stéphane Füzesséry
Stéphane Füzesséry


 Actualités
Actualités

Extraits presse 

A l'aube du XXᵉ siècle, Berlin, capitale en expansion frénétique, devient un laboratoire d'angoisses urbaines. La surpopulation, les bouleversements sociaux et les ruptures culturelles ébranlent les classes populaire et moyenne. Dans " la Destruction de Berlin ", l'historien et architecte Stéphane Füzesséry souligne qu'" en provoquant l'effondrement périodique de la civilisation urbaine, ces crises ont fini par inciter une partie des classes moyennes urbaines à reporter leur voix sur le parti nazi ".
2025-08-20 - Alexandre Thuet Balaguer - Le Nouvel Obs
En 1945, Berlin n'était plus qu'un champ de ruines. Un constat que dresse Stéphane Füzesséry au terme d'une démonstration vivante et informée. Outre qu'elle bénéficie de sa double compétence d'urbaniste et d'historien, elle s'inspire d'une pluridisciplinarité bienvenue, en puisant dans les ressources de la sociologie, de l'anthropologie et de l'architecture, sans ne jamais céder au jargon. Bref, une plongée passionnante dans un monde que la Seconde Guerre mondiale a précipité aux abîmes.
2025-08-28 - Olivier Wieviorka - Libération
La destruction de Berlin n'est pas comme on le pense généralement le fruit des bombardements alliés, elle a commencé bien avant, dès l'accès des nazis au sommet de l'État. Pour eux, dit l'auteur, il ne s'agissait pas de prendre le pouvoir à Berlin, mais sur Berlin, ville qu'ils abhorraient. C'est à la destruction de la ville, de ses formes de sociabilité et de sa diversité, que les nazis vont s'adonner en décidant d'installer un nouvel ordre urbain. (...) En définitive, l'univers de la très grande ville, sa métropolisation sous le signe de l'éclair, a pu insuffler au nazisme une part de sa " modernité ". Sans pour autant le produire " mécaniquement ", mais en ouvrant des brèches dans lesquelles il allait s'engouffrer. L'hypothèse de départ devient au fil de la lecture convaincante. Elle refaçonne un pan d'histoire sur lequel on ne s'interrogeait pas assez.
2025-10-14 - Sonia Combe - En attendant Nadeau
Puisant aux meilleures sources allemandes (statistiques officielles, documents administratifs, études universitaires, récits et souvenirs de Berlinois), l'auteur décrit avec précision le moindre aspect de la vie berlinoise. (...) Cette remarquable "biographie" de Berlin ne peut être résumée, tant elle apporte d'informations aussi bien sur la nature en ville, les espaces verts et les vastes parcs que sur l'automobile, les accidents de la route, la construction d'autoroutes, avec régulièrement des notations sur d'autres métropoles. La troisième partie est consacrée au nazisme, à sa conception de l'urbanisation pour l'Allemagne et à son intention concernant Berlin, future capitale du IIIe Reich, Germania. Stéphane Füzesséry analyse également la conquête de Berlin par les nazis, alternant démagogie et terrorisme.
2025-11-01 - Thierry Paquot - Esprit
Vidéos 

Table des matières 

Avant-propos
Introduction
La très grande ville comme forme spatiale et sociale à la fois
Le choc allemand de la métropolisation
Non pas une, mais deux crises superposées
L'autre modernité berlinoise
Partie I. Surrection
1. La rupture d'échelle métropolitaine
Anatomie d'une explosion urbaine
Habiter et travailler
Circuler et transporter
Approvisionner et assainir
2. Le paysage d'expérience de la très grande ville
Surpeuplement, affluences de masse, congestion
Mobilités pendulaires, intensification du trafic, désordre circulatoire, accidents
Synchronisation, accélération, différenciation
Les nouveaux paysages sensoriels de la métropole
3. La crise berlinoise de la modernité allemande
Berlin, une ville étrangère à la " terre des Allemands " ?
Berlin, une ville parasite ?
Berlin, une ville pathogène ?
Berlin, une ville stérile ?
Partie II. Acclimatation
4. Les chantiers de l'acclimatation urbaine
Déconcentrer la très grande ville, ménager le citadin
Réformer l'habitat, éduquer l'habitant
Réintroduire la nature en ville, " renaturer " le citadin
Prévenir les accidents, discipliner les usagers de la rue
5. Les dialectiques de l'adaptation citadine
Réserve citadine et civilité ordinaire
Accélération et automatisation de la démarche
Éblouissement, assourdissement, vertige
La pharmacologie des loisirs métropolitains
6. Les crises de la normalisation métropolitaine
Crises, ordre et désordre public
Crises et détresse ordinaire
Crises, famine et angoisse de la famine
Crises, insécurité et incivilité
Partie III. Destruction
7. La destruction du paysage psychique de Berlin
La détestation nazie de Berlin
Heurs et malheurs du " combat pour Berlin "
La résistible ascension électorale des nazis à Berlin
Les nazis au pouvoir à l'assaut de la démocratie urbaine
8. L'impasse monumentale de l'utopie Germania
La très grande ville dans la vision nazie de l'espace
Germania, une uchronie nazie
La signification biopolitique du gigantisme
Les apories d'un chantier nazi
9. L'épreuve berlinoise de la dévastation
Une société de l'adaptation
Une société de la ségrégation
Une société de la résilience
Une société de l'effondrement
Conclusion
Remerciements.