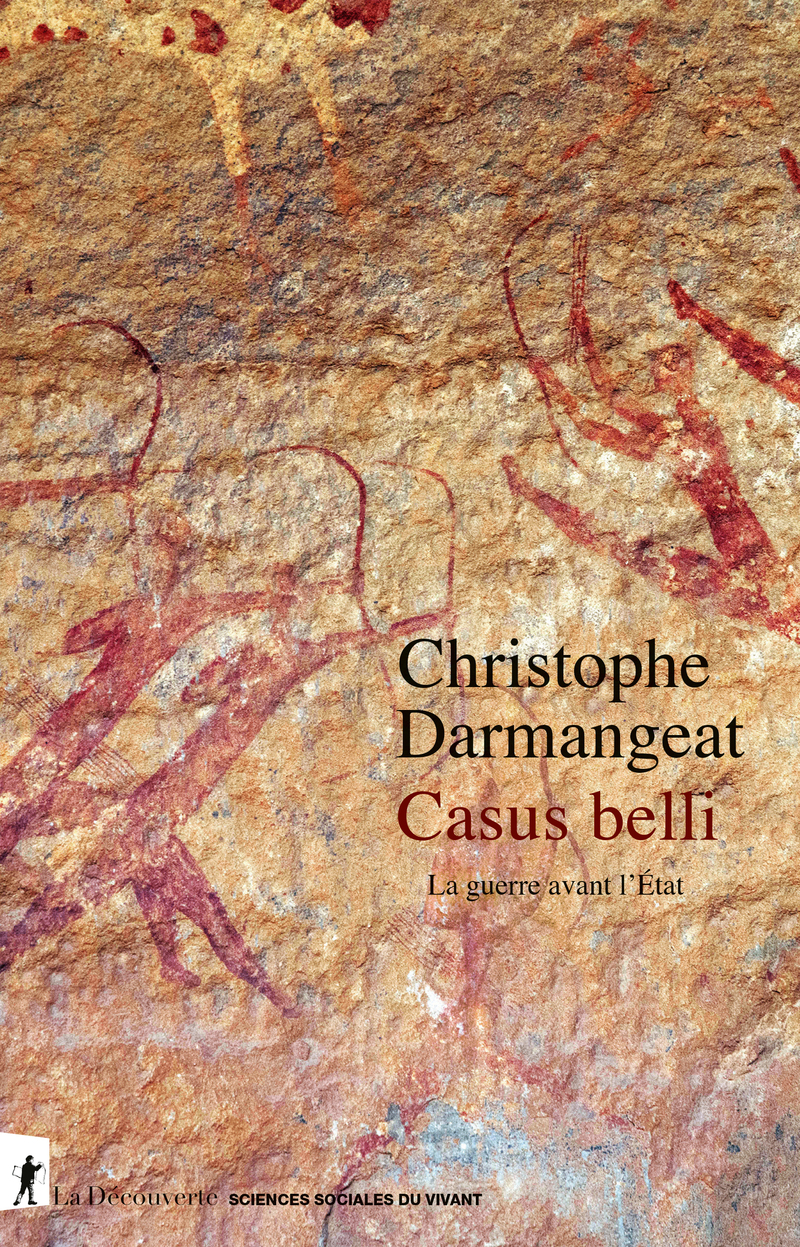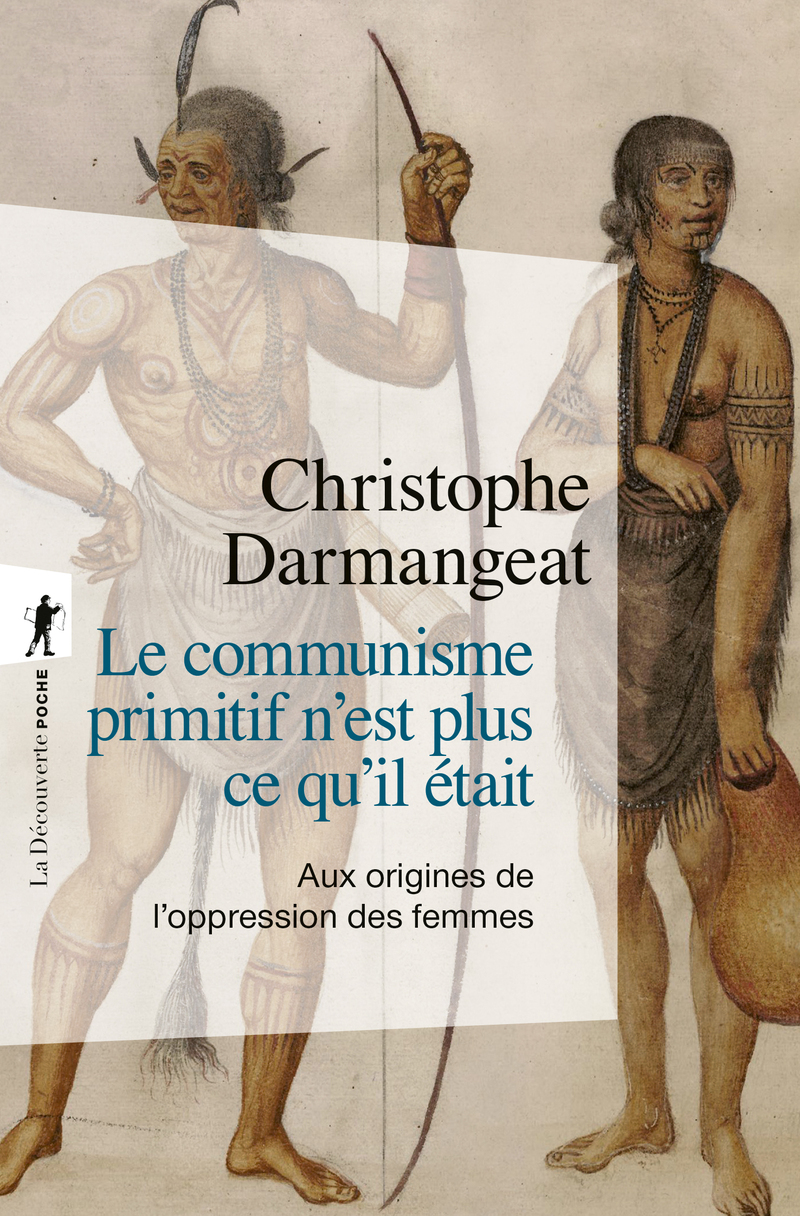Casus belli
La guerre avant l'État
Christophe Darmangeat
Il est souvent admis que la guerre authentique ne naît véritablement qu'à l'âge du Bronze – cette période étant supposée marquer l'apparition de combattants professionnels et d'un armement spécifiquement homicide. À rebours, un vaste courant de pensée plaide pour une origine bien plus ancienne. Ses tenants, qui inscrivent la question dans le temps long de l'évolution de l'humanité, relient nos dispositions belliqueuses aux observations effectuées sur les autres primates, en particulier les chimpanzés.
Au-delà de leurs divergences, ces approches s'accordent sur le fait que la guerre est intimement et nécessairement liée à l'appropriation de ressources. C'est cette idée, mais aussi l'assimilation de tout conflit collectif homicide à la guerre telle que nos sociétés étatiques la définissent que Christophe Darmangeat entend contester, sur la base de multiples données historiques et ethnographiques, dont celles portant sur des sociétés de chasse-cueillette mobile dénuées de toute inégalité de richesse. La plupart de ces affrontements sont menés pour d'autres motifs que l'appropriation de ressources territoriales, humaines ou matérielles, qu'il s'agisse entre autres de parvenir à un règlement judiciaire, de se venger ou d'acquérir des substances corporelles (têtes, dents ou scalps) réputées nécessaires à la vie.
Dans une large perspective comparatiste, ce livre ambitionne de recenser les diverses formes – presque toutes oblitérées par l'État – de ces confrontations collectives, d'en proposer une typologie raisonnée, de les mettre en relation avec les structures sociales et de traiter de leur (in)visibilité archéologique, afin d'éclairer leurs logiques profondes.

Nb de pages : 384
Dimensions : 15.4 * 24 cm
ISBN numérique : 9782348080784
 Christophe Darmangeat
Christophe Darmangeat


 Actualités
Actualités

- LIBRAIRIE GEORGES [Talence]
- Lundimatin – Lundi soir
- LIBRAIRIE LA PETITE ÉGYPTE [Paris]
- France culture – Questions du soir Idées
- FRANCE INTER - Le Grand face-à-face
- LIBRAIRIE OMBRES BLANCHES [Toulouse]
- LIBRAIRIE FLIBUSTE [Fontenay-sous-Bois]
- Lundimatin – Lundi soir
- [PRESSE] Casus belli
- LIBRAIRIE LA MÉMOIRE DU MONDE [Avignon]
- Radio libertaire
- LIBRAIRIE LE CACHALOT [Foix]
- LIBRAIRIE LE CACHALOT [Foix]
- LIBRAIRIE L' IMPOSSIBLE [Alès]
- Crépuscule
- Penser c'est chouette
Extraits presse 

2025-08-01 - Pour la Science
" Avec le passionnant " Casus belli ", l'ethnologue Christophe Darmangeat refonde le problème de l'origine de la guerre, non sans un certain humour noir. [...] Il repense de fond en comble ce problème d'autant plus actuel que la guerre s'est faite plus présence. [...] C'est parce qu'il navigue en évitant ces deux écueils que cet ouvrage constitue une salutaire et passionnante entreprise de refondation. Tout en récusant la vision idyllique de chasseurs-cueilleurs toujours pacifiques, héritage du " bon sauvage " à la Rousseau, Christophe Darmangeat a le grand mérite de rendre plus complexe l'idée que nous nous faisons de la guerre en suggérant une classification fine des conflits. [...] La force de ce travail tient à ce qu'il prend en compte la pluralité des hypothèses sur l'origine de la guerre en s'appuyant sur un riche corpus de récits ethnologiques, de la Renaissance à nos jours. Il n'en risque pas moins des tentatives d'explication globale de pratiques belliqueuses se produisant en des points disjoints de la planète. [...] Mariant l'élégance du style à un certain humour noir, Christophe Darmangeat constate que la puissance étatique qui a réprimé ces traditions peut les ranimer à l'occasion. [...] Que l'État condamne la violence des autres moins pour l'abolir que pour la thésauriser est l'une des conclusions glaçantes que nous suggère, cette belle leçon d'anthropologie. "
2025-08-28 - Nicolas Weill - Le Monde des livres
Les origines de la guerre posent d'épineuses questions qui sont autant de casse-tête historico-anthropologiques. (...) L'intérêt du livre est d'offrir un riche dossier synthèse sur le sujet. (...) Une distinction majeure oppose la guerre proprement dite – qui vise à soumettre un ennemi par la force – à d'autres formes d'affrontements, très présentes dans les sociétés sans État, qui relèvent des représailles menées contre un groupe pour venger une offense ou un préjudice. (...) Quels sont alors les motifs qui poussent les hommes à s'entretuer ? Sur ce point, l'auteur remet en cause bien des évidences : l'appropriation des ressources est loin d'être la raison première de nombreux conflits.
2025-09-18 - l'humanologue Blog
Quelle est l'origine de la guerre ? Nous fut-elle léguée par le Néolithique, comme la carie dentaire ? Ou bien provient-elle de notre part animale et sommes-nous condamnés à la voir réapparaître sans cesse ? Questions vertigineuses et pour certaines multiséculaires, que Christophe Darmangeat embrasse avec rigueur et méthode. Dans la lignée d'Alain Testart, il commence par rebattre les cartes et redéfinir les données du problème. Dans plusieurs chapitres lumineux, il démontre que " la guerre ne constitue qu'une forme particulière du vaste ensemble des confrontations collectives (...) ".
2025-09-23 - Romain Pigeaud-Leygnac - hominides.com
Christophe Darmangeat pointe d'emblée la confusion courante entre guerre et autres affrontements collectifs violents. Il s'emploie avec force pédagogie, et un certain humour, à proposer une classification méthodique de ces derniers, en s'appuyant sur plusieurs cas rapportés dans de nombreuses sociétés. Puis, il se penche sur la question de l'origine de ces violences en renvoyant dos à dos les explications pulsionnelles mobilisant une supposée agressivité inhérente à certains peuples et celles fondées sur un matérialisme trop étroit, qui les fait reposer exclusivement sur l'acquisition de ressources. Il souligne le rôle de motifs symboliques, comme la justice ou la vengeance ainsi que l'acquisition d'autres attributs investis d'une importance cruciale, comme les têtes des adversaires. L'ouvrage vaut aussi le détour pour la rigueur du raisonnement. Une leçon loin d'être superflue en ces temps où le cours de l'irrationnel remonte en flèche.
2025-11-01 - Alternatives économiques
Voici une paru tion fondamen tale dans le dé bat ancien sur les origines de la guerre. Était-elle déjà présente au Paléolithique ou bien n'est-elle apparue que bien plus tard, avec, pour enjeu central, l'appropriation des biens et des territoires ? Cet objectif constitue-t-il vraiment le seul que l'on puisse trouver à des conflits collectifs visant à terrasser des ennemis pour exercer sur eux une suprématie ? Car telle est la définition de la guerre que propose l'auteur, de façon à la distin guer d'une autre forme fréquente de conflit communautaire : les chaînes de vengeance de type feud ("dispute", en anglais) ou vendettas, qui, elles, visent non pas la victoire, mais l'équilibrage des pertes. Pour autant, guerre et re présailles collectives ont en commun à la fois de chercher à résoudre le dif férend - en cela, elles se distinguent, par exemple, des razzias - et de le ten ter sans accord préalable entre les par ties - ce qui les sépare notamment des duels collectifs. Voici résumés quelques éléments de la savante classification que propose Christophe Darmangeat à propos des conflits d'ampleur, au terme d'une enquête ethnographique aussi vaste que fouillée. Celle-ci confirme que les États, en s'assurant le monopole de la violence légitime, ont considérable ment restreint la diversité des conflits collectifs. Ces derniers, généralement inspirés par la xénophobie, peuvent avoir bien d'autres motifs que l'acqui sition ou la défense de ressources.
2025-11-01 - L'Histoire
D'où vient la guerre à la Préhistoire ? Nos certitudes remises en cause.
2025-12-02 - Thierry Jobard - Sciences humaines
Vidéos 

Table des matières 

Remerciements
Prélude. Grandes gerboises et petites guerres
Une découverte australienne
Étranges étrangers
Sur le chantier de la guerre, toujours en travaux
Première partie
Une classification générale
1. Guerre et feud
Se faire justice soi-même
Un impératif social
Extensions idéelles
De l'homicide de compensation au feud
Des chaînes de vengeance
L'invention de la richesse : le " prix du sang "
Distinguer la guerre du
feud
Classifier par les motifs ?
Les critères d'une classification générale
2. Confrontations conventionnaires résolutives
D'un commun accord
Duels libres et alternés
Les deux axes de la restriction de la violence
Les quatre types de résolution
Résolution par victoire
Résolution par catharsis
Résolution par équilibrage
Résolution par sanction de compensation
3. Confrontations discrétionnaires non résolutives
La définition des buts
L'acquisition
L'acquisition de biens (razzia)
L'acquisition d'êtres humains
L'acquisition d'éléments corporels humains (la chasse aux têtes)
Autres motifs
La vengeance
Le deuil
4. Confrontations conventionnaires non résolutives
Confrontations propitiatoires
Les pétales fanés de la guerre fleurie
Des confrontations sacrificielles avérées
Autres modes
Confrontations compétitives
Les " grands combats " des Enga
Combats identitaires (ou honorifiques)
Le sport
5. Remarques finales
Cas intermédiaires ou indéterminés
Entre résolution et non-résolution
Entre discrétion et convention
Les métamorphoses de la vengeance
De la bataille libre à la guerre
Seconde partie
Évolution des sociétés, évolution des modes de conflits
6. La quête des origines
Colombes et faucons
Le spectre de la nature humaine
Trois catégories d'indices
Distinguer la guerre des autres confrontations collectives
Éléments éthologiques
Des guerres inter-espèces ?
Conflits collectifs intraspécifiques
Spécificités humaines
Éléments ethnologiques
Du comparatisme
Des bases de données
Les chasseurs-cueilleurs mobiles
Éléments archéologiques et matériels
Les indices
Trois sites paléolithiques
Le conflit des interprétations est-il résolutif ?
7. L'enjeu des ressources
Une soif de territoires ?
Chasseurs-cueilleurs
Cultivateurs
Des apparences trompeuses ?
Un double paradoxe
Les biens meubles
Les femmes
Une lutte pour la vie ?
8. L'énigme de la prédation (ou : " Pourquoi se prendre la tête ? ")
Chasser le surnaturel
Prestige et reconnaissance sociale
Fondements mythiques
Une source de fertilité
Le nom des gens
Autres motivations
Aucune vie ne se perd, aucune vie ne se crée, tout se transfère, ou Lavoisier à l'âge de pierre
Une lecture matérialiste
Faire d'une tête deux coups : prédation et vengeance
La prédation sans la vengeance
Vengeance et prédation opportuniste
La prédation, fille de la vengeance
Deux cas limites
Une prédation purement idéelle ?
9. L'État contre la violence (des autres)
Réfréner et conscrire
La lutte étatique contre les confrontations conventionnaires
La lutte contre le droit de vengeance
La maîtrise de la violence extérieure
Conclusion
Une approche matérialiste alternative
Et l'avenir ?
Annexe. Guerre et
feud
, la théorie standard et sa critique
La théorie standard
Trois critiques
Un concept peu maniable
L'introuvable " communauté politique "
Une définition en trompe-l'oeil
Glossaire
Atlas des peuples et des lieux cités
Bibliographie
Notes
Index.