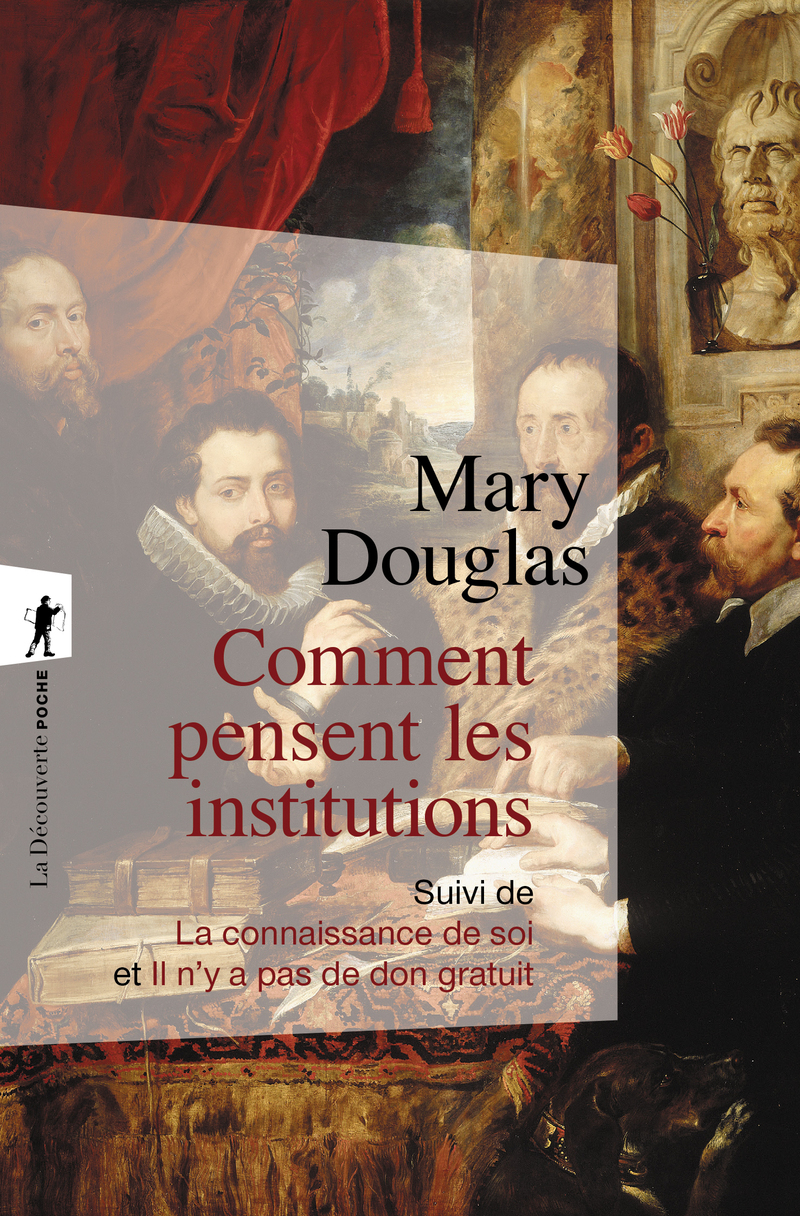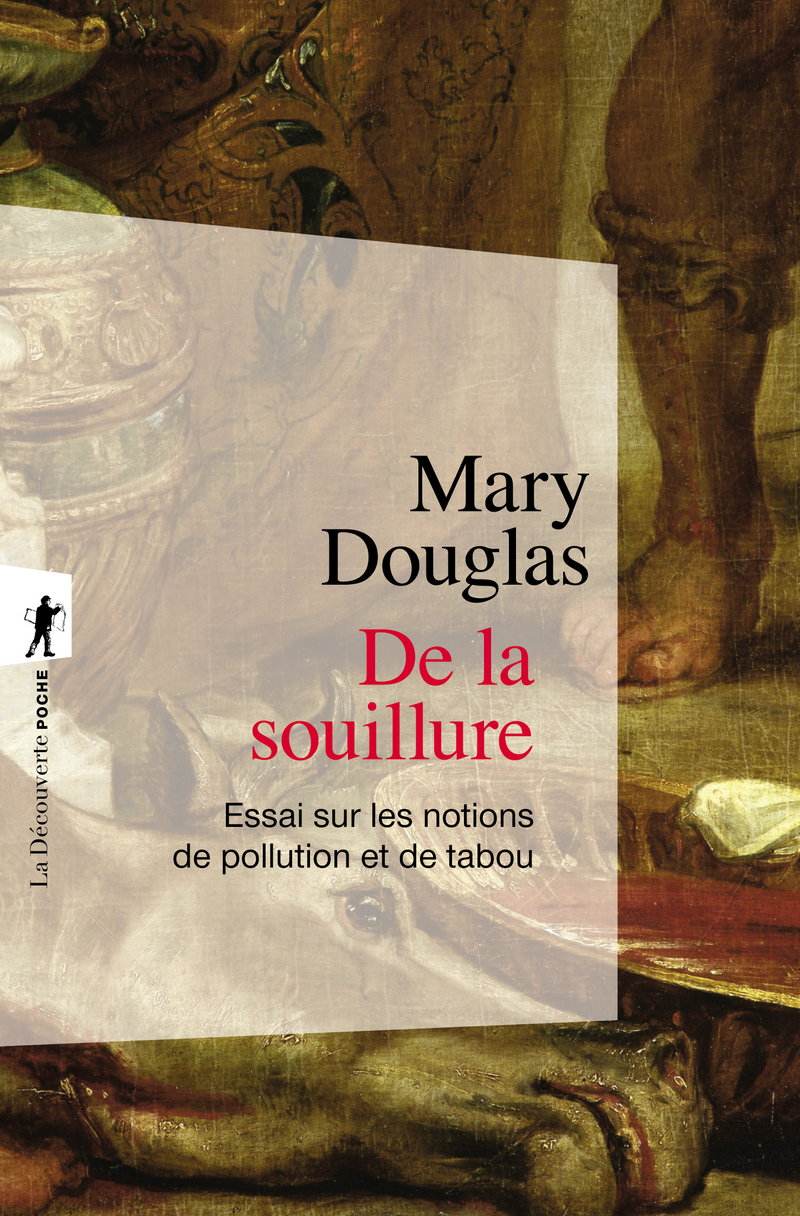Comment pensent les institutions
Suivi de" La connaissance de soi " et " Il n'y a pas de don gratuit "
Mary Douglas
Les institutions pensent-elles ? Ont-elles un esprit en propre ? Dans ce livre, Mary Douglas prend à bras-le-corps toutes ces questions pour jeter les bases d'une théorie des institutions. On explique d'ordinaire le raisonnement humain par les propriétés de la pensée individuelle. Mary Douglas se focalise, elle, sur la culture et nous entraîne dans un parcours provocateur et passionné, placé sous le double patronage de la sociologie d'Émile Durkheim et de la philosophie des sciences de Ludwik Fleck. D'où il ressort que nous aurions tort de croire que seule la pensée des peuples primitifs serait modelée par les institutions, tandis que notre modernité verrait advenir une pensée véritablement individuelle. Les questions essentielles, les décisions de vie ou de mort, par exemple, ne peuvent jamais être résolues à un niveau purement individuel. Avec le présent livre, qu'elle considère comme une " introduction après coup " à son célèbre De la souillure, Mary Douglas se place directement au cœur du débat épistémologique central des sciences sociales, grâce à une critique croisée de l'individualisme méthodologique et du holisme. Cet ouvrage est suivi de l'introduction à la traduction anglaise du fameux Essai sur le don de Marcel Mauss et d'un texte sur l'identité du moi, qui ont déjà fait du bruit en France et à l'étranger.

Nb de pages : 228
Dimensions : 12.5 * 19 cm
 Mary Douglas
Mary Douglas

Mary Douglas (1921-2007), anthropologue, a enseigné aux universités de Londres, Columbia, Northwestern et Princeton. Ses travaux d'africaniste lui ont valu la Memorial Medal du Royal Institute. Elle a publié une quinzaine d'ouvrages, parmi lesquels Comment pensent les institutions (La Découverte, 2000, 2004).
Extraits presse 

" Avec un humour tout britannique et un sérieux de chercheur, Mary Douglas donne une vision stimulante du processus de décision des groupes qui passe par une analyse serrée de la notion d'institution. "
LE NOUVEL ÉCONOMISTE
" À l'encontre de l'utilitarisme et de l'individualisme méthodologique, Mary Douglas entend bâtir une théorie qui ne va pas de soi : les institutions ne pensent pas mais la pensée dépend d'elles, et réciproquement. "
LIBÉRATION
2025-11-04 - PRESSE
Table des matières 

Avant-propos en forme d'avertissement, par Alain Caillé
Préface, par Georges Balandier
Avertissement de l'auteur
Introduction : Argumentaires pour la vie et pour la mort
1. Les institutions n'ont pas de cerveau
Le programme Durkheim-Fleck
" Collectif ", " mode " ou " monde " de pensée ?
Le défi du fonctionnalisme et de l'individualisme
2. Ce n'est pas une question d'échelle
M. Olson et le paradoxe du " passager clandestin "
Des exceptions dépourvues de statut théorique
La question des effets d'échelle
Les autres facteurs de la coopération
Au-delà de l'illusion communautaire
3. Le pourquoi de l'action collective
Elster, critique du fonctionnalisme
Vers un modèle Durkheim-Fleck élargi
Une première synthèse
Encore sur le fonctionnalisme et sa critique
4. Au fondement de l'institution : l'analogie
L'approche conventionnaliste
La naturalisation des conventions
Des dieux et des ancêtres
5. C'est l'institution qui décrète l'identité
Quelles analogies triomphent
Ressemblance et classification
L'apprentissage de la ressemblance
Le social, le cognitif et le reste
6. Où l'on voit les institutions se souvenir et oublier
Les cadres sociaux de la mémoire
La mémoire des Nuers
Science et amnésie
Kenneth Arrow et le théorème de Condorcet
7. Un outil typique de l'importance des institutions : le cas de la psychologie
Les limites de la psychologie sociale
Pourquoi on oublie l'institution
Haddon et l'émergence des conventions
Du principe de cohérence
8. Comment les institutions font les classifications
Dans le sillage de Max Weber
... Et de Durkheim
Le poids des institutions au quotidien
Quand nommer, c'est créer
9. Comment les nomenclatures changent. Des vins et des tissus...
De l'appellation des vins
10. Comment les institutions décident de la vie et de la mort
Le juste et le vrai comme artefacts
Justice et égalité
Brian Barry et l'universalité du juste
L'écueil du relativisme
Qui doit mourir ?
Au-delà de l'individualisme méthodologique
Bibliographie
La connaissance de Soi
Une conception humienne de la personne
Une conception non occidentale et post-moderne
L'unité du sujet en question
Bibliographie
Il n'y a pas de don gratuit
Don et contre-don
Le sens du potlatch
Libéralisme et individualisme
L'épreuve du terrain
L'économie politique du don
L'héritage du don
Bibliographie.