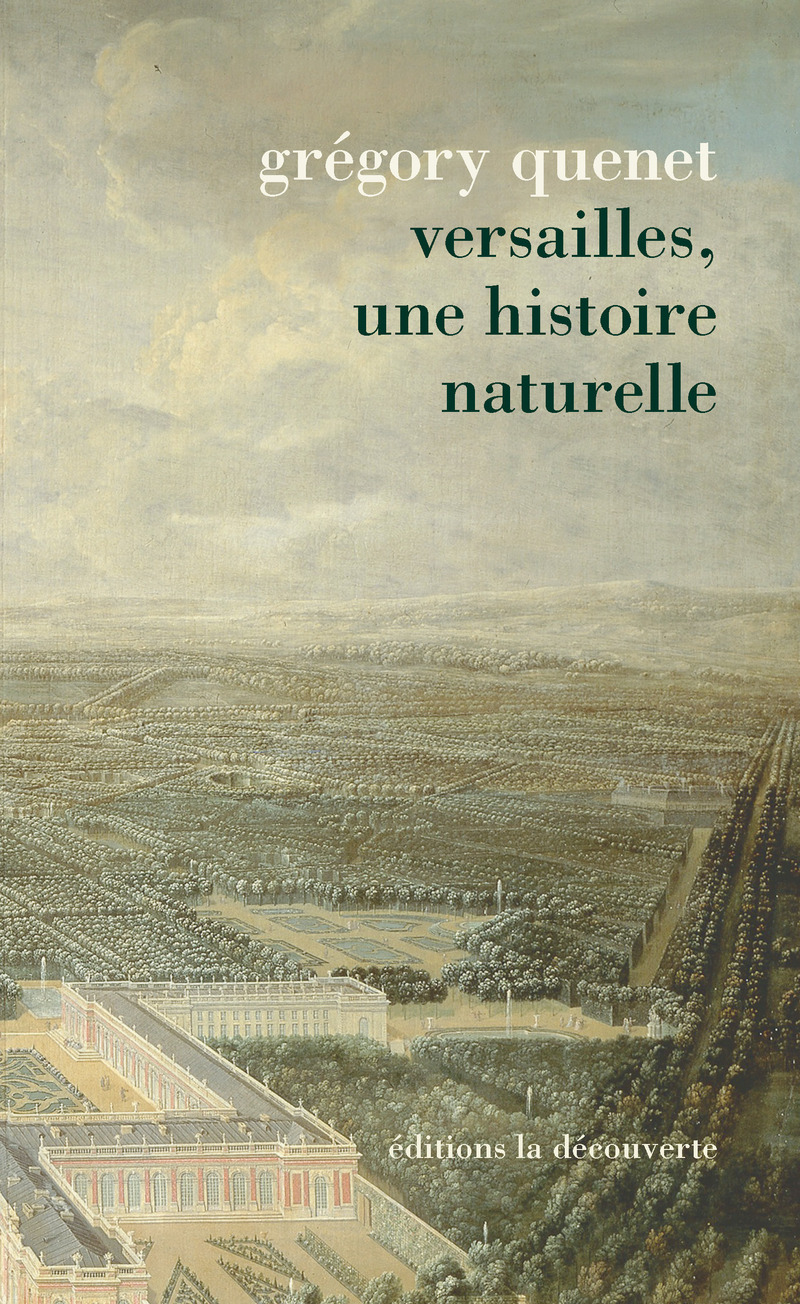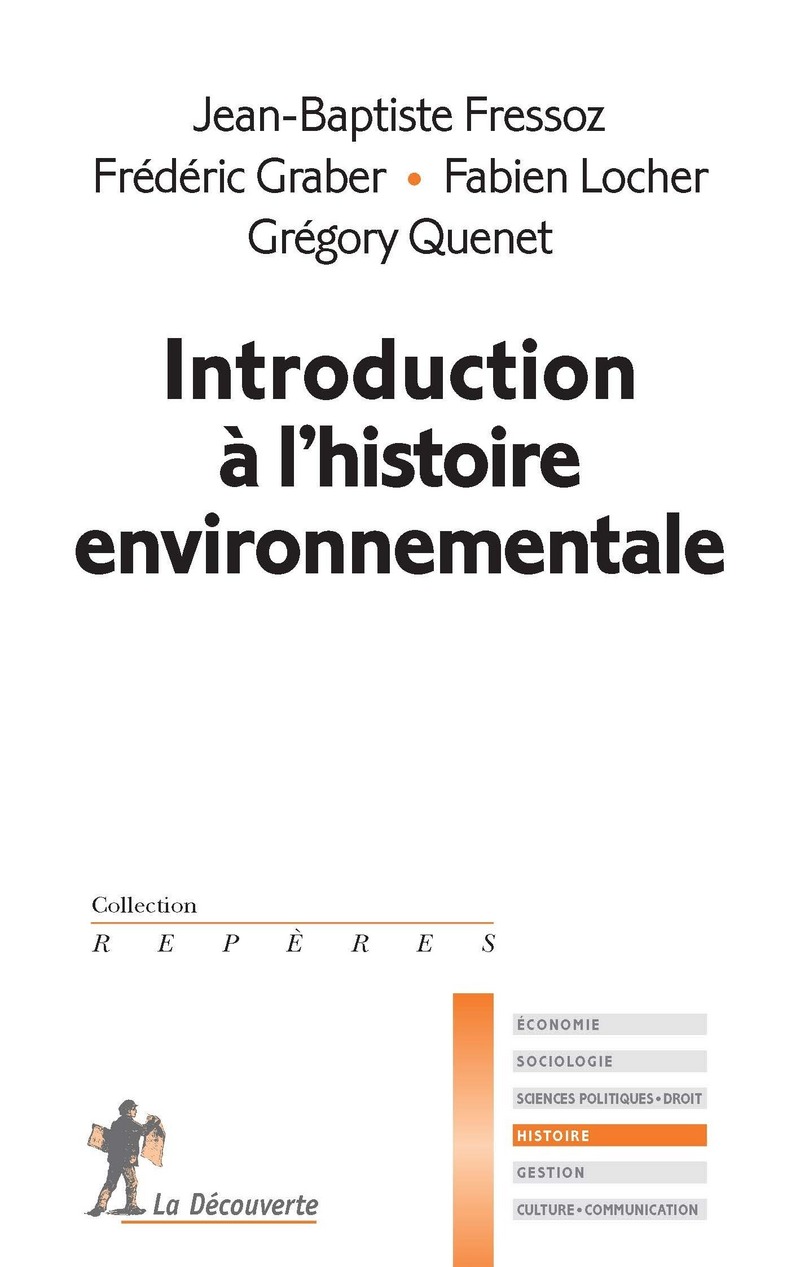Versailles, une histoire naturelle
Grégory Quenet
On croit bien connaître Versailles – son château, ses perspectives étudiées et ses jardins au cordeau –, ce lieu du pouvoir qui se met majestueusement en scène et incarne à lui seul la France et son histoire.
Le domaine actuel de Versailles ne représente pourtant que le dixième de celui d'autrefois. Au sein de l'immense Grand Parc, dynamique, vivant et giboyeux, les habitants des villages enclavés comme la nature devaient se soumettre au bon vouloir du roi. Car, à Versailles, le monarque veut chasser en toute saison, voir jaillir les grandes eaux sur un site austère. Rien n'est trop grand pour faire plier la nature : on convoque la science pour construire un réseau hydraulique pharaonique, des murs d'enceinte pour parquer le gibier, dont l'abondance nuit aux cultures. Mais la nature et les hommes résistent : les animaux s'échappent ou se multiplient, incontrôlables, les paysans se jouent des contraintes, braconnent, volent du bois, détériorent les réseaux. On renforce les frontières, règles, contrôles et sanctions. Souvent en vain.
C'est à la découverte de cet autre Versailles, animal, organique, que nous convie Grégory Quenet, loin du stéréotype d'une nature aménagée, rationalisée et contrôlée, " à la française ". Une visite passionnante qui prend à revers l'histoire officielle du rapport entre pouvoir et nature en France.
Prix François Sommer 2016

Nb de pages : 232
Dimensions : 13.5 * 22 cm
ISBN numérique : 9782707186065
 Grégory Quenet
Grégory Quenet

Grégory Quenet est historien, membre de l'Institut universitaire de France et professeur d'histoire de l'environnement à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il a notamment publié Les Tremblements de terre en France aux XVIIe et XVIIIe (Champ Vallon, 2005) et Qu'est-ce que l'histoire environnementale ? (Champ Vallon, 2014)
 Actualités
Actualités

Extraits presse 

2015-02-06 - Thierry Michel - La Marne agricole
Versailles serait-il une anticipation des problèmes écologiques auxquels doivent faire face aujourd'hui les sociétés contemporaines ? C'est l'intuition de Grégory Quenet, l'un des promoteurs en France de l'histoire environnementale. Il s'intéresse à l'histoire naturelle du château de Versailles et de son parc jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire qu'il s'efforce de comprendre les relations difficiles entretenues par la construction royale avec son cadre naturel. Car Versailles constitue à partir des années 1680 une implantation artificielle, à la population surabondante et grande consommatrice de ressources, dans un contexte naturel pourtant défavorable.
2015-02-12 - Jean-Yves Grenier - Libération
Les monuments sont habités. Tels étaient le titre, et la thèse, d'un ouvrage dirigé par Daniel Fabre et Anna Iuso dont la publication répondait à la montée en puissance des problématiques patrimoniales et mémorielles, symptomatiques du basculement de ce qu'on a pu qualifier d'" ère de la commémoration ". À sa manière, en s'intéressant au territoire de Versailles, c'est-à-dire au château et à son domaine mais aussi à la ville éponyme, Grégory Quenet radicalise cette thèse et affirme en quelque sorte que les monuments sont vivants.
2015-02-13 - Sébastien Zerilli - Liens socio
A Versailles, il y a certes le château mais aussi un magnifique parc. C'est à cette (re)découverte que l'historien Grégory Quenet nous convie. Entre réseau hydraulique "pharaonique" et parties de chasse du roi, la nature reprend ses droits et sa liberté. Des animaux s'échappent, d'autres, dits nuisibles, colonisent les espaces, des paysans volent du bois. Passionnant et érudit.
2015-02-19 - La Vie
Si Versailles vous était conté par Grégory Quenet, ça commencerait par des histoires de chasse et de reproduction de gibier. Et c'est en effet le sujet des premières pages de son nouvel ouvrage, Versailles, une histoire naturelle. Après s'être intéressé aux séismes ( Les Tremblements de terre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La naissance d'un risque, Champ Vallon, 2005) et avoir défriché théoriquement le champ de l'histoire environnementale (avec notamment Introduction à l'histoire environnementale, La Découverte, 2014), le jeune historien propose d'envisager sous un angle inédit le rêve versaillais. Plutôt que d'y voir un vaste programme de démonstration de la puissance monarchique imposée à une nature qui n'en peut mais, plutôt que de rejouer la partition bien connue d'une culture française subjuguant le monde végétal et animal à son désir de maîtrise, il montre au contraire la faiblesse de ces lectures. Et il le fait en commençant justement par porter l'attention sur ce " terrain giboyeux " qui séduisit Henri IV, avant que Louis XIII et Louis XIV ne vinssent y chasser. Car Versailles n'a pu devenir le symbole de la domination de l'homme qu'au prix d'un effacement, celui d'une dynamique propre au monde naturel, entre prolifération et rébellion, qui s'est pourtant constamment fait sentir. Ecrire une "histoire naturelle" de Versailles, ce n'est pas, pour Grégory Quenet, suivre crayons à la main les jardins tirés au cordeau, retranscrire les angles d'une perspective ou les techniques de pompes ou de rigoles, ce n'est pas même chercher des "interactions" entre l'homme et la nature, c'est montrer que la nature y fut partie prenante, politiquement et socialement. Elles ont infléchi le cours de l'histoire des hommes autant que les hommes ont infléchi le cours naturel des choses. [...] Certes le chemin à suivre pour cette histoire environnementale est exigeant, mettant le chercheur aux prises avec de nouvelles sources, autres qu'imprimées. Mais il aboutit ici à un ouvrage original et buissonnant - à l'image de son objet, difficile à saisir et parfois épineux. Grand est néanmoins son intérêt, pour son ambition de repenser, dans le sillage des travaux du philosophe Bruno Latour ou de l'anthropologue Philippe Descola, "la matérialité des formes sociales" ou, pour le dire autrement, dans sa tentative de "relativiser l'extériorité de la nature par rapport au social". L'environnement n'est pas une question naturelle, pas seulement.
2015-02-20 - Julie Clarini - Le Monde des Livres
Le programme de recherche entamé par Grégory Quenet avec cet ouvrage a l'ambition de dépasser les questionnements désormais un peu routinisés sur les partages nature/culture. En explorant le territoire de Versailles sous l'angle des accommodements, des partages, des reconfigurations juridiques, techniques ou sociales, il s'agit de donner à voir une histoire environnementale qui ne pose pas la question de la nature comme un supplément d'âme dans l'enquête historique, mais de considérer au contraire comme essentielles les intrications des rapports entre l'homme et l'environnement, comme un complexe déjà-là qu'il convient de caractériser selon les différentes époques considérées.
2016-03-24 - Jérôme Lamy - Les Cahiers d'histoire
Table des matières 

Introduction. Une autre histoire
I / Naissance. Le château dans son environnement
1. L'animal Versailles
Un site pauvre en eau
Port-Royal et Versailles, ou l'austérité
Au commencement était la chasse
Abondance du gibier et sédentarité
2. Conservation de la nature et cohabitation au sein du Grand Parc
Un domaine de chasse singulier, où les cultures dominent
Le fantasme de l'absolutisme environnemental
Le pouvoir sur la nature est brouillé par la nature du pouvoir
Dynamiques des changements environnementaux, sociaux et culturels
II / Croissance. Flux de matières et réseaux
3. De l'emprise hydraulique
Le territoire des eaux en expansion
L'espace social résiste
Le prisme technique ou l'absence de conciliation
Grand voyer, contrôleur, inspecteurs, gardes des étangs et rigoles : la police des flux
Des eaux aussi indomptables que les hommes
4. Diviser pour (tenter de) mieux régner
Tensions entre les Bâtiments et le Domaine, entre le privé et le public
Purifier les eaux, écarter les miasmes pour mieux gouverner le territoire
Rapports de force et délits hydrauliques
Désordres, empiètements, dégradations, vols, inertie, refus d'obéir
Le problème écologique est né
II / Régénération. Parquer et conserver
5. Le gouvernement de la nature
La privatisation progressive des communs
Un écosystème sous contrainte
De l'incontrôlable circulation des animaux
Où il est question d'abondance et de cascade trophique
Une microgestion des environnements
6. Des inégalités sociales et environnementales
Une stratification sociale bouleversée
Les aumônes et la tolérance de pratiques illégales atténuent les tensions
Le Roy, chasseur et philosophe
De la dignité et de l'intelligence animales
La " nature " factice du Grand Parc, ou comment les politiques de conservation modifient le comportement animal
Une nouvelle hiérarchie entre les hommes
III / Mort. Versailles, œuvre d'art et musée
7. Révolution au domaine
Les tensions montent face au pouvoir arbitraire
Le peuple réclame la limitation du gibier
Du critiquable usage du territoire
Le divorce final
8. De l'agonie du Grand Parc à la création du musée national
Versailles, lieu sépulcral
Discours sur la domination de la nature
Une œuvre d'art à la gloire de la nation
Une nature devenue culture
Conclusion. Pour une histoire environnementale de la France.
Prix François Sommer 2016