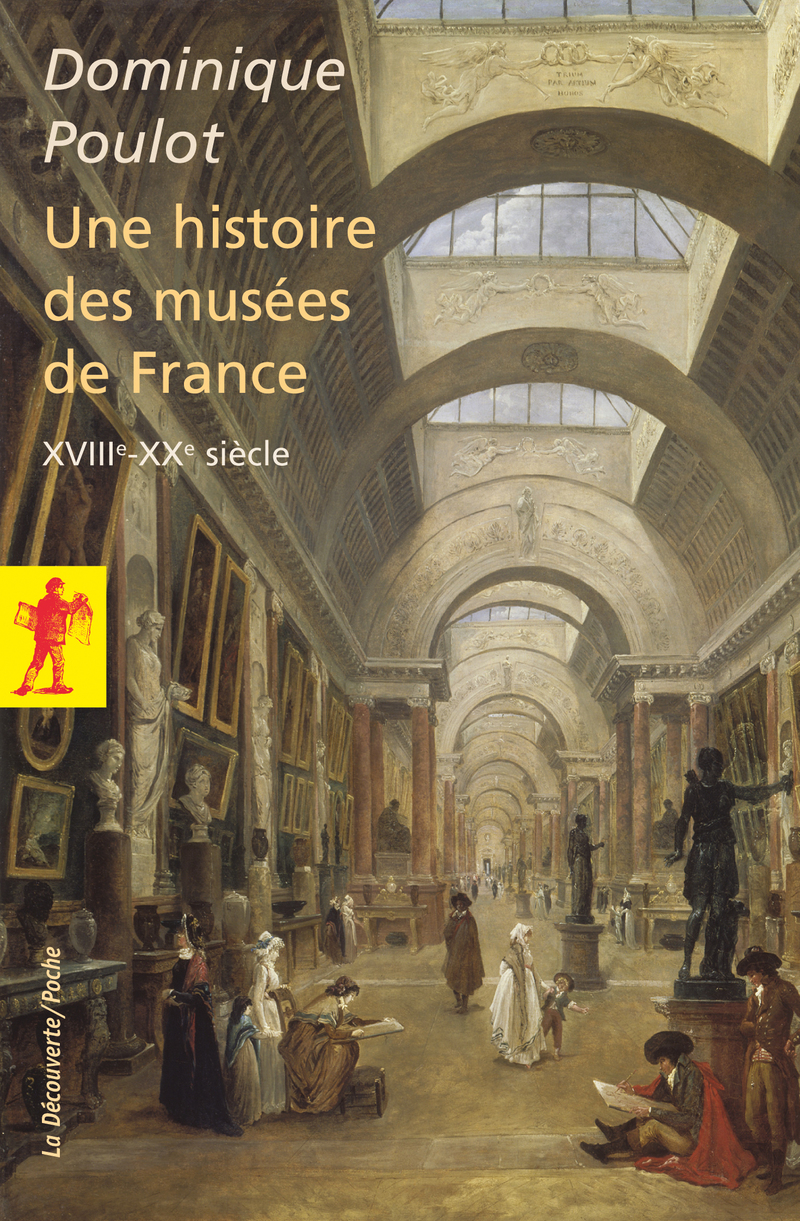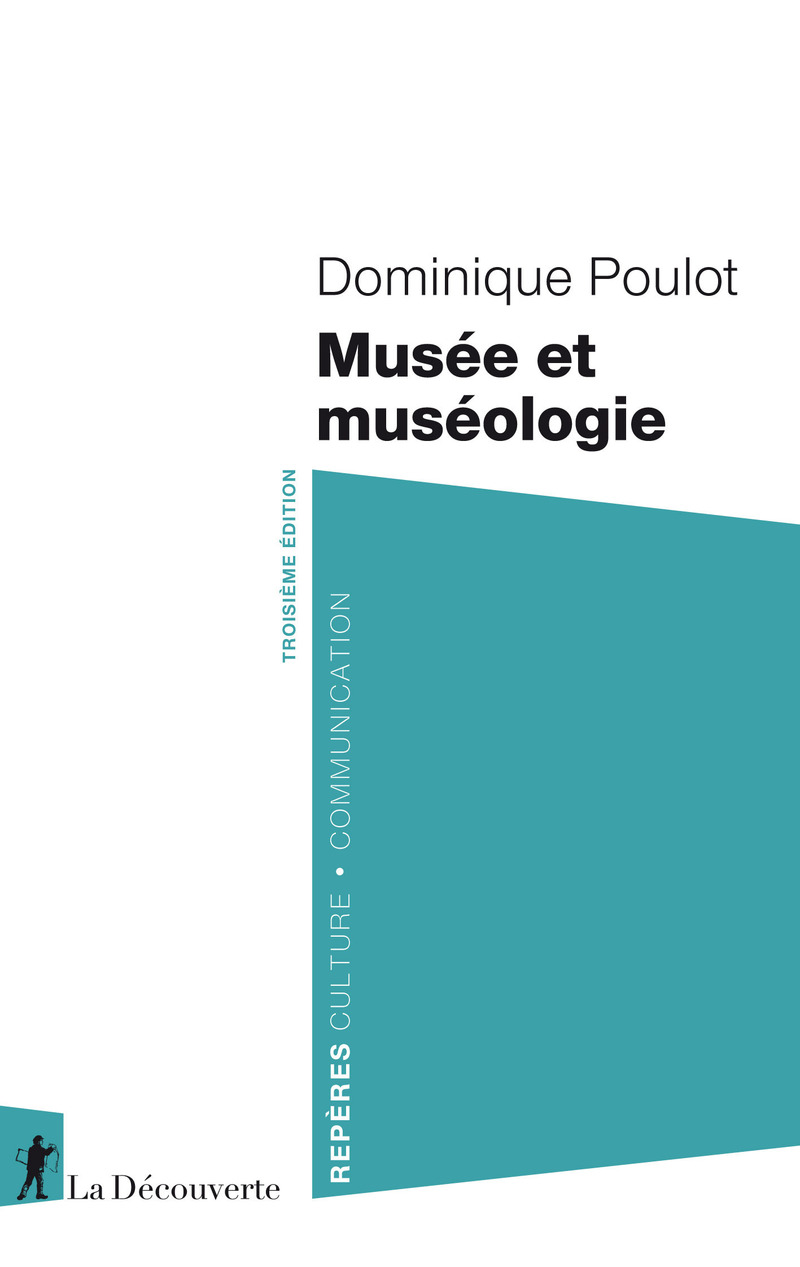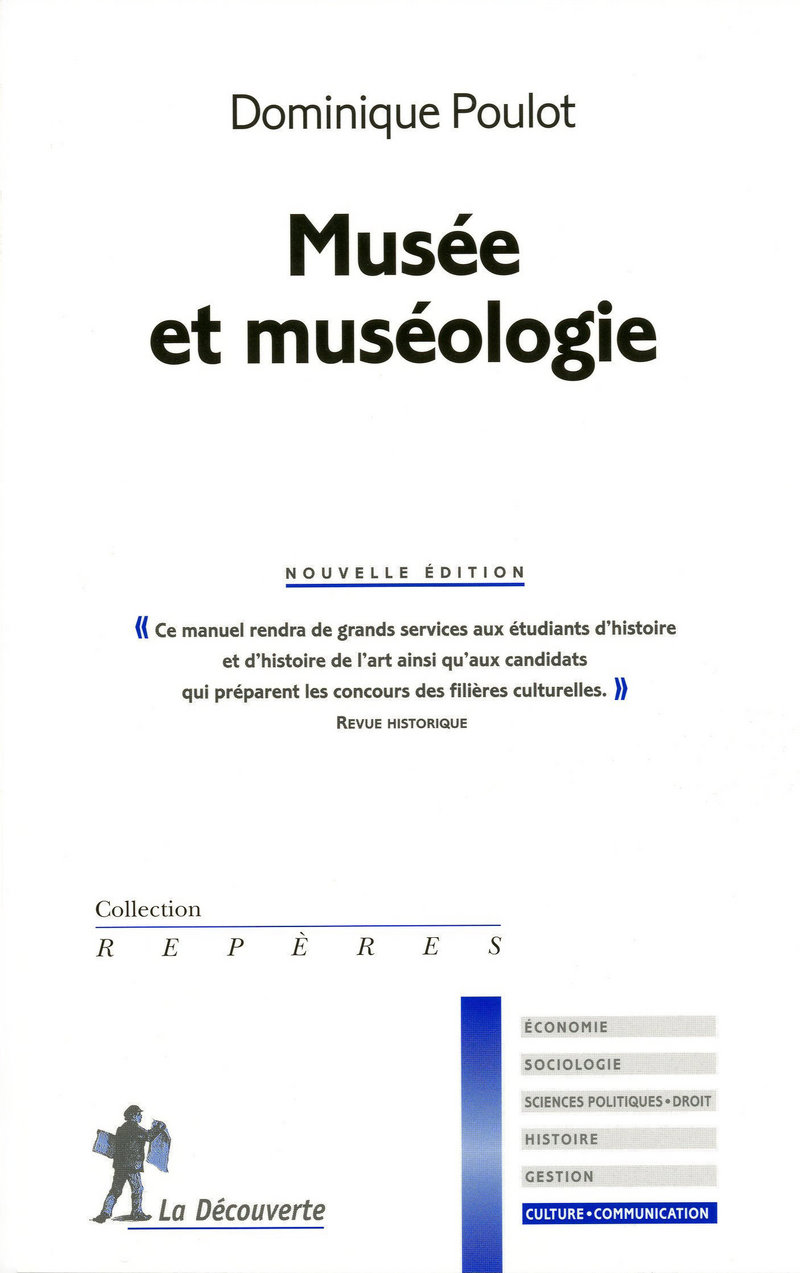Une histoire des musées de France, XVIIIe - XXe siècle
(XVIIIe-XXe siècle)
Dominique Poulot
Les musées français ont été largement renouvelés et remodelés, voire reconstruits, depuis une génération : ils suscitent aujourd'hui un attachement unanime de la part d'un public de plus en plus nombreux. Mais cette mutation spectaculaire a souvent conduit à célébrer les progrès accomplis au détriment de la mémoire des lieux et des hommes. C'est ce que montre Dominique Poulot dans cette histoire originale des musées de France. Dans son moment fondateur, en rupture avec le secret des collections particulières, le musée a voulu illustrer l'utilité publique de l'art et du savoir. Du XIXe siècle au XXe siècle, entre bureaux parisiens et conservateurs locaux, une institutionnalisation décisive s'accomplit – au service, selon les cas, des propagandes républicaines ou monarchiques. Les musées attestent du goût français, mettent en scène la profondeur historique de la nation, et participent à la construction d'identités collectives. La fin du XXe siècle voit surgir un nouveau modèle d'établissement, qui place les publics au centre de ses préoccupations et contribue au développement culturel comme à la définition d'un patrimoine. Ces deux siècles ont connu de nombreux conflits de musées, la disparition de certains, la reconversion radicale d'autres et, en guise d'innovations, quelques déménagements de collections. Loin d'une image stéréotypée de l'institution, l'auteur montre combien son histoire, dans ses rencontres plus ou moins réussies avec les visiteurs, témoigne d'engagements politiques et sociaux, autant que d'évolutions professionnelles et de configurations disciplinaires.

Nb de pages : 198
Dimensions : 12.5 * 19 cm
 Dominique Poulot
Dominique Poulot

Professeur à la Sorbonne (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), membre honoraire de l'Institut universitaire de France, Dominique Poulot se consacre à l'histoire des patrimonialisations. Il est l'auteur d'Une histoire des musées de France (La Découverte/Poche, 2008) et de nombreux ouvrages collectifs : Musées en Europe et 2002, genèse d'une loi sur les musées (La Documentation française, 2020 et 2022) ; L'Effet patrimoine (Presses de l'université Laval, 2025).
Table des matières 

Introduction : Une histoire politique des musées
I. Fondations : la loi de l'appropriation
1. Une culture d'amateurs
Les discours de la collection
Les lieux et l'agencement du collectionnisme
2. L'espace public du musée
Un espace de gouvernement
La justification administrative du musée
La langue des arts
Les arts et le politique
Le gouvernement des artistes
Le programme d'emploi des arts
L'amateur, une figure politique
3. L'invention d'une administration
L'enjeu politique de la muséographie
L'affirmation du conservateur
L'invention du musée de province
II. Contestations : une légitimité en débats
4. Le musée révolutionnaire, un musée vandale ?
La construction des collections
Une nouvelle idolâtrie ?
5. Le musée universel, une illusion chauvine ?
La légitimité des musées, affaire d'opinion ?
La construction de la légitimité muséale : la naturalisation des œuvres
6. Le musée d'histoire nationale, un dispositif partisan ?
Représenter l'histoire
Incarner une mémoire ?
III. Institutions : " Un cadre pour l'avenir "
7. Protester de l'universel
Un musée égyptien ?
Un horizon commun des origines
L'Égypte des images
L'histoire insignifiante
8.Témoigner du contemporain
Un événement-monstre et ses images
Survivre à Waterloo
9. S'inscrire dans le local
L'affirmation des valeurs locales
IV. Médiations : la logique de la réception
10. L'édification
Le regard cultivé en débat
Des musées actifs
11. L'utile et l'agréable
Les visites légitimes
Aux marges de l'usage savant
Politiques de la visite
Loisir et sociabilité
Le triomphe du chef-d'œuvre sérieux
Une culture de masse ?
12. L'identité
L'écomusée et ses logiques territoriales
La nouvelle muséologie et ses logiques identitaires
Conclusion : Musées et modèle culturel français
Note sur la présente édition.