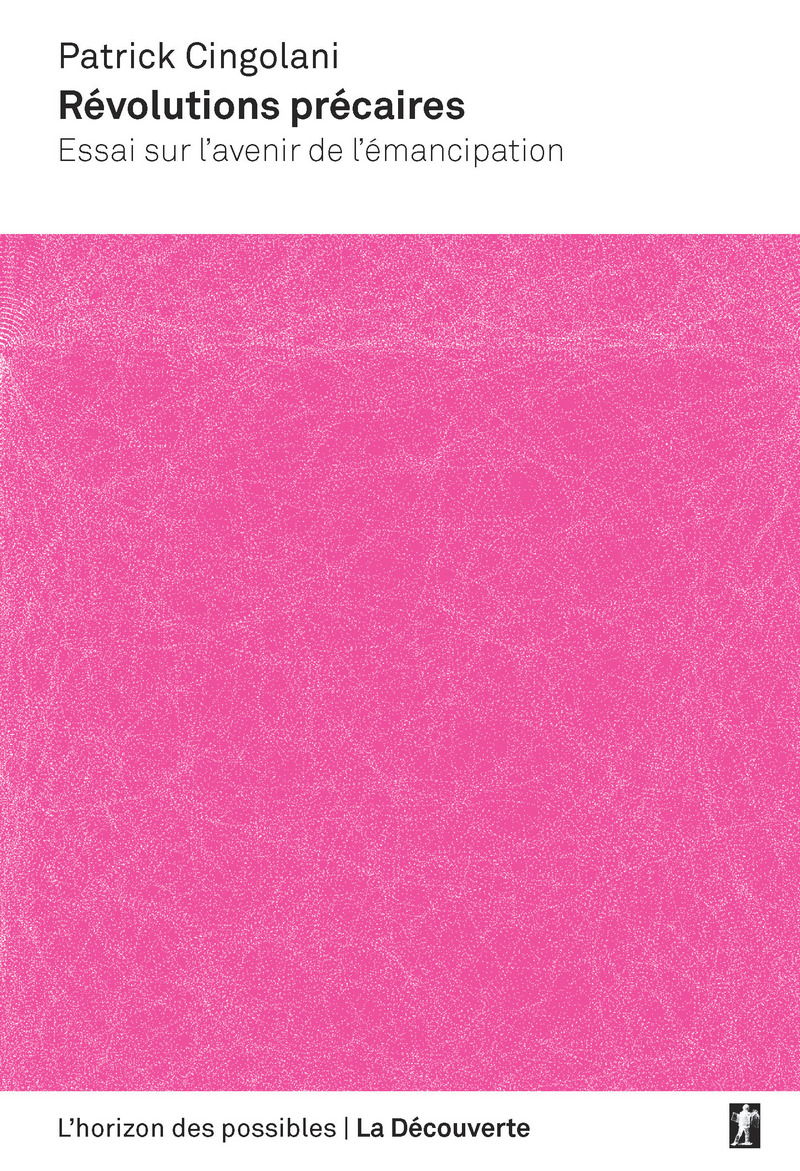Révolutions précaires
Essai sur l'avenir de l'émancipation
Patrick Cingolani
Depuis les années 1980, le mot " précaire " est teinté d'ambivalences. Il désigne en effet à la fois ceux qui subissent les nouveaux modes de fragmentation et de flexibilisation du travail et ceux qui développent des tactiques alternatives de vie et d'emploi. C'est cette double acception que ce livre tente d'analyser. Il faut en effet comprendre, d'une part, que l'expérience du travail non subordonné, notamment chez les travailleurs du savoir et de la culture, les plus touchés par ce phénomène, reconduit la dissymétrie et l'opacité d'un rapport social qui permet d'autant mieux de les exploiter... Et, d'autre part, reconnaître la part active, positive, de ces pratiques disruptives, dans une période où le processus de précarisation s'étend au-delà des classes populaires et touche les classes moyennes.
Sans nostalgie à l'égard du salariat, qui a institutionnalisé la subordination du travail, ce livre montre le potentiel libérateur de ces " révolutions précaires ". Il propose de repenser les luttes et le droit du travail à partir de la contestation des nouvelles formes de domination économique et de leurs puissances démultipliées d'exploitation. Il cherche ainsi à penser l'avenir de l'émancipation, c'est-à-dire à comprendre comment les luttes de cette " nouvelle plèbe " peuvent s'articuler à un mouvement ouvrier replié sur les figures spécifiques du travailleur industriel et du salariat ; à montrer quelles sont les conditions d'émergence de mobilisations à distance des organisations bureaucratiques antérieures ; à mettre au jour les configurations militantes et syndicales qui peuvent agréger les sociabilités et les solidarités propres à la " vie précaire " ; et à déployer les valeurs politiques portées par ces formes de collectifs en gestation, à la rencontre du socialisme des origines et d'une écologie générale appliquée à la vie quotidienne.

Nb de pages : 148
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782707185150
 Patrick Cingolani
Patrick Cingolani

Extraits presse 

2014-12-13 - Anastasia Vécrin - Libération
Plusieurs décennies après que le terme de " précarité " s'est imposé comme le symbole de maux que la critique sociale ne peut faire que dénoncer sans en enrayer la progression, il y a de l'audace à soutenir, comme Patrick Cingolani le fait dans Révolutions précaires, que l'avenir de l'émancipation doit être recherché du côté des " formes de liberté des précaires ". On pourrait objecter, comme P. Cingolani l'a écrit lui-même, qu'" il n'y a pas de précarité qui soit une liberté " et que " ceux qui le disent, à droite ou à gauche, se bercent et bercent d'illusion ". Sans renier cet avertissement, Révolutions précaires se penche sur les pratiques et les expériences de travailleurs précaires, pour montrer qu'elles sont ambivalentes plutôt qu'unilatéralement dominées, et que cette ambivalence recèle des pistes de réponse à plusieurs des impasses dans lesquelles sont actuellement enlisés les efforts d'émancipation. Cette proposition est l'aboutissement d'un parcours de recherche de long cours, qui s'est caractérisé dès l'origine par un investissement du lexique de la précarité en tension avec ses usages dominants.
2015-01-12 - Cyprien Tasset - La Vie des Idées
Alors que la précarité ne cesse de gagner du terrain, Patrick Cingolani invite à la penser de manière ambivalente. Au-delà de la contrainte imposée aux travailleurs de tous âges, la précarisation des jeunes actifs constituerait également " le ferment alternatif " qui a donné corps à des mouvements sociaux comme les Indignés ou Occupy Wall Street. À la suite d'André Gorz, le sociologue part à la recherche de ceux qu'il nomme, comme Jacques Rancière, les " nouveaux plébéiens ", dont " le mode de vie explore la tension entre posture égalitaire et inégalités sociales ". Pour mettre un frein à la démesure capitaliste d'une accumulation de richesses toujours plus inégale, pour " renouer avec la charge utopiste du XIXe siècle ", les jeunes précaires seraient selon l'auteur en première ligne pour refonder les modes d'organisation politique et les contestations à venir. " Un mouvement de précaires saura-t-il porter la sobriété de l'égalité contre la puissance mortifère de l'avidité inégalitaire ? "
2015-01-16 - Nicolas Mathey - L'Humanité
Fini le temps où le prolétariat réclamait avant tout une augmentation de son pouvoir d'achat. Pour le sociologue Patrick Cingolani, aujourd'hui, les travailleurs aspirent surtout à davantage d'autonomie. Le mot " précaire ", dont l'introduction en sociologie date des années 1980, apparaît avec la massification de formes atypiques de contrat (CDD, intérim, temps partiel...). Il présente aussi une dimension positive : celle de la recherche d'une alternative à la logique tayloriste, jugée aliénante. Plus diplômés que leurs aînés, les jeunes des classes populaires et des classes moyennes recherchent un travail leur permettant de s'épanouir, de " faire ce qui leur plaît ". En parallèle de la société salariale, se développe la " polyactivité " : certains travailleurs mènent de front une activité " alimentaire " et une activité " passion ", peu ou pas rémunérée dans l'espoir à terme de se reconvertir et de vivre de celle-ci. P. Cingolani s'intéresse en particulier au cas des travailleurs des industries culturelles. Ces " intellos précaires " cherchent à accomplir des tâches " gratifiantes " même si cela implique un mode de vie simple et une certaine instabilité économique. Cependant, ces dernières années, avec la crise et une féroce concurrence, la valeur de leur travail s'est dépréciée. On pense, par exemple, aux revenus des photographes réduits à la portion congrue face à l'essor du numérique. Les inégalités se creusent parmi ces travailleurs atypiques entre ceux dont les proches peuvent assurer le soutien financier et les autres. L'autonomie des individus est en fait limitée par leur dépendance économique, au fur et à mesure que se développe une forme systématique d'exploitation de leur travail. Indépendants et intérimaires sont en effet mal défendus par les syndicats. La naissance d'espaces de coworking et de nouvelles formes de mobilisation laisse entrevoir, selon l'auteur, une première forme de résistance et de solidarité de ces travailleurs face à la précarité.
2015-02-01 - Florine Galéron - Sciences Humaines
Table des matières 

Introduction. Portrait du précaire en plébéien
Les précaires
La plèbe et les plébéines
Révolutions précaires
1. Précaires, précarité, précariat
Précaires, une brève histoire
Précaires, autonomie et nouvelles sensibilités
Les précaires des " industries culturelles "
2. Précariat et principe plébéien
L'ambivalence de l'autonomie parmi les travailleurs des " industries culturelles "
Flexibilité et précarité
En deçà et au-delà des classes moyennes
3. Subjectivités et mobilisations précaires
Nouvelles organisations et formes de vie précaires
Différences et convergences
4. Révolutions précaires et avenir de l'émancipation
Élargir les protections et les cadres de la prise de décision
Contre
l'hubris capitaliste
Virtù plébéienne et responsabilité écologique
Conclusion.