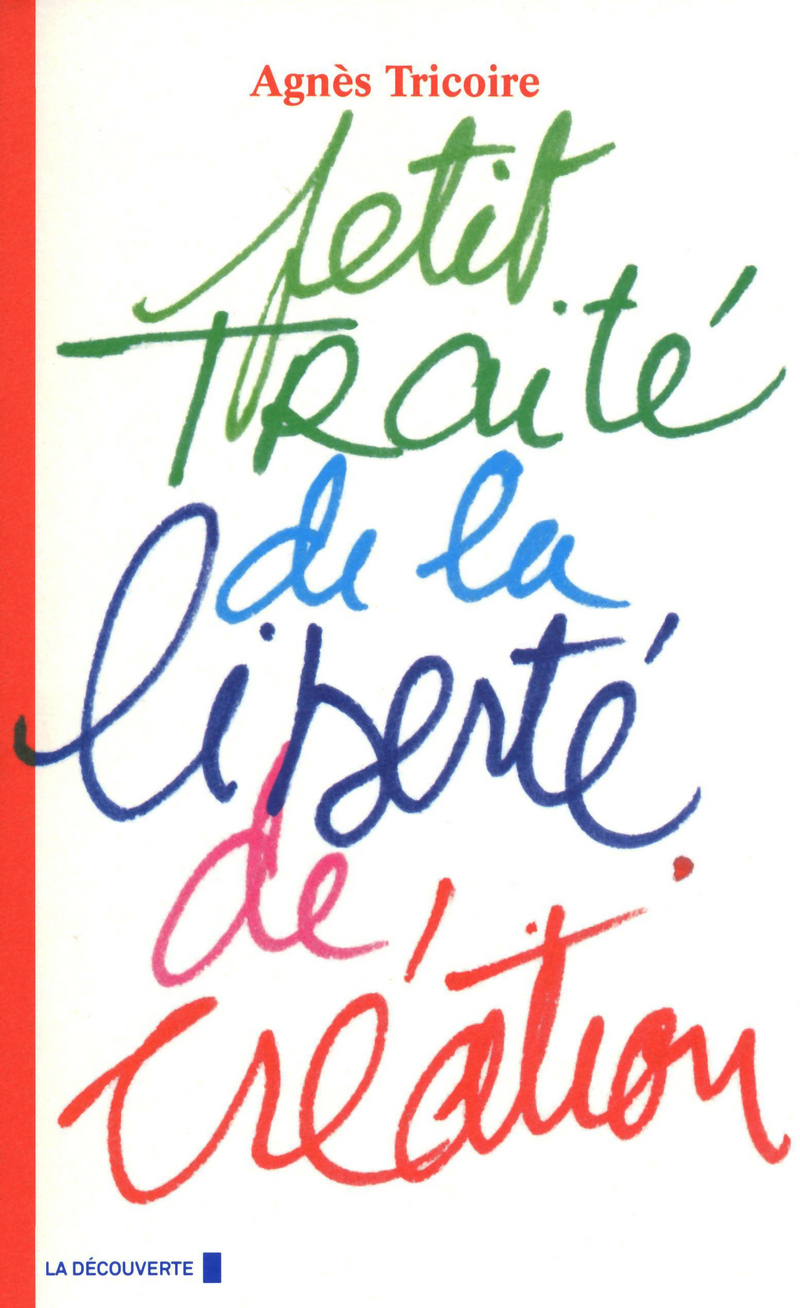Petit traité de la liberté de création
Agnès Tricoire
La liberté de création n'est prévue dans aucun texte de loi, aucun instrument juridique ne l'a pensée. La liberté d'expression est bien consacrée depuis plus de deux siè-cles par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais on ne trouve pas la moindre référence aux œuvres, ou à l'art, dans cette déclaration. Or les œuvres font débat. Et ce débat se déroule de plus en plus devant les tribunaux, la loi se montrant sans cesse plus contraignante et répressive. Qui doit juger les œuvres et selon quels critères ? De l'élu qui décide d'interdire telle exposition à la commission de classification des films qui applique des critères ouvertement subjectifs, la littérature, les arts plastiques, la chanson, le cinéma sont désormais passés au prisme des opinions de chacun, religieuses, morales, politiques.
L'art doit-il être soumis à des impératifs aussi variés et étrangers à sa sphère ? Comment définir la liberté de création ? Y a-t-il des limites acceptables, comme la vie privée ou le droit à l'image ? Comment répondre aux demandes de censure lorsqu'on est un élu ? Que se passe-t-il aux États-Unis, souvent cités en exemple ? C'est à toutes ces questions qu'entend répondre ce livre, en alimentant la réflexion juridique par d'autres disciplines (philosophie, narratologie, sociologie) et en prenant appui sur de nombreux exemples - de Michel Houellebecq à Philippe Besson, en passant par Larry Clark, François-Marie Banier, le groupe de rap Sexion d'Assaut et bien d'autres...
Plaidant pour que le public reste libre d'entrer en contact avec les œuvres sans que l'on pense à sa place, Agnès Tricoire dessine ainsi les contours d'une liberté de créa-tion qui s'enracine dans la liberté d'expression mais s'en distingue, parce que l'art n'est pas simplement du discours.

Nb de pages : 299
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782707167941
 Agnès Tricoire
Agnès Tricoire

Extraits presse 

Manifeste argumenté en faveur de l'"autonomie" de l'oeuvre d'art, "essentielle à la démocratie, dont elle est le signe de force", le livre d'Agnès Tricoire, avocat spécialiste des affaires de propriété littéraire et déléguée à l'Observatoire de la liberté de création, détaille les conséquences néfastes d'un certain vide juridique en ce domaine. Si la loi protége le droit d'auteur, elle néglige ou altère celui de créer librement qui devraient lui être attaché. "La liberté de création suppose que l'on se situe dans un registre particulier, non conditionné par un résultat externe à l'oeuvre". Pour définir cette "particularité", l'auteur convoque le droit mais aussi la philosophie et la critique littéraire. Cette dernière décennie, déplore-t-elle, a été marquée par un retour certain à l'ordre moral. La multiplication des procès contre des écrivains et des artistes le prouve.
2011-03-31 - Patrick Kéchichian - La Croix
Qui a dit en France qu la censure n'existe plus ? Si la liberté d'expression est consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, un certain nombre de dispositions légales l'encadrent (on parle de "classification" des films, de protection de la jeunesse"). Et surtout le principe de liberté d'expression ne protège en rien la liberté de création, que n'a pensé aucun instrument juridique. Avocate au barreau de Paris, déléguée de l'Observatoire de la liberté de création, Agnès Tricoire dresse dans un Petit traité de la liberté de création un tableau historique et actuel des entraves à la libre expression de l'artiste. Lancer ce débat est d'autant plus nécessaire que "l'époque actuelle, souligne-t-elle, est à la régression, au formatage et à a peur de montrer". Souvent, les tribunaux sont amenés à "traiter l'oeuvre comme si elle était la réalité". Pour sortir de cette ornière, l'avocate avance un "manifeste pour l'autonomie de l'oeuvre", avec quelques propositions dont il serait urgent de se saisir avant que la régression ne prenne davantage de champ.
2011-04-01 - Mouvement
Des oeuvres de rap, de littérature ou d'art contemporain font aujourd'hui les frais de censures politiques ou de procédures juridiques insultantes. Agnès Tricoire, avocate et spécialiste en propriété intellectuelle, s'inquiète de "l'état de confusion de notre morale juridique". La fondatrice de l'Observatoire de la liberté de création se penche, dessine dans un trait fouillé, les contours d'une liberté qu'aucun texte de loi ne prévoit. Sa proposition en faveur d'un manifeste milite pour qu'enfin l'on cesse de prendre le spectateur pour un idiot à protéger de manière autoritaire.
2011-04-01 - Aline Pénitot - Regards
On prête au droit les apparences froides de l'objectivité ; on s'y réfère parfois comme à une inoxydable unité de mesure. Dans son Petit Traité de la liberté de création, Agnès Tricoire nous rappelle à bon escient que c'est avant tout une matière humaine qui ne parvient jamais totalement à réduire nos passions. Et cela est plus vrai encore quand il s'agit de codifier la plus subjective de nos activités : la création artistique. Mais aussi quand il est question de l'image de chacun dans l'espace public ou du respect de la vie privée. Autant de sujets abordés par cette avocate au barreau de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle, qui analyse, à partir de cas concrets, les motivations des jugements, et parfois leurs contradictions.
2011-04-07 - Denis Sieffert - Politis
Après Marcela Iacub théorisant "la liberté d'expression à l'âge de la démocratie délibérative" et Gisèle Sapiro racontant "la responsabilité de l'écrivain", c'est au tour d'Agnès Tricoire, avocate, de livrer un essai roboratif et contondant sur les formes contemporaines de censure. Maniant avec brio la formule ("les œuvres sont dangereuses ? Beaucoup moins que la réalité") et la provoc ("si j'avais des enfants américains, je préférerais que les héros qui s'offrent à eux disent des gros mots, copulent joyeusement et soient moins guerriers"), Tricoire plaide pour que le "jugement de droit" ne se confonde plus avec le "jugement de goût" et donc pour un droit fondé sur l'"autonomie de l'œuvre", ne prenant plus celle-ci pour un "message" (même si elle peut en contenir un). Avant d'en arriver là, l'auteur hache menu quelques sophismes esthétiques. Car c'est la haine de l'art contemporain qui est pour elle en jeu dans les récentes tentatives (et parfois réussites) de censure. Elle revient entre autres sur les délires de ceux qui confondent fiction et réalité, et voient par exemple dans une photo d'Elke Krystufek (Love by Memory) de la pornographie alors que l'image montre simplement l'artiste nue jouant avec des poupées. Selon cette logique, note Tricoire, il faudrait vite interdire la Mort de Sardanapale de Delacroix et tous les Christ en croix, "d'un sadisme insoutenable".
2011-04-07 - Eric Loret - Libération
L'époque actuelle est à la régression, au formatage et à la peur de montrer. " Agnès Tricoire n'y va pas par quatre chemins, dans son essai brillant et gouailleur Petit Traité de la liberté de création. Pour cette avocate parisienne spécialiste en propriété intellectuelle, " depuis l'après-guerre, et contrairement à certaines idées reçues, l'appareil législatif qui permet la censure, confiée au gouvernement, ou la répression des oeuvres, confiée aux tribunaux, n'a fait que se renforcer ". S'il s'agit pour elle de dénoncer l'emprise grandissante d'associations d'extrême droite, qui voudraient formater l'art en s'emparant des outils juridiques à disposition, force est de constater que les attaques contre la création ont pris récemment des formes multiples. A commencer par l'assignation d'écrivains pour atteinte à la vie privée, par les personnes réelles qu'ils ont mises en scène dans leurs romans.
2011-05-07 - Marine Landrot - Télérama
Dans son Petit traité de liberté de création, l'avocate Agnès Tricoire montre que la censure n'a pas disparu et livre un plaidoyer revigorant en faveur d'une liberté de création quasi-illimitée.
2011-06-22 - Elisabeth Philippe - Les Inrockuptibles
Table des matières 

Remerciements
Introduction : La liberté d'expression protège-t-elle de la liberté de création ?
I / Comment définir la liberté de création dans le contexte actuel ?
1. La liberté de créer sous haute surveillance aux États-Unis
Les œuvres et le Premier Amendement
Quelques cas concrets de censure aux États-Unis
2. Pour en finir avec l'idée que l'État n'y est pour rien
L'État censeur
La protection de la jeunesse contre les imprimés
La loi pénale et la liberté de l'art
La censure des " responsables "
3. La grande hypocrisie de la protection de l'enfance
Qu'interdire aux mineurs ?
La littérature et l'art contemporain au banc des accusés
Une loi symbolique ?
La protection de l'enfance comme prétexte
Les nouveaux héros et les nouveaux zéros
Les trois enfants et le cinéma
L'enfant capable de juger grâce à l'éducation
La censure des films : le durcissement de la protection de l'enfance
De la protection de l'enfance à celle de la dignité
4. Le mobile inavouable de la censure : le climat réactionnaire et la haine de l'art
Le baiser de trop
Violence des œuvres ou violence de la polémique sur les œuvres ?
Les artistes entre le marteau de la censure et l'enclume de l'accusation de folie
Jugement de goût, bon sens et sens commun
Retour sur le nominalisme : Duchamp après Kant
La loi est du côté des artistes prétendument transgressifs
5. Jugement de goût ou jugement de droit, comment juger l'œuvre ?
La nature du jugement de droit sur l'œuvre
Le droit d'auteur et l'évaluation de l'œuvre
La distinction idée/forme au soutien d'une tentative de censure des œuvres d'art contemporain
La censure, l'idée et la forme
L'idée sans la forme
6. Manifeste pour l'autonomie de l'œuvre
La norme, la loi et l'œuvre
La censure illégale, quotidienne et banale
La politique
Les mœurs
La religion
L'autonomie de l'œuvre : l'origine du principe
Les deux morales
La liberté de l'art comme principe démocratique
La transformation du pacte de fiction
La presse plus libre que l'art ?
D'hier à aujourd'hui : l'art et " notre " morale commune
Que faire de l'art engagé ?
Quelques propositions pour lutter concrètement contre la censure et respecter l'autonomie des œuvres
7. De l'exception artistique à l'exception de fiction
Quelques considérations générales et distinctions opportunes pour cerner juridiquement la notion de fiction
Le réel de la fiction
Les bénéfices de la fiction
Les dix axiomes de la fiction
Et la non-fiction ?
Le rap, entre fiction et réalité
II / La liberté de création à l'épreuve de la pratique
8. La forme unique et l'idée unique : le cas particulier du délit de blasphème
Le délit de blasphème n'existe pas en France... mais la CEDH valide les législations européennes qui le prévoient
Le délit de blasphème n'existe pas en France... mais certains voudraient le voir ressusciter
Les intégristes catholiques
L'Église catholique
Les musulmans
9. Quand un personnage tient un discours raciste, la fiction exclut le délit. L'affaire " Pogrom "
La saisine de la justice : une décision politique
1er principe : la liberté de création est plus large que la liberté d'expression
2e principe : l'apologie n'est pas la représentation
3e principe : pour juger une œuvre, il faut la lire en entier
4e principe : pour juger l'intention de commettre un délit dans une œuvre, il faut juger sa réception
5e principe : pour juger une œuvre, il faut juger sa nature
6e principe : les propos fictionnels de personnages fictionnels ne sont pas punissables
7e principe : refus de l'argument biographique dans l'œuvre de fiction
8e principe : un roman n'est pas un message (pornographique et violent)
Le problème de la dédicace
En conclusion, retour sur l'accusation
10. Fiction et personnes réelles : littérature et vie privée
Le cas particulier de l'autofiction
Romans et faits divers : diversité des positions éthiques et des décisions rendues
Le droit au nom n'est pas opposable à la fiction
Nature du récit, position de l'auteur
Philippe Besson et position du lecteur
L'atteinte à la vie privée par l'invention : l'affaire du renard breton
L'atteinte à la " fausse " vie privée
Le déficit de fiction et l'atteinte à la dignité
11. La protection de la réputation face à la liberté de la fiction
Le sens de la forme : retour sur L'enfant d'octobre
L'exception artistique mise en échec : Le procès de Jean Marie Le Pen de Mathieu Lindon
Les succès de l'exception artistique et de l'exception de fiction devant la CEDH
Experts c/liberté
Quand la liberté de la caricature triomphe de la dignité d'un homme politique : l'affaire Otto Mühl
12. Les œuvres et les visages. Photographies, vie privée et droit à l'image
L'image de soi dans l'espace public
De l'image des morts aux expositions de cadavres
Trois questions que l'on peut poser à la presse : Quelle image ? Pourquoi la montrer ? Comment la montrer ?
Le corps humain mort comme objet d'exposition
L'image de soi dans l'œuvre d'art
Faits anodins et vie privée
Droit à l'image et liberté de création
Le caractère artistique ou documentaire
Dignité et subjectivité
Conclusion
Index