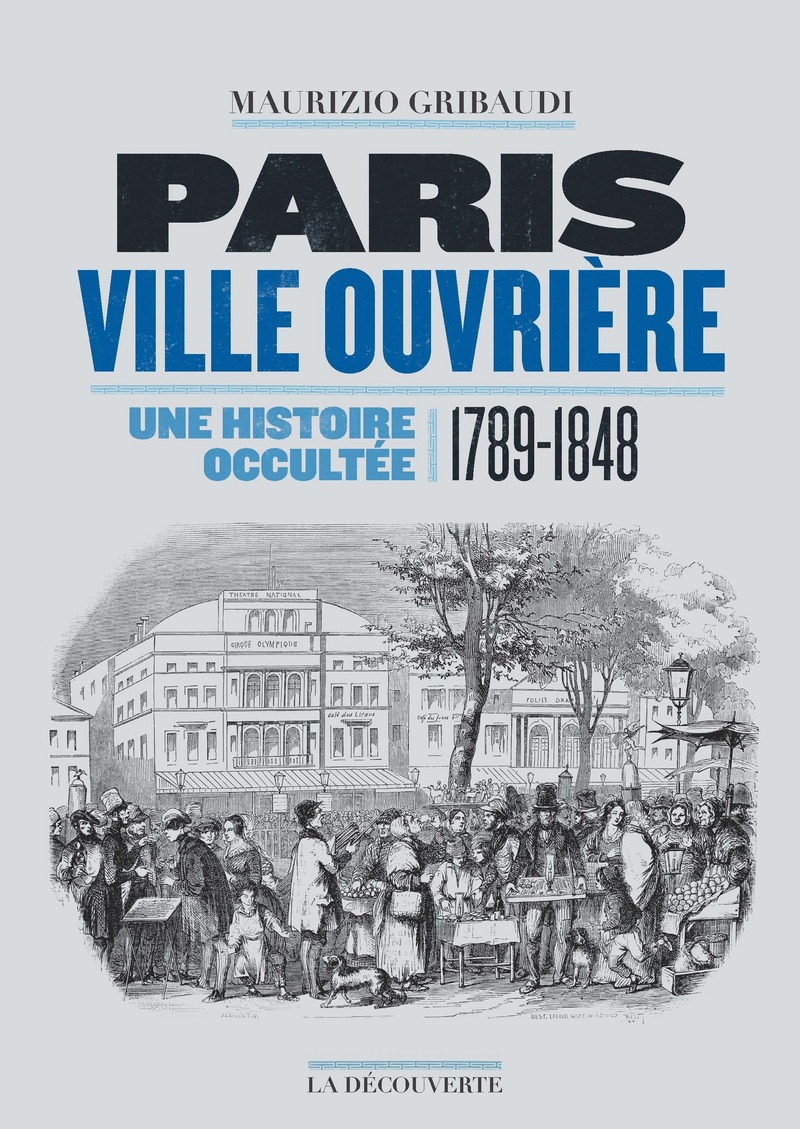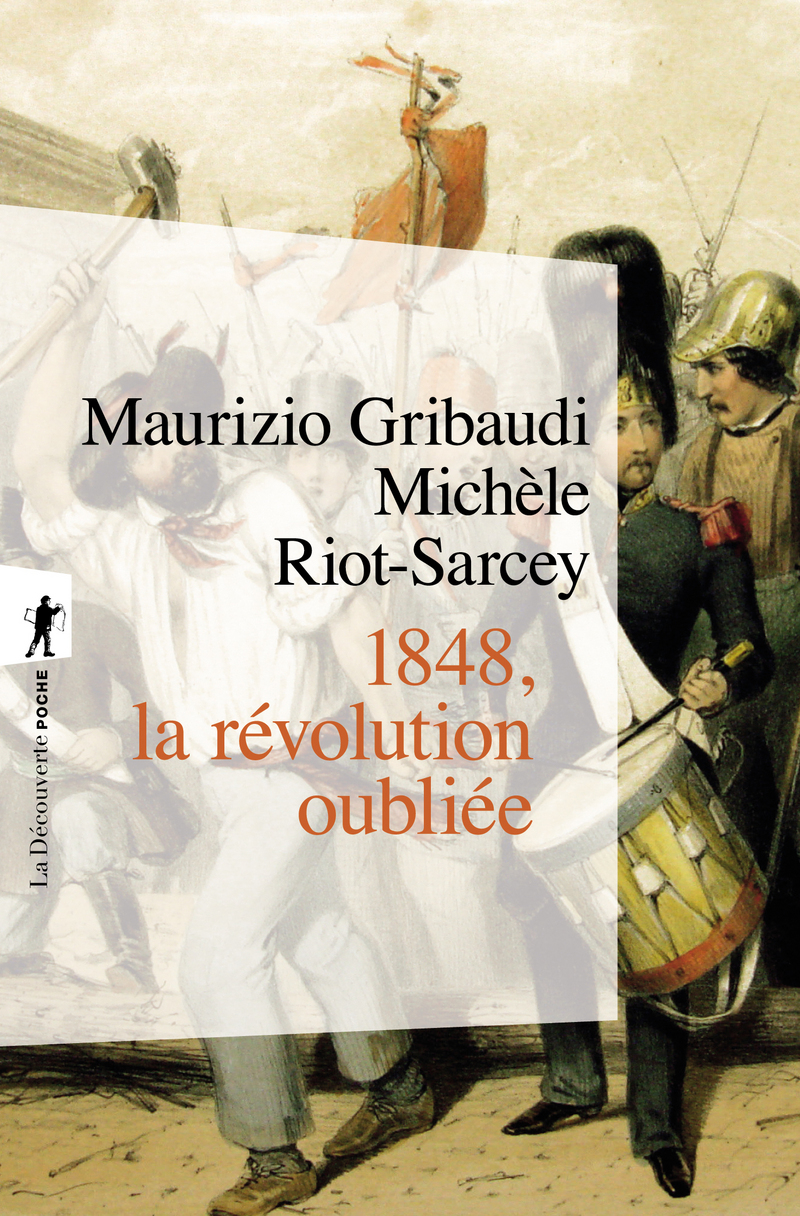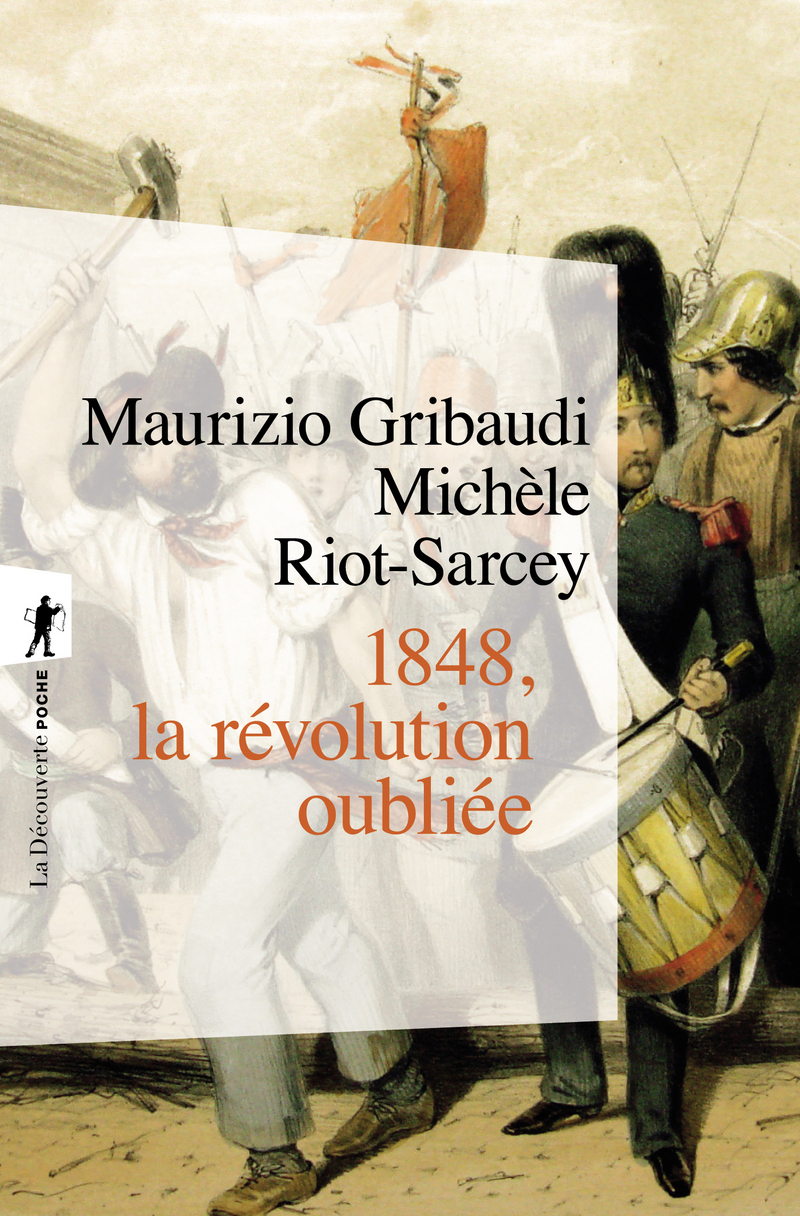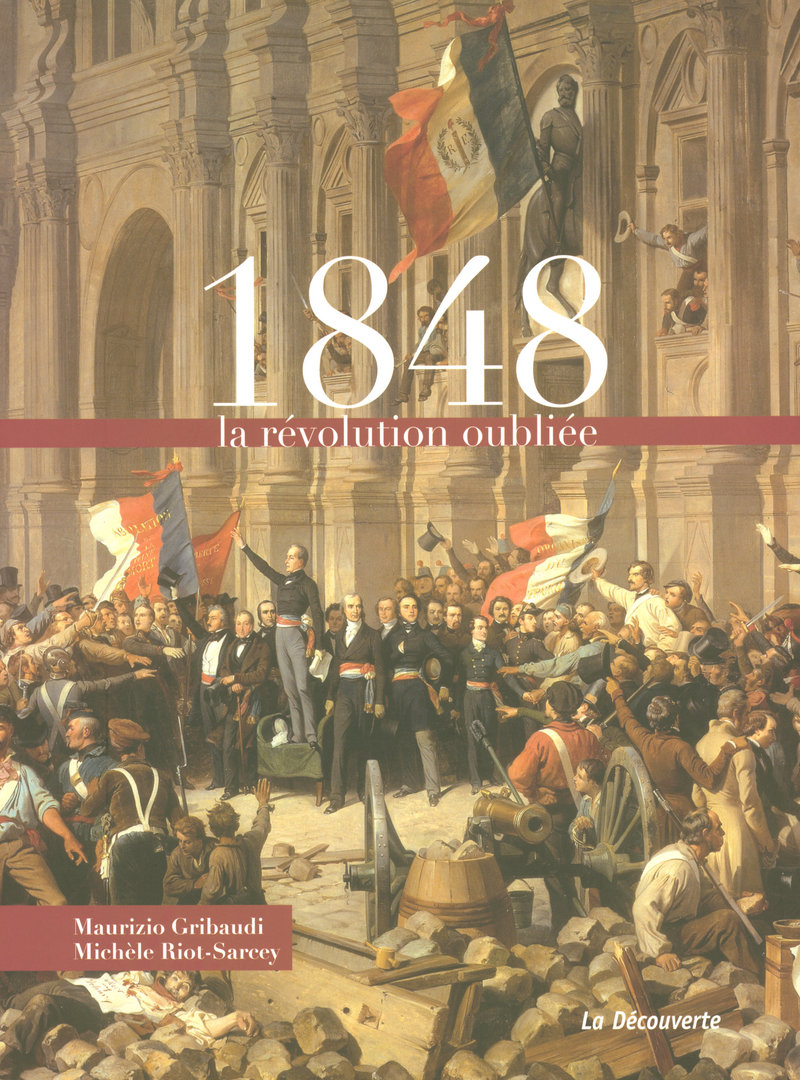Paris ville ouvrière
Une histoire occultée (1789-1848)
Maurizio Gribaudi
Les historiens qui se sont intéressés au Paris de la première moitié du XIXe siècle ont souvent célébré la modernité de la ville bourgeoise qui se développe à l'ouest et autour des Grands Boulevards, et considéré les quartiers du centre et de l'est comme des espaces structurellement immobiles et à l'écart du progrès.
S'appuyant sur des archives peu explorées, voire inédites, ce livre propose une vision renouvelée de ce Paris populaire : il montre au contraire qu'il s'agit de lieux extrêmement dynamiques, dans lesquels se développent des formes de production tout aussi novatrices qu'économiquement efficaces. Et dans lesquels se construit progressivement un modèle de modernité propre au monde ouvrier, fondé sur la demande de démocratie locale et sur une vision participative de la société. Derrière les représentations de la modernité du Paris bourgeois, si souvent célébrée, on lit donc la présence d'une autre modernité, qui a germé dans l'horizon ouvrier de la première moitié du XIXe siècle et fleuri le temps d'un instant dans les printemps 1848 et 1871.
Si la répression de ces mouvements a brisé cet élan, le souvenir de la République démocratique et sociale rêvée par le mouvement ouvrier a cependant laissé ses traces dans la société française, et l'on voit aujourd'hui ressurgir certaines thématiques qui en sont héritées (la demande de démocratie directe et de nouvelles formes d'organisation du travail, le modèle associatif comme base de solidarité nationale).
Enrichi par de nombreux documents d'époque et une cartographie originale, le livre de Maurizio Gribaudi offre une immersion passionnante dans ce Paris ouvrier du XIXe siècle.

Nb de pages : 445
Dimensions : * cm
 Maurizio Gribaudi
Maurizio Gribaudi

Maurizio Gribaudi, directeur d'études à l'EHESS, est notamment l'auteur de Itinéraires ouvriers. Espaces et groupes sociaux à Turin au XXe siècle (EHESS, 1987) et Espaces, temporalités, stratifications (EHESS, 1999) et, avec Michèle Riot-Sarcey, de 1848, la révolution oubliée (La Découverte, 2008).
Extraits presse 

2014-10-31 - Laurent Lemire - Livres Hebdo
Paris est-il une ville ouvrière ? Au milieu du XIX° siècle, les prolétaires représentent près de 40% de la population. A partir de nombreux documents d'époque, souvent inédits, et d'une cartographie originale, Maurizio Gribaudi nous offre une immersion passionnante dans le Paris ouvrier.
2014-11-01 - A Paris
Maurizio Gribaudi, historien du XIXe siècle et de la classe ouvrière, signe ici un volumineux ouvrage sur un aspect, à ses yeux minimisé, de l'histoire sociale parisienne : la formation et la consolidation de liens sociaux et politiques dans les quartiers populaires du centre ville, de la Révolution de 1789 jusqu'à celle de 1848. Comme l'indiquent le sous-titre de l'ouvrage et l'introduction, Gribaudi cherche donc à restituer une " histoire occultée ", ou du moins déformée, par le fait que l'historiographie a généralement tendu à relayer les discours dominants des observateurs des quartiers populaires de l'époque, discours progressivement dominés par l'inquiétude, voire le mépris.
2014-11-26 - Jonathan Louli - Liens socio
Il est des livres plus ou moins ambitieux. Celui-ci l'est assurément, puisqu'il aspire à renouveler en profondeur notre connaissance du Paris du XIXe siècle et de l'entrée du pays dans la modernité. Récusant le tableau d'une ville gangrenée par la misère, la maladie, le crime et l'insalubrité, tel qu'il fut dressé par les médecins et les observateurs sociaux du temps, Maurizio Gribaudi soutient que Paris fut alors le laboratoire d'une autre modernité, sociale autant que politique, étouffée par les contemporains et occultée par les historiens.
2014-11-27 - Dominique Kalifa - Libération
Paris comme vous ne l'avez jamais vu : le Paris ouvrier mais aussi artisanal de la première moitié du XIXe siècle, quelque peu oublié. L'auteur, historien, est parvenu à le reconstituer au prix de plusieurs années de recherche, avec son atmosphère, son ambiance sonore (on y chante beaucoup !), en épluchant méticuleusement les archives encore disponibles - textes savants ou littéraires, actes notariés, gravures, échos de la presse de l'époque. Un Paris populaire, certes avec ses coupe-gorge, ses immeubles vermoulus et ses ruelles étroites, mais aussi ses quartiers animés et vivants, ses gargotes et ses guinguettes, en pleine croissance démographique (la population double jusqu'à atteindre le million dès le milieu du XIXe siècle). D'abord traumatisé durablement par l'épidémie de choléra de 1832, qui justifiera sa stigmatisation par les hygiénistes, il sera ensuite balayé par la révolution de 1848 et le Paris haussmannien de la bourgeoisie triomphante. Non sans regret pour l'auteur, car à travers son riche tissu d'ateliers et de fabriques, fondé sur la coopération et le secours mutuel, l'alliance entre la science et la technique, enfin, acquis aux principes d'une république démocratique et sociale, ce Paris a élaboré par le bas une nouvelle modernité, d'essence ouvrière, pas si indigne d'intérêt.
2015-01-01 - Sylvain Allemand - Alternatives économiques
Le livre de Maurizio Gribaudi reprend ce qu'on doit savoir de "peuple de Paris", dans son mode de constitution à partir de la "fabrique parisienne" postrévolutionnaire: un peuple vivant, dense, actif, présent au centre de la capitale. C'est sur lui que le boulevard jette un regard romantique et réducteur, mais ce peuple qui travaille n'est pas misérable, et il finira par se politiser de façon autonome. Le grand mérite de ce volume est de cartographier les phénomènes évoqués.
2015-01-16 - Maïté Bouyssy - La Quinzaine littéraire
Contre l'occultation du caractère ouvrier de Paris dans la première moitié du XIX° siècle, Maurizio Gribaudi, directeur d'études à l'EHESS, propose un livre passionnant, riche d'un nombre considérable de cartes et de plans. L'étude des représentations de la ville par les élites, traumatisées en particulier par l'épidémie de choléra de 1832, montre d'abord combien ces discours manquent la réalité des transformations alors à l'oeuvre. Car le ville s'industrialise à vive allure à partir des guerres de la Révolution et devient une "fabrique collective" rassemblant plus de 340 000 ouvriers à la fin des années 1840. Or, ils vivent et travaillent dans des espaces profondément remodelés par la vente des biens nationaux. A partir d'exemples très précis, l'auteur démontre combien ces îlots deviennent des usines à ciel ouvert, où se côtoient artisans, petits patrons et ouvriers. Cette proximité induit une sociabilité, mais aussi des pratiques festives et revendicatives, dont la dimension politique est croissante à partir des années 1830. Il y aurait ainsi une montée vers la politique qui culmine en juin 1848, directement issue d'une expérience sociale. Forts d'une connaissance fine de leur travail et des iniquités qu'ils subissent, les ouvriers rêvent d'une modernité alternative, qui passe par l'association et la coopération. C'est cet espace ouvrier parisien que Haussmann ensuite s'acharne à détruire. La démonstration est impeccable et fait de l'ouvrage un maître livre d'histoire sociale et spatiale du politique.
2015-03-01 - Les Collections de l'Histoire
Table des matières 

Remerciements
Introduction
I / La progressive cristallisation d'un mythe
1. Après la Révolution, une société qui s'interroge
Les maladies d'une ville
Clairsemer l'espace
Le regard littéraire, entre ethnographie et pittoresque
Ruines et vestiges, le suranné et le pittoresque du centre-ville
2. La rupture des années 1830
Les hygiénistes et le choléra
Nouveaux élus et nouvelles peurs
Les jeunes romantiques et le pouvoir : un regard " gothique " s'impose à la ville
Moyen Âge et modernité
3. Le regard sur la ville s'appauvrit
L'insalubrité morale
Visions des édiles et utopies radicales
L'émergence des physiologies sociales
Misérabilisme et philanthropie
La caricature de boulevard
Le Moyen Âge redevient ruines
II / Derrière l'écran du mythe, les autres modernités parisiennes
4. L'impact de la Révolution
L'essor démographique
La vente des biens nationaux
Une industrialisation " organique "
Un artisanat industriel renouvelé
5. Une autre modernité
La densification des quartiers du centre-ville
Nouveaux riches et anciens bourgeois
Ateliers et fabriques
Le nouvel essor économique du centre-ville
6. Horizons populaires
Les formes de la fabrique collective
Une autre forme de l'espace populaire
Tramage urbain et tramage social
Solidarité de rue et solidarité de métier
Variations locales...
III / L'horizon perdu de l'autre modernité parisienne
7. La " montée vers la politique "
Chant et expression politique
Goguettes et guinguettes
Les sociétés de secours
Coalitions et grèves
Franc-maçonnerie et mouvement ouvrier
8. 1830-1834, quatre ans de luttes
Juillet 1830, découverte d'une force
Les attentes ouvrières d'une victoire confisquée
Une ville en mouvement
Émeutes et insurrections
9. 1840, la décennie socialiste
Grèves et coalitions
Mouvement républicain et monde ouvrier
L'association comme base sociétale
Le politique est là ! Le savoir bourgeois est nu
Conclusion
L'insurrection de 1848
Une autre République et un autre savoir
Notes
Index des noms
Index des lieux.