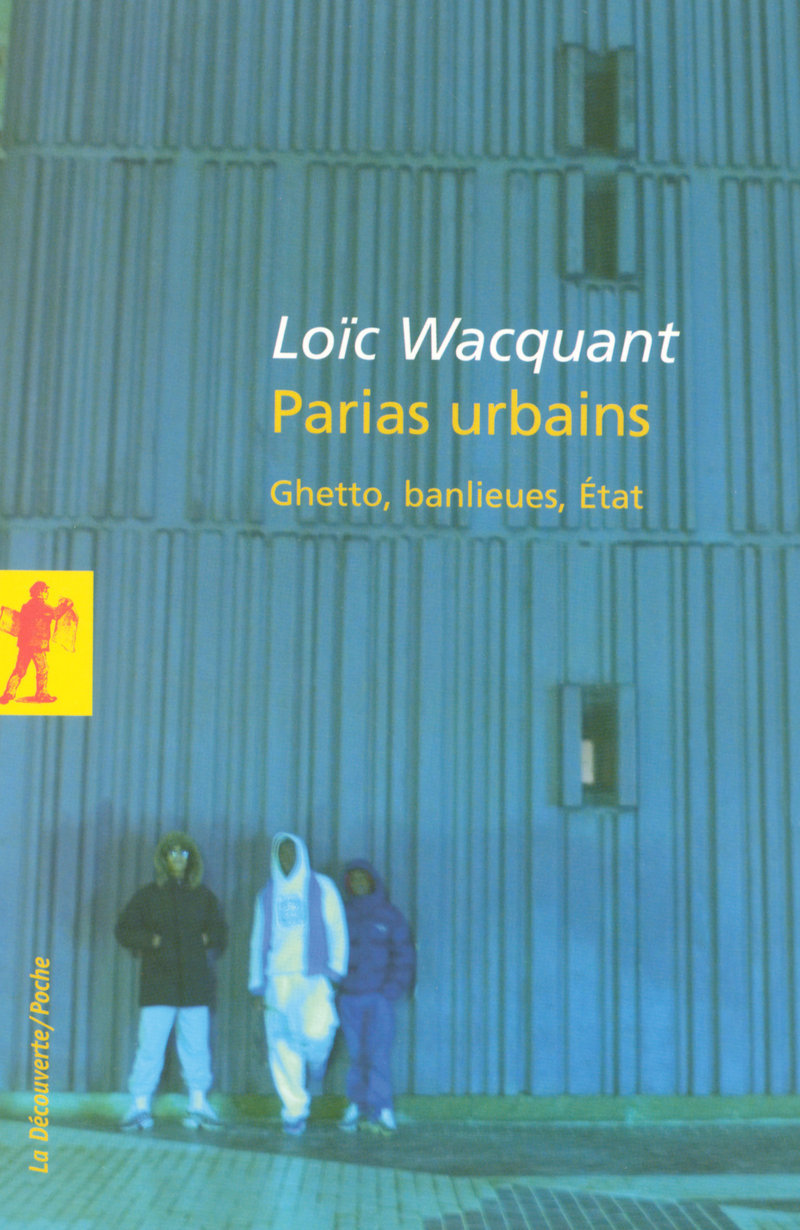Parias urbains
Ghetto, banlieues, État
Rompant avec le biais exotisant des discours politique et médiatique, ce livre emmène le lecteur au sein du ghetto de Chicago et d'une cité déshéritée de la banlieue industrielle de Paris. Où l'on découvre que la marginalité urbaine n'est pas partout tissée de la même étoffe. Mêlant observations de terrain, données statistiques et rappels historiques, Loïc Wacquant montre que l'implosion du cœur noir de la métropole étasunienne s'explique par le retrait de l'économie salariale et de l'État-providence favorisé par des politiques publiques de ségrégation et d'abandon urbain. Quant à la prolifération des " quartiers à problèmes " au pourtour des villes européennes, elle n'annonce pas la formation de ghettos à l'américaine, mais traduit la décomposition des territoires ouvriers sous l'effet conjoint de la désindustrialisation, de la précarisation du travail, et du brassage ethnique de populations jusque-là cloisonnées.
Le travail de comparaison souligne le rôle-clef de l'État dans l'articulation des inégali-tés de classe, de lieu et d'origine des deux côtés de l'Atlantique. Elle révèle aussi l'émergence d'un nouveau régime de marginalité nourri par l'instabilité du salariat, le recul de l'État social et la concentration, dans des districts mal famés, de catégories dépourvues d'un langage collectif leur permettant de se forger une identité et des revendications collectives. En éclairant d'un jour nouveau le mélange détonant entre la misère, l'opulence et la violence dans les métropoles du Premier monde, Parias urbains offre des outils précieux pour revigorer le débat public sur les inégalités sociales et la citoyenneté.

Nb de pages : 336
Dimensions : 12.5 * 19 cm
ISBN numérique : 9782707178879
Extraits presse 

" D'un côté et de l'autre de l'Atlantique, habiter dans certains quartiers est vécu comme une sorte d'assignation à résidence, un véritable stigmate social. [...] Face à une marginalité que le marché est impuissant à résorber, il faut réaffirmer la primauté de la politique. Loïc Wacquant veut y croire encore [...]. "
LIBÉRATION
" Cet ouvrage pose avec pertinence deux séries de questions, les unes scientifiques, les autres politiques [et] montre on ne peut mieux que la pauvreté urbaine ne s'explique pas par des vices et des pathologies particuliers aux pauvres comme on le répète aux États-Unis ; il montre aussi que la banlieue française, quoi qu'en disent des intellectuels médiatiques en mal de vedettariat, n'évolue as vers le ghetto américain. "
L'HUMANITÉ
" La véritable force du propos tient du projet analytique (très ambitieux) d'observer les différences historiques et structurelles de chaque configuration étudiée [ghetto américain et banlieues françaises] et de rendre compte de leurs invariants. "
LIENS SOCIO
" Sociologue, Loïc Wacquant dénonce l'assimilation des banlieues françaises aux ghettos nord-américains. Si l'analogie est trop réductrice, elle rappelle pourtant combien la stigmatisation d'une population paupérisée permet aux politiques de se défausser. "
LES INROCKUPTIBLES
" Pour Loïc Wacquant, disciple de Pierre Bourdieu, l'enjeu de cette comparaison est aussi d'opposer une sociologie fondée sur les rapports économiques et sur l'action des protagonistes politiques à la diffusion des conceptions néoconservatrices, qui mettent en avant les comportements des individus et les modèles culturels. Il rejette l'américanisation à un double titre : comme explication de l'évolution des banlieues ouvrières européennes et comme réponse à ces évolutions. Il condamne une approche américaine qui met en avant la sécurité policière et judiciaire de préférence à l'aide sociale, vue comme un facteur de désocialisation plutôt que d'intégration. Son livre offre ainsi une contribution, d'autant mieux venue qu'elle est fortuite, aux débats français les plus actuels. "
LE MONDE
" La révolte des quartiers populaires, à l'automne 2005, a donné lieu à nombre de commentaires sur l'américanisation de la France et la ghettoïsation de ses banlieues. Parias urbains propose une analyse comparative et historique qui permet de réévaluer ces discours, et d'en montrer tant la faiblesse théorique que le danger politique. "
ROUGE
" Cet ouvrage [...] est une remarquable mise au point sur les conditions de production et de reproduction des parias urbains et des limites des politiques publique. "
URBANISME
" ...le livre de Loïc Wacquant se révèle riche d'enseignement sur les " quartiers " et leur pathologie. "
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
" ... un livre phare comparant le ghetto américain et les banlieues françaises... "
AVANT-GARDE
" Taille, criminalité, composition ethnique... Pour le sociologue Loïc Wacquant, une "cité" de chez nous est très différente d'un ghetto outre-Atlantique. "
GÉO
" Un outil précieux pour revigorer le débat public sur les inégalités sociales et la citoyenneté, et pour éclairer le regard porté sur ces quartiers par une France inquiète et prête à toutes les mesures démagogiques à court terme. "
L'ECOLE DES PARENTS
" Loïc Wacquant, professeur de sociologie à l'Université de Californie (Berkeley) et chercheur au Centre de sociologie européenne, nourrit par cet ouvrage, parfois difficile à lire mais stimulant, la compréhension de ce qui consolide au coeur de nos sociétés la mise en échec du "vivre ensemble".
REVUE QUART MONDE
" Pour faire taire ceux qui parlent trop, à son goût, d'une "américanisation", forcément inquiétante des banlieues françaises, le sociologue Loïc Wacquant a choisi de confronter dans son dernier ouvrage l'univers de la cité des 4000 de La Courneuve en Seine-Saint-Denis, à celui du ghetto sud de Chicago, aux États-Unis. Mêlant approche ethnographique et analyse sociologique pure et dure, le chercheur parvient à dresser un constat implacable: non, les quartiers périphériques, bien qu'ils soient des deux côtés de l'Atlantique tout autant stigmatisés dans les médias, ne recouvrent pas les mêmes réalités. Et, surtout, ne résultent pas des mêmes processus historiques, économiques et politiques. [...] Pour autant, dans les deux cas, la précarité et la marginalisation avancées qui règnent dans ces quartiers sont les signaux clairs d'un dysfonctionnement politique et social, dangereux pour le vivre ensemble. "
TERRITOIRES
2026-02-06 - PRESSE
Table des matières 

Introduction
Ghetto, banlieue, favela, etc. : des outils pour repenser la marginalité urbaine
Ghetto, banlieues, État
Pour une sociologie comparée de la marginalité urbaine
Prologue / Un vieux problème dans un monde nouveau
1. Le retour du refoulé : émeutes, ethnicité et dualisation dans trois sociétés avancées
La violence d'en bas : émeutes raciales ou révolte du ventre ?
La violence d'en haut : déprolétarisation, relégation et stigmatisation
L'aliénation politique et les dilemmes de la pénalisation
Conclusion : un défi pour la citoyenneté
I. Du ghetto communautaire à l'hyperghetto
2. Déclin et destin du ghetto noir à la fin de siècle
Des émeutes raciales aux explosions silencieuses
L'adieu au " ghetto éternel "
Trois précisions préliminaires
Du " ghetto communautaire " des années 1950 à l'" hyperghetto " des années 1990
Délabrement et danger au coeur de la métropole
Dépopulation, déprolétarisation et effondrement organisationnel
La " débrouille " et la survie quotidienne dans l'économie informelle
Les racines économiques et politiques de l'hyperghettoïsation
Désinvestissement, croissance polarisée et segmentation raciale du salariat déqualifié
Ségrégation raciale, politique du logement et concentration de la misère des Noirs
Le retrait abrupt d'un État-providence croupion
La marginalité politique et le " rétrécissement planifié " du ghetto
Conclusion : reconfiguration de la domination
3. Le prix de l'exclusion raciale et sociale à " Bronzeville "
Désindustrialisation et hyperghettoïsation
Le prix de la vie dans l'hyperghetto
La structure des classes au cœur et au pourtour du ghetto
Classe, sexe et trajectoires d'assistance au cœur et en lisière de Bronzeville
Différences de capital économique et financier
Capital social et concentration de la misère
Conclusion : structuration sociale de la marginalité
4. West Side Story :un quartier de haute insécurité dans le ghetto de Chicago
Misère d' État et capitalisme de rue
La macabre loterie des homicides
" Six pieds sous terre ou en taule "
II. Ceinture noire, ceinture rouge
5. Banlieues ouvrières françaises et ghetto noir américain : de l'amalgame à la comparaison
La panique morale des " cités-ghettos "
Les " banlieues " ne sont pas des ghettos à l'américaine
Des similarités apparentes dans l'évolution morphologique et le vécu des populations...
... qui masquent de profondes différences d'échelle, de structures et de fonction
Conclusion : le " ghetto français ", un contresens sociologique
6. Stigmate et division : du cœur de Chicago aux marges de Paris
L'" américanisation " de la pauvreté dans les villes européennes ?
La stigmatisation territoirale : son expérience et ses effet
" On dirait qu'il y a la peste ici "
" Les gens te méprisent comme tout "
De la stigmatisation spatiale à la " désorganisation " sociale
Vision et divisions sociales dans le ghetto et la banlieue ouvrière
Apartheid américain et clivage de la conscience raciale
Les jeunes des cités contre le reste du monde
Mélange des catégories, trajectoires collectives et tensions " ethniques "
7. Des lieux dangereux : la violence, l'isolement et l'État
Comparer les " tranchées urbaines "
Délinquance, violence de rue et contraction de l'espace public
Délinquance juvénile et sentiment d'insécurité dans les cités de la Ceinture rouge
La violence de rue et l'extinction de l'espace public sur le South Side de Chicago
Isolement institutionnel contre désertification organisationnelle
Densité organisationnelle et isolement institutionnel dans la cité des Quatre mille
Délinquance du secteur public et désertification organisationnelle du ghetto
Conclusion : réaffirmer les obligations de l'État
III. La marginalité urbaine à l'horizon du XXIe siècle
8. L'avènement de la marginalité avancée : caractéristiques et implications
" Underclass " et " banlieue " : figures de la marginalité avancée
Six propriétés distinctives du nouveau régime de marginalité
Implications pour la sociologie urbaine
Vers une révolution des politiques publiques
9. Les logiques de la polarisation urbaine par le bas
Les symptômes de la marginatlité avancée dans la ville
Quatre logiques structurelles nourrissent la nouvelle pauvreté
Dynamique macrosociétale : dualisation socioprofessionnelle et résurgence des inégalités
Dynamique économique : la fragmentation du salariat
Dynamique politique, ou la reconfiguration de l'État social
Dynamique spatiale : concentration et stigmatisation
Le spectre de la convergence transatlantique exorcisé
Face à la marginalité avancée : le tournant vers l' État pénal
Postface à l'édition française
Bibliographie.