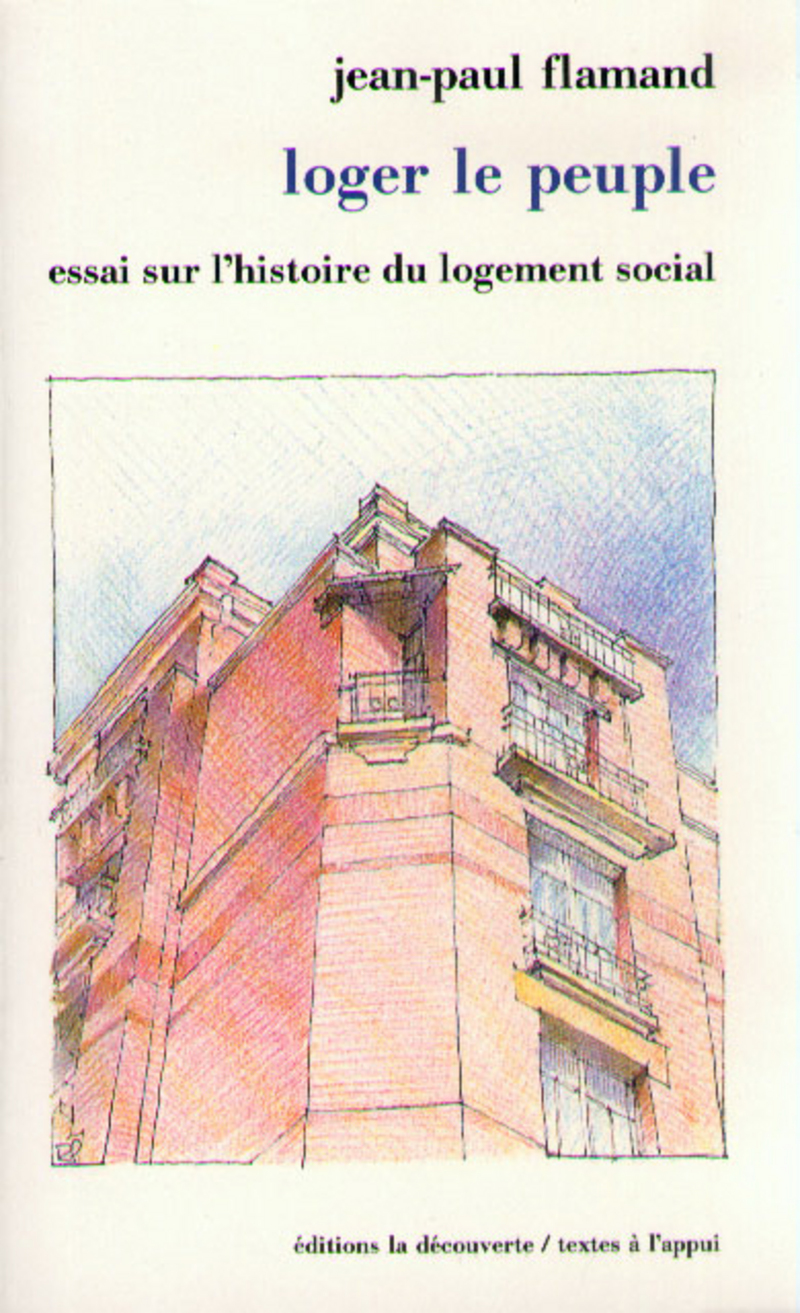Loger le peuple
Essai sur l'histoire du logement social
Jean-Paul Flamand
Ce n'est que tardivement que fut reconnue la nécessité de loger le peuple, alors même que l'industrialisation de la France, au cours du XIXe siècle, s'est accompagnée d'une urbanisation rapide, laquelle générait une crise permanente du logement. Ce fut d'abord la préoccupation de quelques philanthropes marqués par l'hygiénisme, puis de rares patrons, avant que l'État ne se trouve en devoir de faire face à ses responsabilités. L'auteur retrace l'histoire du logement social, depuis les cités ouvrières sises à proximité des mines et des usines aux villes nouvelles, en passant par les Habitations à Bon Marché. L'œuvre de Henri Sellier, Louis Loucheur ou de Raoul Dautry, ainsi que les propositions urbanistiques et architecturales de Tony Garnier ou de Le Corbusier sont ici replacées dans leur contexte politique et économique. Mêlant l'essai à l'érudition historique, cet ouvrage montre comment la recherche d'un consensus républicain et la poursuite de la modernité ont agi pour susciter des décisions et ouvrir des chantiers. En inscrivant son analyse au cœur des mouvances démographiques, économiques, sociales et idéologiques qui ont fait la France actuelle, l'auteur s'attache à marquer la spécificité institutionnelle, mais aussi architecturale et urbanistique, de ces politiques. Elles portent l'empreinte des pesanteurs de la société française, de ses blocages et de ses avancées.

Nb de pages : 369
Dimensions : * cm
 Jean-Paul Flamand
Jean-Paul Flamand

Jean-Paul Flamand est professeur à l'École d'architecture de Paris La Villette.
Table des matières 

Préface
Introduction
I. 1830-1894 : le péril en la ville
1. Des villes en expansion dans un pays rural
2. Une évolution économique contrastée
Du " domestic system "...
... A l'ouvriérisation de l'industrie
3. Patronat/classe ouvrière : les acteurs de l'histoire
Libre entreprise et " patronalisme " - " Jacobins " et " socialistes " ?
Vers la République sociale ?
4. Pour la concorde républicaine
L'invention de l'" ingiénérie sociale "
Les palais scolaires
5. Traiter la société, traiter la ville
" Vivre dans la rue "
De l'haussmanisation de la ville
6. Les logements du peuple
" La dure loi de la nécessité "
De la philanthropie bien entendue
Des courées et corons au Familistère de Guise
Une approche nouvelle : la " Société des habitations à bon marché "
La loi " relative aux habitations à bon marché "
II. 1894-1914 : la naissance d'un modèle
1. Un grand débat : " néo-malthusiens " contre " repopulateurs "
2. Progrès lents en économie
3. " Classe " contre " nation " : les avancées de la République
Premières approches du partenariat social dans l'entreprise
Socialisme démocratique contre syndicalisme révolutionnaire
La République triomphante
4. Les bases législatives et sociales d'une politique du logement
Une conjoncture toujours aussi difficile
La loi relance l'initiative privée
L'initiative privée, puis publique, relaie la loi
5. Une idée neuve : l'urbanisme
Les ambiguïtés du post-haussmannisme
" La cité industrielle " : utopie et anticipation
Des expériences à l'étranger, et de leur écho en France
6. Un logement modèle, un modèle de logement
Une réflexion binaire pour un même objet
L'urbanité pour tous
Essai d'évaluation
III. 1919-1953 : la modernité conquérante
1. Les désastres de la guerre et le recours à l'immigration
2. Économie : des ruptures définitives
3. Déchirures et réconciliations : les difficiles progrès de la modernisation du paysage social français
Économie de guerre et rationalisation
Crise et " planisme "
Reconstruction et planification
La " classe ouvrière " : intégration n'est pas fusion
4. Reconstructions : restauration et modernisation
1919 et après : la première reconstruction
Le " municipalisme " à l'œuvre
Planification et intervention de l'État
La " Révolution nationale "
La reconstruction nationale
1953 : la rupture
5. Rationalité et urbanisme à la française : nationalisme et internationalisme
Des idées en commun, sinon une idéologie commune
Les " faubourgs-jardins ", ou l'urbanisme selon Henri Sellier
La " ceinture des maréchaux ", ou l'urbanisme selon l'OPHBM de Paris
La " Cité radieuse ", ou l'urbanisme selon Le Corbusier
Dernières " cités-jardins " ou premiers grands ensembles : l'urbanisme selon la reconstruction nationale
6. De la " maison " au " logis nouveau "
" L'architecture domestique française "
Le " logis nouveau " : une autre solution ?
7. Transitions
IV. 1954-1977 : prolifération et décadence d'un modèle. Le logement-équipement
1. Le " baby boom " : un moment d'exception dans l'histoire démographique
2. Un pays en développement
L'agriculture : un puissant secteur d'entraînement
Industrialiser
Aménager
3. Mobilités, solidarités, inégalités
La généralisation du salariat et l'émergence des " couches moyennes "
Une société plus solidaire
Les inégalités profondes qui perdurent
4. " Il faut adapter la ville à l'automobile " (G. Pompidou)
L'urbanisme contre l'urbain
L'administratif saisit l'urbain
" Nous refusons d'être HLMisés, sarcellisés, endoctrinés... " (Foyer de l'Odéon, Mai 1968)
" Le droit à la ville "
5. De l'architecture du chemin de grue au " post-modernisme "
" Logement, notre honte... "
Un logement de masse pour un travailleur-masse
Des " Villagexpo " au post-modernisme
La crise et après
De l'aide à la pierre à l'aide à la personne
6. Une histoire s'achève
V. 1977-1988 : vers une France propriétaire ?
1. Une société duale
2. La famille n'est plus ce qu'elle était
3. La politique du logement est en panne : blocages et perversions du système
4. Quillot, Quilès, Méhaignerie et les autres
Conclusion
Références bibliographiques
Index
Légendes des plans (hors textes).