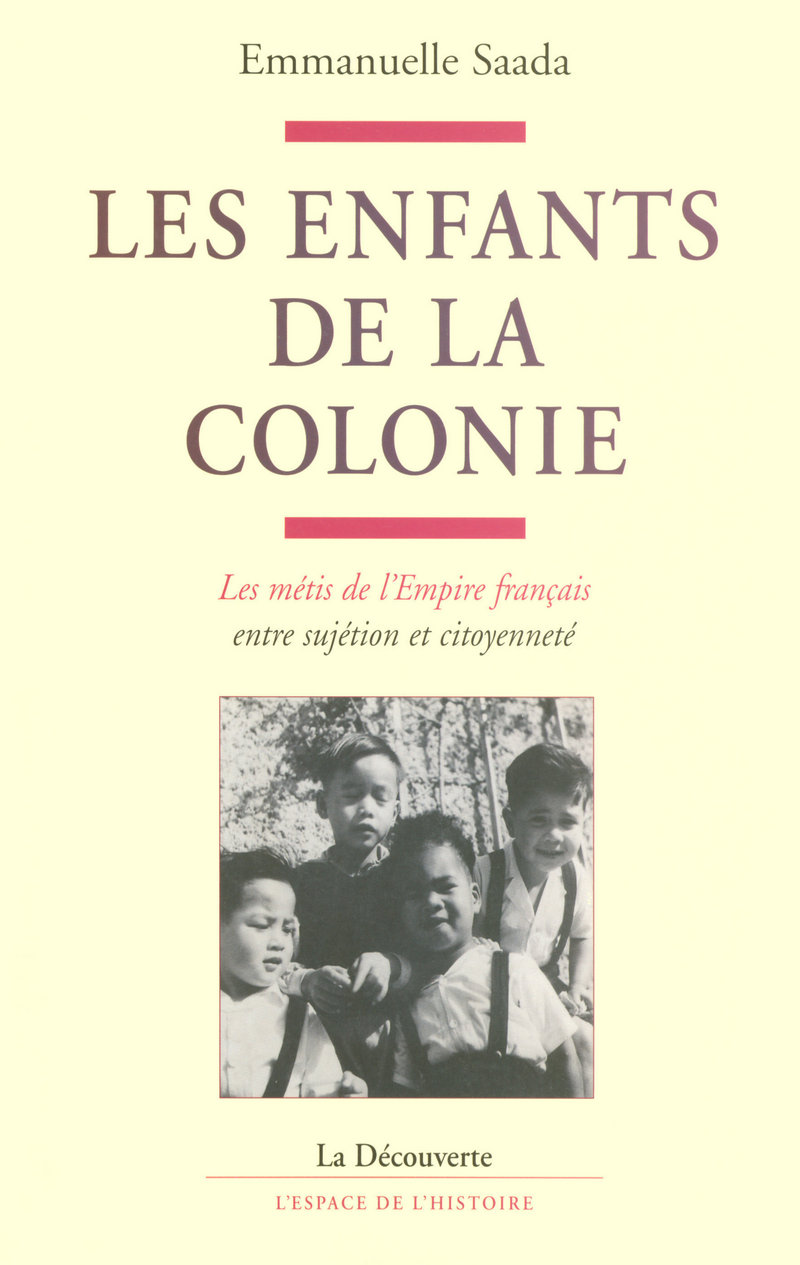Les enfants de la colonie
Les métis de l'Empire français entre sujétion et citoyenneté
Emmanuelle Saada
Pendant la colonisation française, des dizaines de milliers d'enfants sont nés d'" Européens " et d'" indigènes ". Souvent illégitimes, non reconnus puis abandonnés par leur père, ces métis furent perçus comme un danger parce que leur existence brouillait la frontière entre " citoyens " et " sujets " au fondement de l'ordre colonial. Leur situation a pourtant varié : invisibles en Algérie, ils ont été au centre des préoccupations en Indochine. La " question métisse " a également été posée à Madagascar, en Afrique et en Nouvelle-Calédonie.
Retraçant l'histoire oubliée de ces enfants de la colonie, cet ouvrage révèle une face cachée, mais fondamentale, de l'histoire de l'appartenance nationale en France : il montre comment les tentatives d'assimilation des métis ont culminé, à la fin des années 1920, avec des décrets reconnaissant la citoyenneté à ceux qui pouvaient prouver leur " race française ". Aux colonies, la nation se découvrait sous les traits d'une race.
Cette législation bouleversa le destin de milliers d'individus, passant soudainement de la sujétion à la citoyenneté : ainsi, en Indochine, en 1954, 4 500 enfants furent séparés de leur mère et " rapatriés " en tant que Français. Surtout, elle introduisait la race en droit français, comme critère d'appartenance à la nation. Cela oblige à revoir le " modèle républicain " de la citoyenneté, fondé sur la figure d'un individu abstrait, adhérant volontaire à un projet politique commun et à souligner les liens entre filiation, nationalité et race.

Nb de pages : 334
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782707178732
 Emmanuelle Saada
Emmanuelle Saada


Emmanuelle Saada est historienne et sociologue. Elle enseigne la sociologie historique de la colonisation à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Extraits presse 

" De nombreux métis sont nés sous la colonisation française, le plus souvent de pères "européens" et de mères "indigènes". La législation coloniale s'est saisie assez tôt d'une question brouillant la frontière raciale qui fondait l'ordre colonial et qui, surtout, introduisit la race dans le droit français. L'historienne Emmanuelle Saada a retracé l'histoire de ces "enfants de la colonie" et des mesures prises à leur sujet, révélatrice d'une évolution de l'appartenance nationale en France qui oblige à revoir le fameux "modèle républicain" de la citoyenneté. Un ouvrage fondamental. "
POLITIS
" L'auteur conjugue lisibilité et érudition. Elle allie aussi les approches sociologique, historique et juridique. Les fondements de cet impressionnant travail de recherche sont solides, Emmanuelle Saada puisant dans de nombreuses archives vietnamiennes et françaises. Elle examine les liens entre juristes, scientifiques et administrateurs coloniaux. En outre, elle prend le droit au sérieux, ce qui lui permet d'appréhender et d'analyser le jeu crucial entre droit, politique et pratique aux colonies. Voilà un heureux constat, surtout dans un contexte actuel de polarisation constante et parfois caricaturale (dans les deux sens) des enjeux et des débats entourant la question coloniale. Heureux constat aussi lorsqu'on tient compte du virage récent qui s'est opéré vers une histoire des représentations coloniales détachée de celles des pratiques et du droit. Rien de tel dans cette étude nuancée et admirablement conduite. A la lecture de cet ouvrage, on sera enfin amené à réexaminer l'idée d'un modèle républicain singulier et monolithique, tout comme l'idée que Vichy ait pu être le seul régime en France à avoir tenu compte de la notion de "race". Cette étude aidera également à repenser les catégories souvent héritées de l'époque coloniale, et à manier avec précaution l'idéal d'une "République métissé" "
LE MONDE
" Très vite Emmanuelle Saada restitue la question du métissage dans un bain d'idée. "
LE QUOTIDIEN DU MEDECIN
" Cet ouvrage, parfois ardu, est donc d'abord une remarquable contribution à une anthropologie historique du droit qui est sans aucun doute aujourd'hui l'un des chantiers de recherche les plus stimulants. Sous cet angle, Saada questionne l'histoire de la filiation dans nos sociétés, et interroge un moment d'étatisation de ces relations. "
LES INROCKUPTIBLES
" On suivra volontiers Emmanuelle Saada dans sa démonstration, d'autant qu'elle s'appuie sur d'impressionnants dépouillements d'archives. "
LIBÉRATION
" À travers la question de ces enfants nés de relations illégitimes, il s'agit bien, au fond, de la préservation ou au contraire de la perturbation de l'ordre colonial. "
L'HUMANITÉ
" À rebours d'une production éditoriale devenue assez répétitive, le livre s'efforce de dépasser la seule mise en évidence (il est vrai longtemps masquée) de la présence de la race dans le gouvernement des populations, pour en comprendre la genèse et les usages "effectifs" dans le droit et les pratiques d'administration coloniale. La démonstration porte donc sur la reconstruction des processus plutôt que sur la simple énumération des images ou des imaginaires; à partir des sources de la pratique (corpus législatif, jurisprudence, archives de fonctionnement ministériel et d'application administrative locale, papiers des associations de protection des métis, sources orales), l'auteure montre comment a été fabriquée "une question métisse", comment celle-ci a été constituée en problème nodal puis a été prise en charge et traitée par l'administration, le droit, la société coloniale, et à certains égards également par les sociétés colonisées. Dans ce processus, la notion de race a sa fonction, ses usages et ses effets, qui sont loind'être unilatéraux. "
LA REVUE INTERNATIONALE DES LIVRES ET DES IDÉES
" Par son objet et sa méthode, cette thèse de sociologie illustre brillamment les apports de la démarche socio-historienne dans le champ des colonial studies. "
LES ANNALES
" Le livre d'Emmanuelle Saada, issu d'une thèse soutenue en 2001 à l'EHESS, est un des ouvrages les plus remarquables parus récemment. Exceptionnellement riche et portant sur des problèmes fondamentaux, il devrait être lu au-delà du cercle des spécialistes de l'histoire coloniale. "
HISTOIRE, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
" Madame Saada, sociologue et historienne, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, à Paris, publie son ouvrage issu des travaux pour sa thèse sur un sujet mal connu et peu souvent abordé: la situation des métis dans des territoires de ce qui fut l'Empire colonial de la France. Son livre est donc une source nouvelle de renseignements sur ce problème. Il est très documenté et précis, citant les textes régissant la question et faisant état des documents importants trouvés tant dans les archives d'outre-mer que dans celles de l'Indochine, de Madagascar et d'Afrique noire. [...] L'aperçu bien complet de cet ouvrage sur le problème des métis, traité de façon détaillée par l'auteure, ne peut qu'inciter à prendre connaissance du travail effectué par madame Saada qui nous fournit une base détaillée, bien documentée et juridiquement très complète de ce problème jusqu'ici négligé par les chercheurs. "
MONDES ET CULTURES
2026-02-26 - PRESSE
Table des matières 

Préface, par Gérard Noiriel
Introduction
I. Le métissage : une question sociale coloniale
1. Une question impériale
Nouvel empire, nouvelle question
Hybrides et bâtards
Géographie de la question métisse
Un problème impérial
Les chiffres du métissage
2. Menace pour l'ordre colonial
Légionnaires, filles de peu et parias
Déracinés et déclassés
Le spectacle du désordre
Dignité et prestige en situation coloniale
3. " Reclasser " les métis
Produire des métis en leur portant secours ?
De la nécessité d'intervenir
Vers une prise en charge par l'État colonial
Notables vs. prolétaires de la colonisation
Dépister, signaler et secourir
Passer les frontières
Vers une demande de droit
II. La question métisse saisie par le droit
4. Nationalité et citoyenneté en situation coloniale
Les enjeux d'une condition juridique
Les juristes et l'indigène
La citoyenneté française en pratique
Les métis entre sujétion et citoyenneté
5. La controverse des " reconnaissances frauduleuses "
Les " reconnaissances frauduleuses ", " fraudes " à la citoyenneté
Destin d'une controverse juridique
La production d'un droit impérial
Paternité, citoyenneté et ordre politique
6. La recherche de paternité aux colonies
La recherche de paternité en métropole : un texte de compromis
Un débat colonial
Paternité et citoyenneté : nature et volonté
Paternité et race
7. Citoyens en vertu de la race
Le droit hors de lui
La " question métisse " saisie par le droit
Le retournement de la jurisprudence
La fabrique du droit colonial
Vérité sociologique/vérité biologique, " droit reflet "/" droit instituant "
Mise en œuvre d'un droit racial
III. La force du droit
8. Le passage du droit : les effets de la citoyenneté sur la catégorie de " métis "
La racialisation des pratiques administratives
Renforcement de la prise en charge des métis
Les métis, des cadres de la colonisation
Une question postcoloniale
9. Des identités saisies par le droit
Des Français des colonies
Vers un multiculturalisme impérial ?
Catégorie juridique et sentiment d'identité
10. Le statut des métis, miroir de la nationalité et de la citoyenneté françaises ?
La race dans la loi
Métis coloniaux et métis juifs
La question métisse et les " modèles républicains " de la nationalité et de la citoyenneté
Conclusion
Sources
Bibliographie.