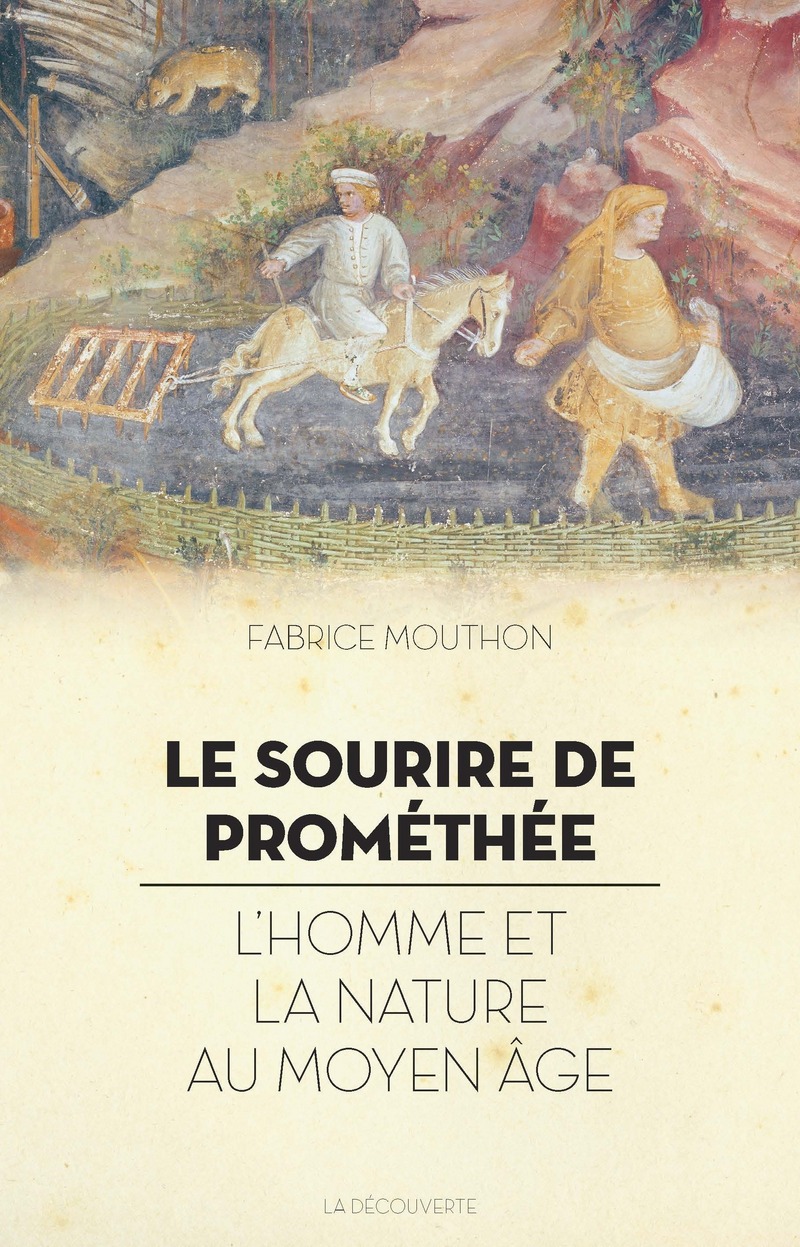Le sourire de Prométhée
L'homme et la nature au Moyen Âge
Fabrice Mouthon
Pour qui s'intéresse à la société médiévale, la question écologique peut sembler secondaire au regard du rapport à Dieu, des formes de domination ou de l'organisation politique. Les sciences paléo-environnementales, l'archéologie moderne et les textes de l'époque suggèrent pourtant que leurs rapports à la nature sont bien l'une des grandes questions que se posent les hommes du Moyen Âge.
Remettant en cause le cliché d'une période de stagnation, livrée aux calamités naturelles, l'auteur montre que ces rapports n'ont cessé d'évoluer. L'évêque mérovingien, le serf d'un domaine carolingien, l'hôte d'un village neuf du XIIe siècle, le théologien du XIIIe siècle, ou le maître de forge du XVe siècle ne partagent ni la même vision ni les mêmes attentes vis-à-vis de la nature. Après l'an mille cependant, la croissance démographique, l'amélioration des moyens techniques et la redécouverte de la science grecque ont peu à peu fait basculer l'Occident dans un nouveau paradigme. La maîtrise du monde sensible devient un but collectif légitime et réalisable. La nature est alors fortement mise à contribution. Ainsi, si l'ouvrage couvre le millénaire médiéval, le cœur de l'enquête reste le grand développement des XIe, XIIe et XIIIe siècles, moment crucial de l'" invention de la nature ", gardienne de la Création et de ses lois, et d'une prise de conscience écologique qui n'en a pas encore le nom.

Nb de pages : 316
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782707195920
 Fabrice Mouthon
Fabrice Mouthon

Extraits presse 

[L'ouvrage] est clairement écrit pour un public de non-spécialistes, dans un style agréable et avec peu de notes de bas de pages, mais avec une exigence de précision et de technicité qui le rend tout autant appréciable pour les connaisseurs. Ceux-ci apprécieront en particulier la maîtrise de l'historiographie, qui permet à l'auteur de contextualiser chaque référence en rappelant rapidement les débats qui entourent telle ou telle thèse.
2017-06-06 - Florian Besson - Lectures
Fabrice Mouthon dresse dans son livre Le Sourire de Prométhée un passionnant bilan écologique du Moyen Âge, d'autant plus pertinent que, grâce aux progrès récents de l'archéologie moderne et des sciences paléo-environnementales les " archives naturelles " sont de plus en plus riches. L'historien montre en particulier comment à partir du XIe siècle s'enclenche une impressionnante dialectique entre croissance de la population urbanisation et grands défrichements. La conséquence en est une trajectoire de croissance qui surexploite les milieux locaux et provoque pour la première fois une éclosion d'origine humaine supérieure à l'érosion naturelle " Faudrait-il dater de cette époque, et non du XIXe siècle le début de l'anthropocène ? "
2017-08-24 - Jean-Yves Grenier - Libération
Les hommes du Moyen Âge étaient ils trop nombreux en Europe ? Sont ils à l'origine de la crise écologique actuelle ? C'est – entre autres – à ces questions que l'auteur, maître de conférences à l'université de Savoie, se propose de répondre, en se concentrant non sur les discours théoriques mais sur les interactions concrètes entre les hommes et leurs milieux. Fabrice Mouthon en fait ressortir la complexité et l'évolution, loin de l'image traditionnelle d'une harmonie spontanée entre l'homme et les éléments.
2017-08-31 - L'Histoire
Contre l'idée d'une humanité demi-sauvage, vivant dans la crainte d'une nature inconnue et menaçante, se dessine, au moins entre le XIIe et le XIVe siècle, l'image d'une civilisation dynamique, inventive et en croissance sur bien des plans. De nombreuses inventions (l'usage du cheval de trait, la généralisation des moulins) ont des causes pratiques. L'auteur s'arrête surtout à l'agriculture, du champ (cultivé) à la forêt (sauvage). Il invite à ne pas surestimer les représentations idéologiques qui sont plutôt celles des élites. Mais l'intérêt pour les techniques ne peut pas totalement ignorer leur influence. La théologie médiévale conçoit une nature distincte de l'homme et exploitable par lui. L'auteur montre bien les menaces qui pèsent sur la nature dès le XIIIe siècle (réduction de la biodiversité, etc.). Cet ouvrage très bien documenté donne une profondeur de champ à nos débats actuels, en les replaçant dans la longue durée.
2017-09-04 - François Euvé - Etudes
Table des matières 

Introduction
I / De la place de l'homme dans la nature
1. Dieu ne transforme pas les arbres en vaches !
L'âge des mythes
Le temps des saints (Ve-Xe siècle)
Rendre Nature meilleure (XIe-XIIIe siècle)
Le temps des malheurs (XIVe-XVe siècle)
2. La fée Mélusine et le mont Inaccessible
La résistible christianisation du monde sauvage
Mirabilia, forces de la nature et génies du terroir
1492, le désenchantement du monde
3. D'Aristote à Dürer
Le retour du Stagirite
Scientia experimentalis
Tout le savoir du monde
Un nouveau regard
4. Sous la loi de Malthus ?
Déterminisme ou libre arbitre ?
La loi d'airain des sociétés anciennes
Une crise malthusienne... ou pas
Bactéries et virus, les plus vieux ennemis de l'homme
5. " Mais où sont les neiges d'antan ? "
Le climat a une histoire : sources écrites et archives naturelles
Chauds et froids médiévaux
Aux risques du temps
S'adapter et subir
Aléas et catastrophes
Résistance et résilience
II / Mettre les ressources au service de la culture
6. Se nourrir du soleil
Tout est affaire d'énergie
Une civilisation du blé
Jardin d'Éden et Terre promise
L'élevage malgré tout
7. Façonner la matière
Se chauffer, construire, fabriquer
Des entrailles de la Terre
8. La fabrique des droits sur la nature
Ager, silva, saltus
Mainmise sur la nature
L'exploitation paysanne : droits sur la terre ou sur la nature ?
Naissance des communs
Le gibier, ressource collective ?
III / Le défi de Prométhée
9. Anthropisation
Les " trois cents glorieuses "
Naissance des campagnes
L'eau : amie ou ennemie ?
Les prémisses d'une crise écologique ?
10. Prométhée et le moulin
Multiplier les pains, transformer l'eau en vin
Tuer le veau gras, multiplier les poissons
Maîtriser les éléments
11. Prise de conscience d'un monde fini ?
Pollutions humaines, animales et chimiques
Préserver les ressources halieutiques et forestières
Conclusion
Bibliographie.