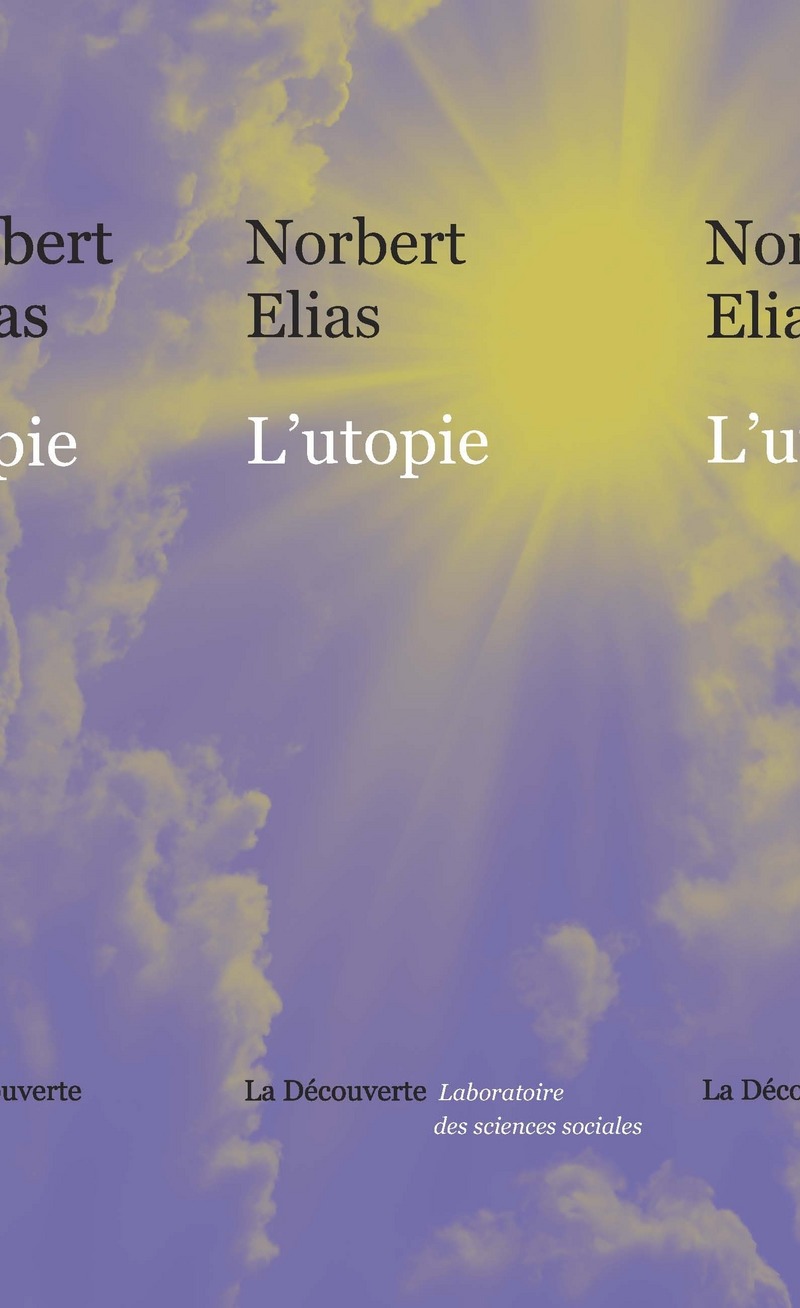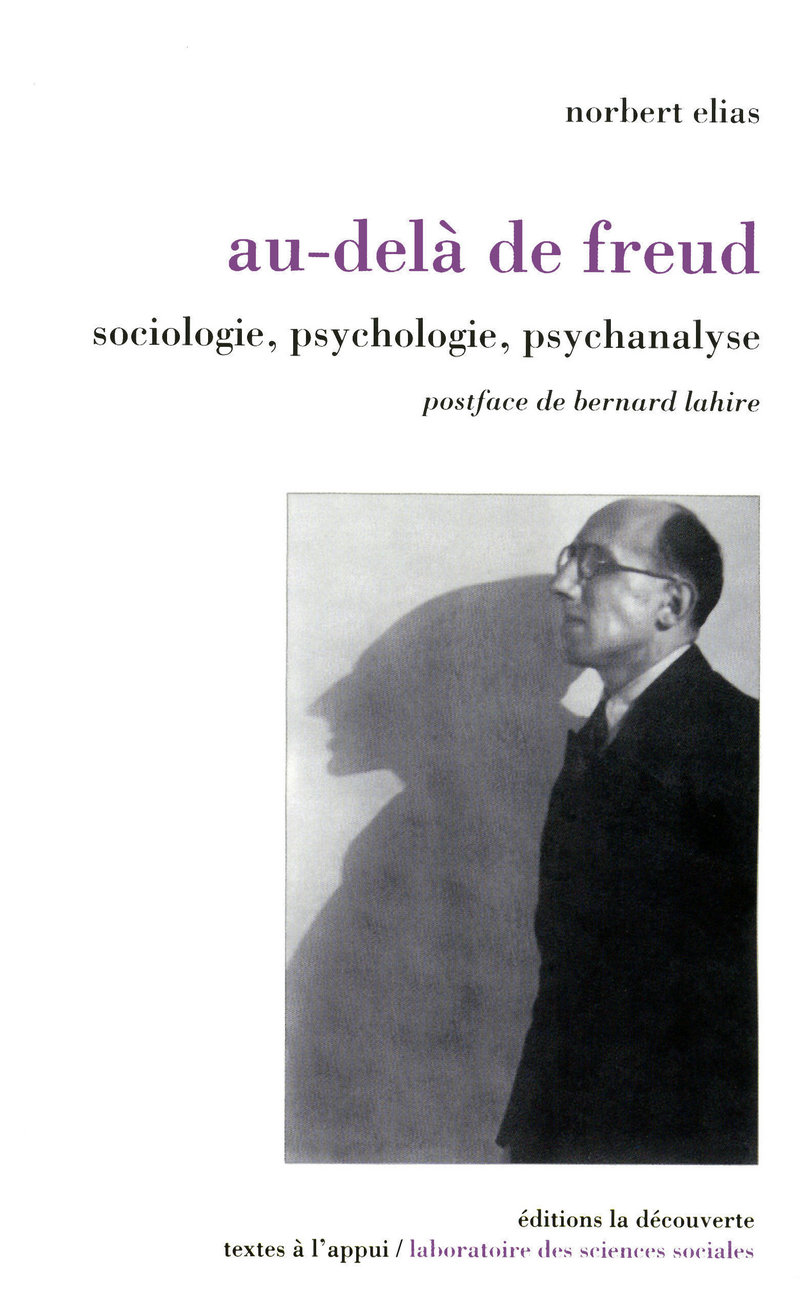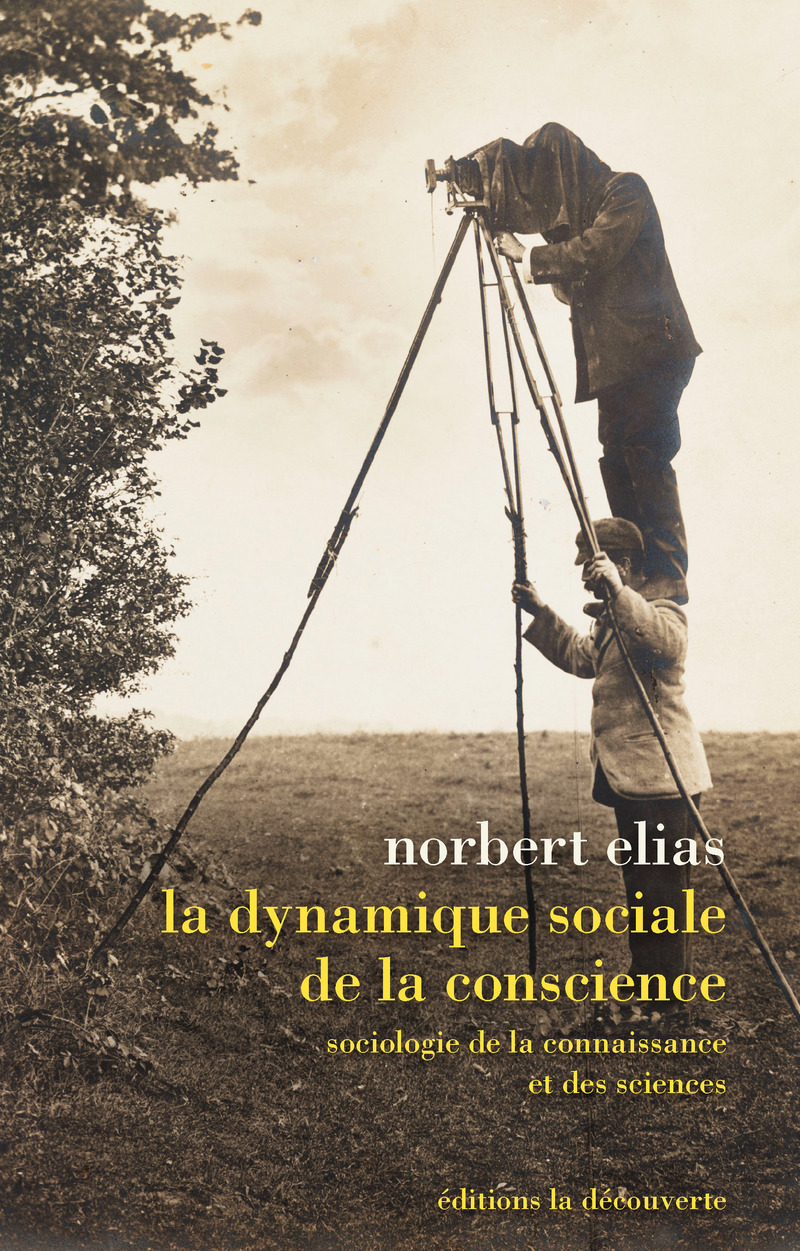L'utopie
Norbert Elias
Au début des années 1980, le sociologue Norbert Elias s'attelle à une analyse des utopies dans le cadre d'un programme de recherche sur le statut de la connaissance en sciences. Le présent ouvrage réunit pour la première fois ses différentes contributions sur cette question.
À partir d'une analyse originale de L'Utopie de Thomas More (1516) et des livres de H.G. Wells parus entre 1895 et 1901, Elias offre une définition renouvelée de l'utopie et montre comment celle-ci doit faire partie de l'analyse sociologique des savoirs et des représentations collectives. Une fois réinsérée dans ses contextes de production et de réception, l'utopie devient un lieu d'observation et un révélateur : à la croisée entre science et littérature, défiant les catégories de l'illusoire et du réalisable, elle constitue une vraie promesse d'analyse, que ce soit comme objet ou comme outil.
Dans ces textes, Elias réévalue le rôle de l'imagination, interroge notre rapport au " réel " et rejette l'inéluctabilité du devenir historique, en suggérant que le réalisable est aussi du côté de l'utopie et en proposant de nouvelles catégories d'action. À l'heure du " réalisme " imposé aux choix politiques, de la prépondérance de l'expertise scientifique, du rétrécissement des attentions sur le présent ou de la supposée crise des sciences humaines, cette grille d'analyse reste aujourd'hui d'une pleine actualité.

Traduitde l'Allemand par : Hélène Leclerc Delphine Moraldo Marianne Woollven
Nb de pages : 151
Dimensions : * cm
 Norbert Elias
Norbert Elias

Extraits presse 

2014-05-08 - Robert Maggiori - Libération
Inédits en français, ces textes furent écrits par Norbert Elias au cours des années 1980. À l'heure où les idéologies et les utopies finissaient d'avoir très mauvaise presse, le sociologue allemand proposait une analyse de l'utopie en l'appréhendant – réinsérée dans son contexte de production – à la fois comme outil et comme objet. À partir d'une relecture originale de l' Utopie de Thomas More (1516) et des livres d'H.G.Wells (fin du XIXe siècle), réévaluant l'imagination, Elias interroge finalement notre rapport au " réel " et suggère de nouvelles catégories d'action. Un bol d'air frais en ces temps de réalisme " obligatoire " !
2014-05-15 - Politis
Entre 1980 et 1987, le sociologue Norbert Elias a publié trois articles ayant pour même finalité de montrer comment l'utopie peut et doit faire partie de l'analyse sociologique des représentations collectives. Une utopie, explique l'auteur du Processus de civilisation, n'est pas seulement un texte qui met en scène une société imaginaire. Elle exprime la manière dont son auteur souhaite transformer la vie d'une société, ou bien dénonce ce qu'il redoute comme avenir possible pour cette société. Parce que les auteurs d'utopies parlent toujours depuis une situation sociale vécue, la tâche première du sociologue est d'adopter ce que N. Elias nomme une démarche " sociogénétique ". Il faut repérer les problèmes sociaux auxquels l'utopie prétend apporter des solutions, expliquer pourquoi l'auteur les a retenues et comprendre à quel public s'adresse le texte. Assorti d'un long préliminaire méthodologique, le premier texte est le plus consistant des trois. Là, N. Elias entre dans le détail de l' Utopie (1516) de Thomas More. Le sociologue observe que cet ouvrage pionnier a directement à voir avec le processus de formation des États européens. Au moment où T. More écrit, les princes sont en train de perdre les attributs des souverains féodaux traditionnels. Ils mènent de moins en moins souvent la guerre à l'aide d'armées de vassaux équipés d'armes blanches, mais de plus en plus en recrutant des mercenaires munis d'armes à feu. La façon de financer les conflits change également. Sur ce fond de mutation sociale, deux questions se posent avec insistance : comment un État doit-il être construit ? Quel est le meilleur État possible ? Le livre de T. More est une réponse à ces questions. L'utopie n'est donc pas un rêve abstrait : elle se nourrit d'une réalité présente pour mieux la transformer. Cela est d'autant plus vrai que, les siècles passant, les hommes se sont dotés de moyens pour rendre possible ce qui, hier encore, pouvait sembler impossible, comme établir des colonies sur la Lune. On comprend donc aussi que des utopies négatives aient pu voir le jour, traduisant l'angoisse et la peur suscitées par le développement de technologies inquiétantes. Plus courts, les autres textes reviennent pour partie sur les thèmes travaillés dans le premier. Tout aussi stimulants, ils convainquent également de l'intérêt de travailler encore aujourd'hui à une sociologie des utopies.
2014-07-01 - Clément Lefranc - Sciences Humaines
Table des matières 

Introduction : Les utopies d'Elias. La longue durée et le possible, par Quentin Deluermoz
U-topie : indéterminations et décalages
Positions de l'utopie. De Thomas More à la Troisième Guerre mondiale
La sociologie processuelle à l'épreuve de la prédictibilité et des futurs possibles
" S'ils étaient capables d'envisager une analyse configurationnelle... ". L'utopie sociologique d'Elias
I / La critique de l'État chez Thomas More
1. Pour une définition du concept d'utopie
2. La critique morienne de l'État dans le contexte du processus de formation de l'État
3. La position sociale de More à l'époque de
L'Utopie – Remarques au sujet du développement de la conscience sociale
4.
L'Utopie dans la vie de More et à son époque
5. L'idée morienne de l'abolition de la propriété privée : éléments d'explication
6. Les retouches du portrait de More
7. Le potentiel de réalisation des utopies
II / À quoi servent les utopies scientifiques et littéraires pour l'avenir ?
III / Thomas More et l'utopie.