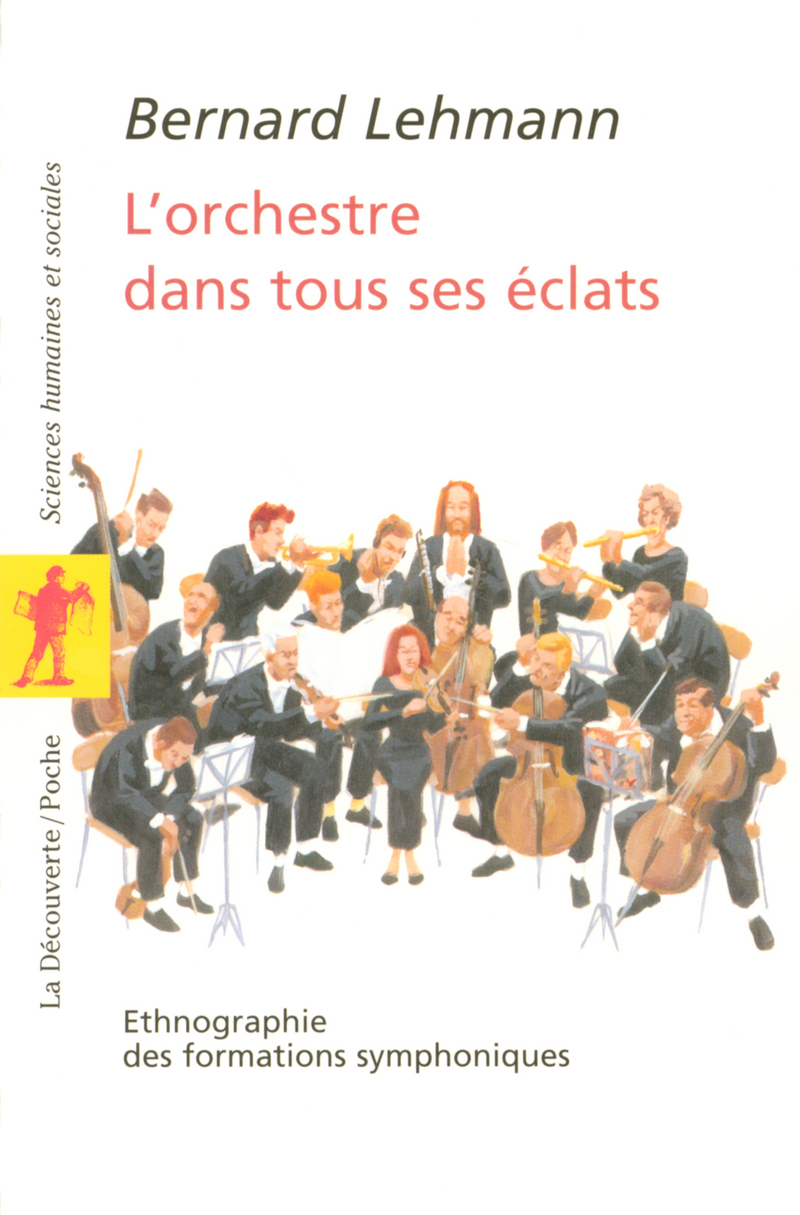L'orchestre dans tous ses éclats
Ethnographie des formations symphoniques
Bernard Lehmann
Au terme d'un travail d'enquête mené durant près de cinq années au sein des principaux orchestres parisiens, Bernard Lehmann a entrepris, dans ce livre, de mettre au jour les hiérarchies et lignes de fracture invisibles, multiples, tant musicales que sociales qui traversent les formations symphoniques. Il met en évidence le lien entre le prestige symbolique d'une famille instrumentale et le recrutement de ses praticiens : aux cordes fréquemment originaires de milieux dominants, s'opposent les cuivres issus des milieux plus défavorisés. Mais, paradoxalement, les orchestres, dans leur fonctionnement interne, produisent aussi des classifications qui contredisent les hiérarchies sociales : les moins favorisés socialement se trouvent détenir les postes de soliste les plus enviés et les salaires les plus élevés, quand les plus dotés sont souvent renvoyés à l'anonymat des positions de tuttistes. À travers de nombreux portraits de musiciens, l'auteur montre comment ces hommes et femmes vivent au quotidien leur métier de musicien d'orchestre, relisent leur passé, parlent d'eux, acceptent ou non de jouer le jeu du chef lors des répétitions. En somme, à rebours de ce que laisse entendre le moment du concert et de l'interprétation, Bernard Lehmann affirme sans détour : le musical, c'est aussi du social.

Nb de pages : 261
Dimensions : * cm
 Bernard Lehmann
Bernard Lehmann

Bernard Lehmann est sociologue, maître de conférences à l'université de Nantes et chercheur au Centre nantais de sociologie.
Extraits presse 

" Instructif et plaisant ".
LA CROIX
" Le sociologue Bernard Lehmann a passé plusieurs années à étudier de près le fonctionnement des principaux orchestres parisiens. Son enquête est passionnante. Elle permet de comprendre qui sont ces femmes et ces hommes qui ont voué leur existence à l'interprétation des grandes oeuvres du répertoire savant. Tout, ou presque, nous est dit : leur origine sociale, leur formation, leurs solidarités comme leurs conflits, etc. Joignant l'utile à l'agréable, ce travail fort sérieux se lit avec plaisir. "
PARIS
" Ce livre constitue un modèle d'ouvrage sociologique, comme on aimerait en lire plus souvent. Il est nourri des méthodes d'auteurs reconnus, mais sans aucun étalage de références. On y apprend une foule de choses sur le fonctionnement d'un orchestre et sur les musiciens d'orchestre. La lecture en est agréable, alternant des observations et des fragments d'entretiens. Les conclusions sont claires et argumentées. "
IDÉES
2026-02-06 - PRESSE
Table des matières 

Introduction
Question de méthode
Les formations étudiées
1. Structure et morphologie de l'orchestre
Les vents en quête de légitimité
Comment disposer les musiciens ?
Morphologie de l'orchestre
2. Les hiérarchies sociales de l'orchestre
Les propriétés sociales des musiciens
Les premiers pas et le choix de l'instrument
La rationalité professionnelle des héritiers
La musique en famille
Les aléas de l'offre instrumentale en milieux populaires
3. Hiérarchies statutaires de l'orchestre et moments clés de la carrière
Les héritiers sur les rails
Les déclassés
Les instrumentistes promus
4. Trajectoires d'exception de deux autodidactes
Jérôme : entre le jazz et le classique
Jean ou la vie comme un conte oriental
5. La terre promise : les usages sociaux des activités hors de l'orchestre
Le Conservatoire de Paris comme lieu de constitution de relations professionnelles
Les déclassés et le quatuor
Le sens pratique des héritiers
Les promus : entre le jazz et la java
6. Points de vue sur l'orchestre
L'orchestre vu des cordes
L'orchestre vu des vents
7. La répétition : construction sociale de l'interprétation
L'organisation des répétitions
Du pouvoir absolu des chefs à la réalité des répétitions
Les musiciens entre eux
8. L'orchestre en représentation : l'unité recomposée ?
L'orchestre poreux
La fosse de l'Opéra comme lieu de profanation des rituels
Les programmes annuels de concerts
L'Orchestre télévisé
Conclusion
Bibliographie.