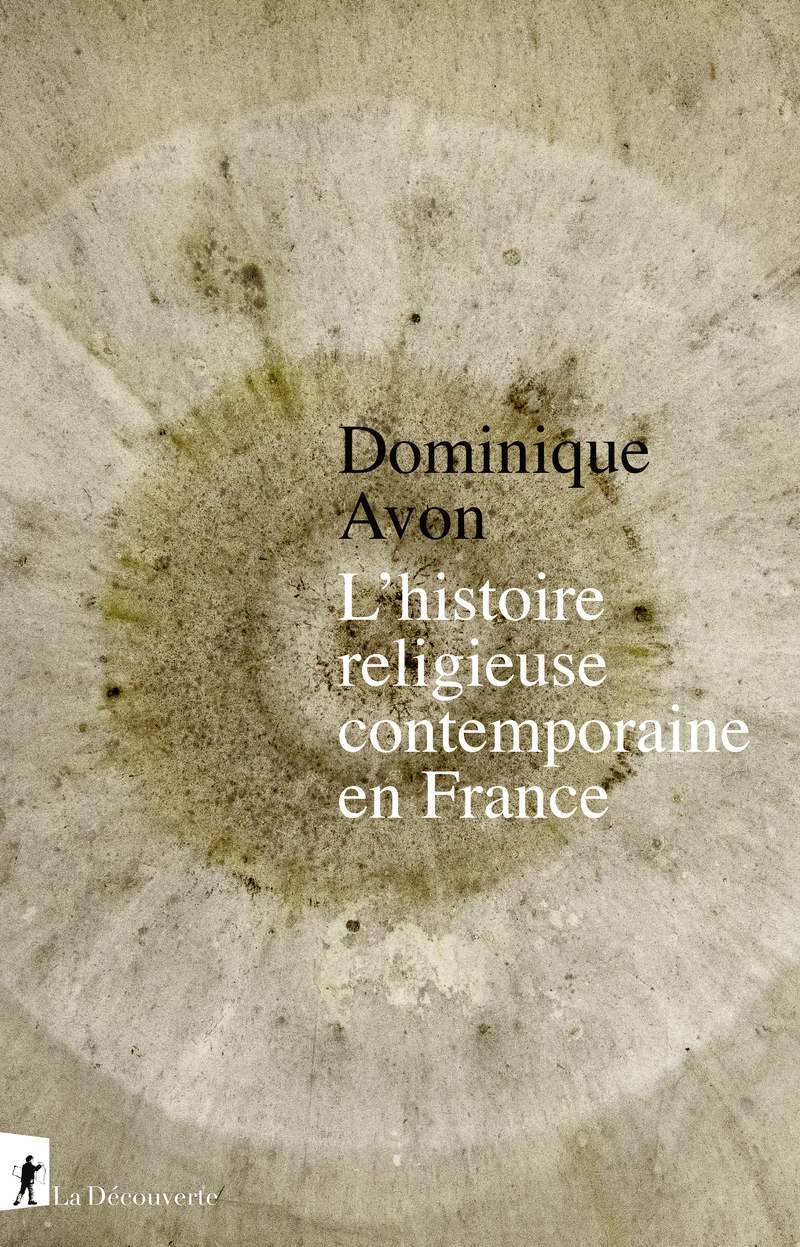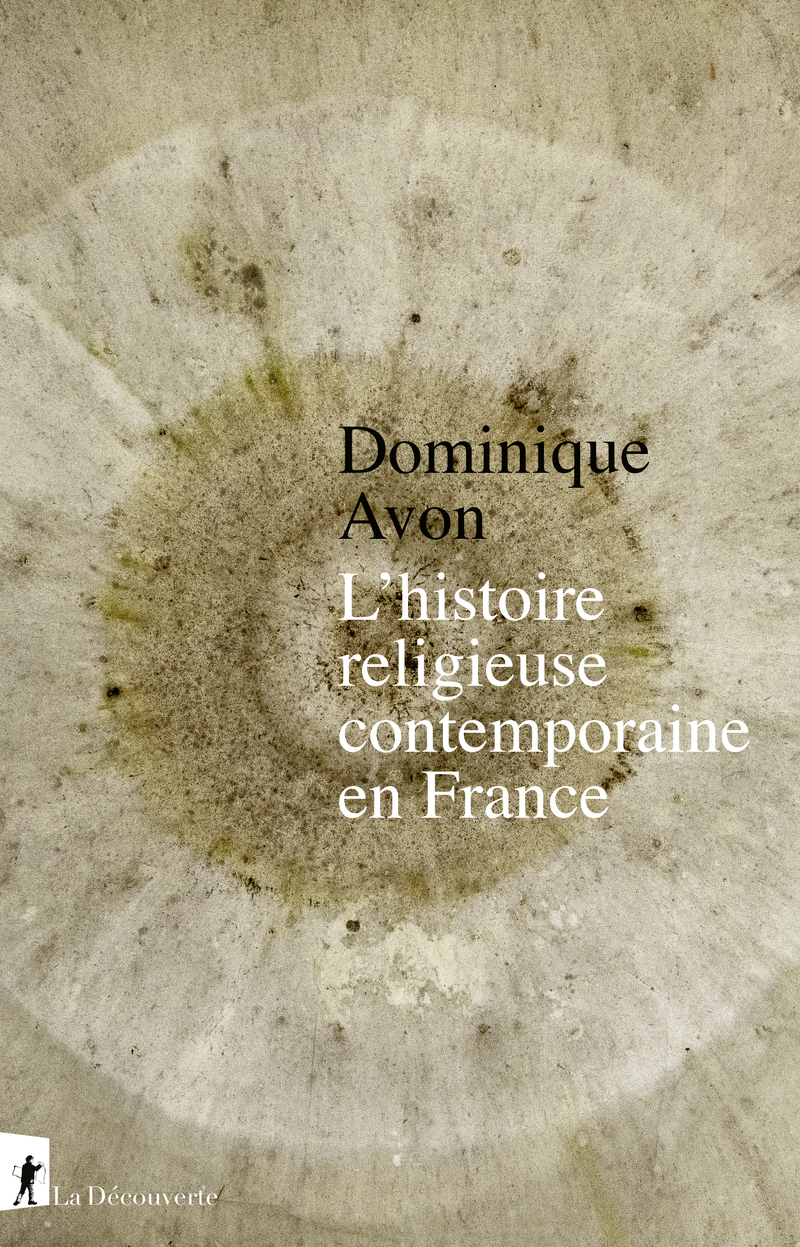L'histoire religieuse contemporaine en France
Dominique Avon
Le paysage confessionnel et convictionnel de la France du début du XXIe siècle est marqué par une grande diversité : catholiques, agnostiques, athées, sunnites, bouddhistes, protestants, juifs, orthodoxes, hindous, autres groupes minoritaires issus du christianisme ou de l'islam... Cette réalité n'a fait son entrée que récemment dans le champ de l'histoire religieuse contemporaine. Celle-ci, longtemps marquée par une attention prioritaire au catholicisme, avec des sillons spécifiques tracés pour le judaïsme et le protestantisme, a connu un renouveau. C'est ce dont vient témoigner cet ouvrage, qui constitue la première grande synthèse portant sur la manière dont l'historiographie française a articulé religions, sécularisation et modernité.
À travers l'histoire d'une corporation ouverte à la fois à d'autres disciplines (sociologie, philosophie, théologie, anthropologie, droit) et à d'autres spécialités (histoire politique ou sociale et, plus récemment, histoire culturelle, histoire des femmes, histoire de la jeunesse ou histoire de la santé) se dessine un portrait de groupe au sein duquel des débats intéressant l'ensemble de la discipline historique ont été tenus. Si ses membres ne répondent pas à des profils homogènes, l'empreinte commune de leurs travaux est cependant significative dans le paysage de la recherche et son rayonnement déborde les frontières nationales.

 Dominique Avon
Dominique Avon

Table des matières 

Remerciements
Introduction
Partie I - Le prix de la structuration d'une histoire autonome
1. L'historien et l'objet religieux contemporain
Positionnement générationnel : pionniers, bâtisseurs, ordonnateurs et héritiers
Positionnement méthodologique : du dedans au dehors
Positionnement institutionnel : entre coopération et distance à l'égard des autorités religieuses
2. Les rapports disciplinaires : ignorance, coopération, rivalité
Histoire, géographie et sociologie : arpenter et mesurer
Histoire, théologie et philosophie : donner du sens
Histoire, anthropologie : " mentalités " et " croyances ", un au-delà des pratiques
3. Le cadre conceptuel : penser le religieux et la modernité
Christianisation, sécularisation et préfixes associés
Intégral-Libéral-Intransigeant
4. L'histoire religieuse contemporaine au risque des synthèses et des monographies
L'histoire ecclésiastique
L'histoire du christianisme
Histoires religieuses de la France et de l'Europe
Partie II - Le religieux, un facteur explicatif de transformations politiques, sociales et culturelles
5. Le christianisme et les autres religions
Œcuménisme : catholiques, protestants, orthodoxes et " orientaux "
Missions chrétiennes
Interreligieux : chrétiens, juifs et musulmans
Marges religieuses et convictionnelles
6. À la confluence de l'histoire religieuse et de l'histoire politique
Révolution et Concordat
L'histoire de la laïcité, dérivée de l'histoire religieuse
Guerres contemporaines et religions
Mouvements et partis à référence religieuse
7. Les croyants par groupes
Les autorités religieuses
Militants et syndiqués : contestation sociale au nom de la référence religieuse
Les éducateurs et la jeunesse
Les femmes et le prisme du " genre "
8. Les périphéries de l'historiographie religieuse
Histoire de l'art religieux et de l'image religieuse
Histoire de la santé
Histoire des mœurs et de la sexualité
Histoire du droit et des droits religieux
Conclusion
Sigles.