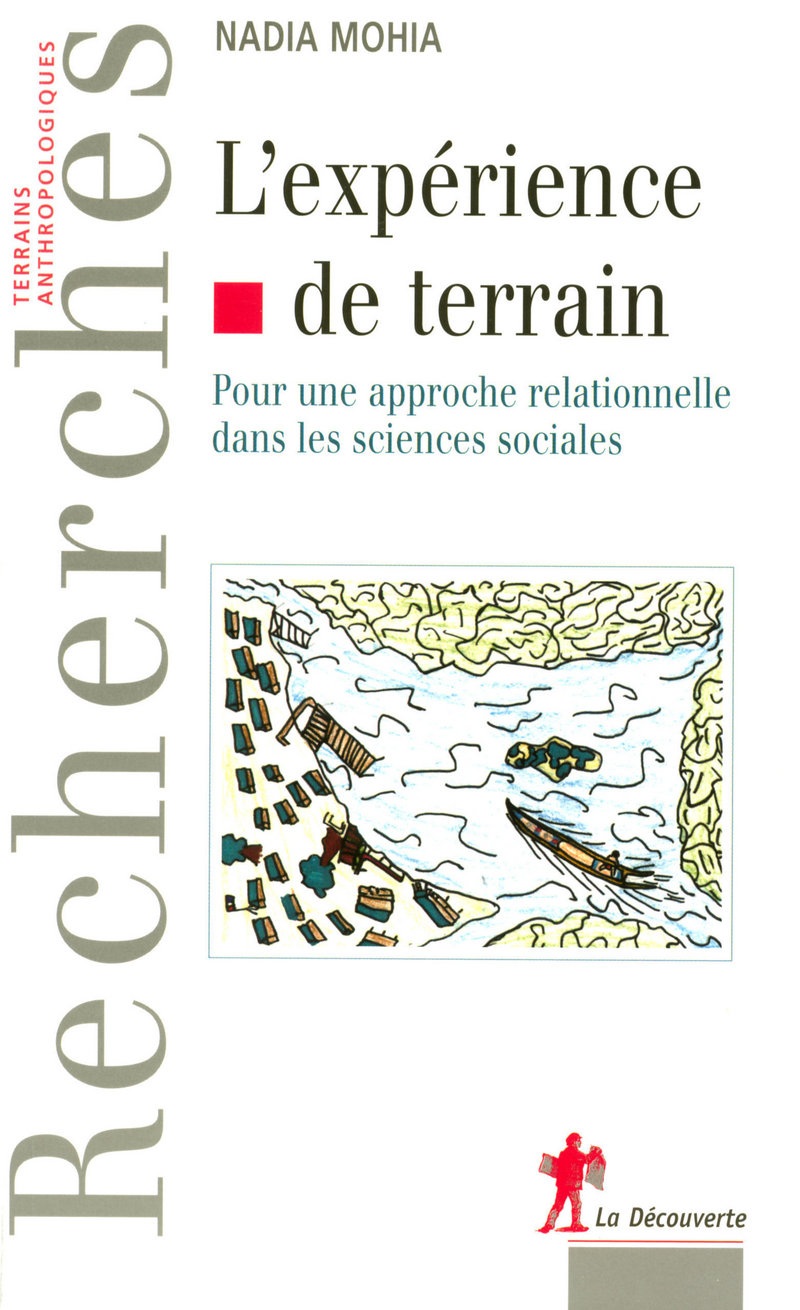L'expérience de terrain
Pour une approche relationnelle dans les sciences sociales
Nadia Mohia
Selon l'idée courante, l'ethno-anthropologie " moderne " se fonde sur l'expérience de terrain. En fait, c'est surtout l'enquête consacrée à la collecte des données ethnographiques qui occupe cette place déterminante, dans une démarche de connaissance dominée par le travail d'objectivation. Or, si l'on admet qu'il n'existe pas de réel humain en dehors de la relation à l'autre, alors il est temps de reconnaître l'expérience de terrain dans sa pleine réalité relationnelle et, ce faisant, de lui rendre sa juste place dans la démarche ethno-anthropologique.
Les expériences considérées dans ce livre ne sont ni abstraites ni anonymes : ce sont celles que rapportent Bronislaw Malinowski dans Journal d'ethnographe, Michel Leiris dans Afrique fantôme et Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques. Pour l'essentiel, et dans le style d'un essai plutôt que d'un ouvrage académique, ce livre montre ce que la pensée ethno-anthropologique tend à ignorer : la relation à l'autre, cela même qui constitue fondamentalement toute réalité sociale. Ainsi ce livre s'adresse-t-il aussi aux sociologues qui devront y trouver de quoi nourrir leurs réflexions méthodologiques et épistémologiques.

Nb de pages : 304
Dimensions : * cm
 Nadia Mohia
Nadia Mohia

Nadia Mohia, après une thèse de doctorat en psychanalyse et psychopathologie soutenue à l'université Paris-VII, s'est orientée vers l'ethno-anthropologie. Ses recherches, dont témoignent plusieurs publications, sont nourries à la fois par sa formation de clinicienne et ses diverses expériences sur le terrain : dans sa Kabylie natale, en Guyane française (avec les Indiens Emérillon et Wayãpi de Camopi) et au Canada, dans l'Ontario (avec les Ojibwa de la réserve de Saugeen).
Extraits presse 

2008-07-18 - Vincent Duclert - La Recherche Blog des livres
" Selon l'idée courante, l'ethno-anthropologie "moderne" se fonde sur l'expérience de terrain. En fait, c'est surtout l'enquête consacrée à la collecte des données ethnographiques qui occupe cette place déterminante, dans une démarche de connaissance dominée par le travail d'objectivation. Or, si l'on admet qu'il n'existe pas de réel humain en dehors de la relation à l'autre, alors il est temps de reconnaître l'expérience de terrain dans sa plaine réalité relationnelle et, ce faisant, de lui rendre sa juste place dans la démarche ethno-anthropologique. Les expériences considérées dans ce livre ne sont ni abstraites ni anonymes: ce sont celles que rapportent Bronislaw Malinowski dans Journal d'ethnographe, Michel Leiris dans Afrique fantôme et Claude Levy-Strauss dans Tristes tropiques. Pour l'essentiel, et dans le style d'un essai plutôt que d'un ouvrage académique, ce livre montre ce que la pensée ethno-anthropologique tend à ignorer: la relation à l'autre, cela même qui constitue fondamentalement toute réalité sociale. Ainsi ce livre s'adresse-t-il aussi aux sociologues qui devront y trouver de quoi nourrir leurs réflexions méthodologiques et épistémologiques. Un livre sensible et intéressant. "
MÉTISSE
2026-02-11 - PRESSE
Table des matières 

Introduction
Le silence de l'expérience méthodologique
De la pensée ethno-anthropologique au processus de la " civilisation occidentale "
Le " grand partage " anthropologique
L'expérience accessible
1. Bronislaw Malinowski. Journal d'ethnographe
L'évolution de l'expérience
L'ethnographe et le paysage
L'ethnographe et les indigènes
La lecture de romans
2. Michel Leiris. L'Afrique fantôme
Du " journal intime " à l'expérience
L'expérience éthiopienne
3. Claude Levi-Strauss. Tristes tropiques. L'invention de l'anthropologie
De l'expérience subjective à l'élaboration théorique
Les Structures élémentaires de la parenté (1967)
Le Totémisme aujourd'hui (1965)
La Pensée sauvage (1962)
Les Mythologiques (1964, 1966, 1968, 1971). Tristes tropiques ou la " dernière entreprise " d'Auguste
Conclusion
La fuite en avant
De l'impasse théorique à l'impasse sur le terrain
La " vocation ethnologique " : une question identitaire
Un obstacle épistémologique originel
Pour une expérience vraie
Bibliographie
Index des auteurs.