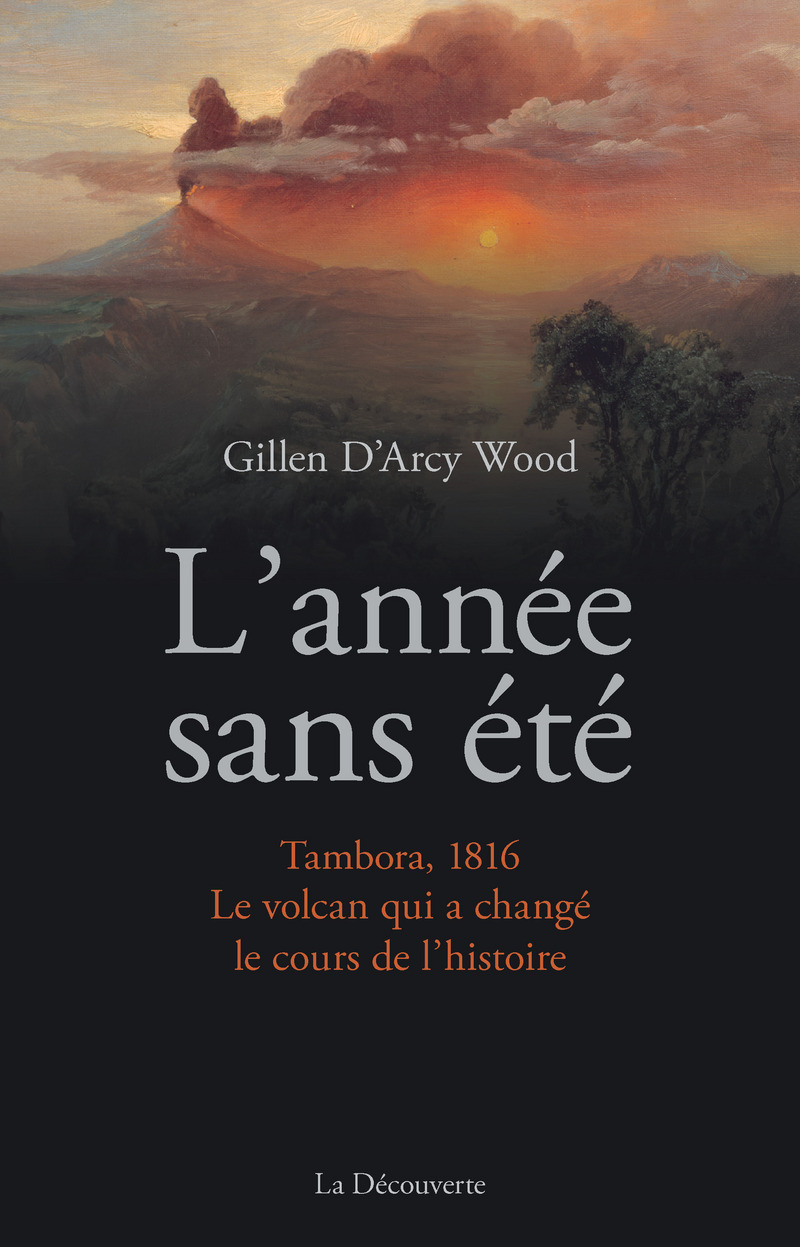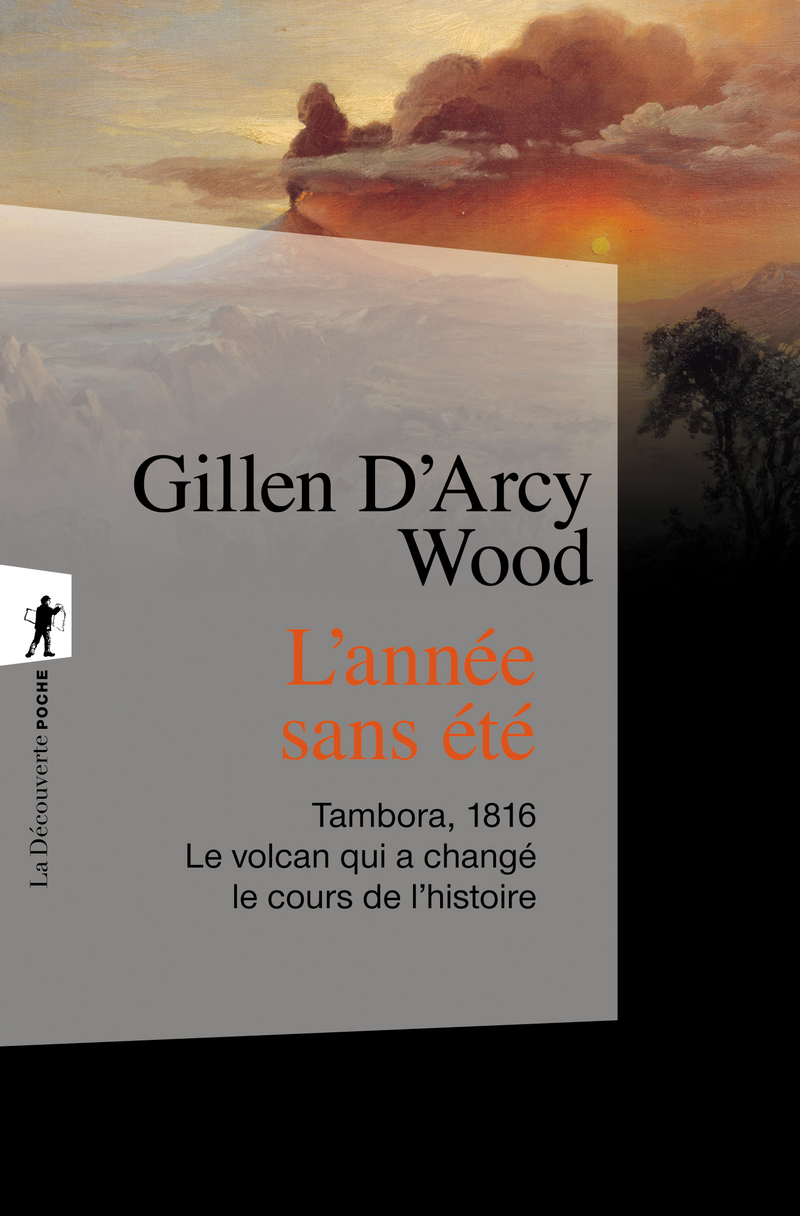L'année sans été
Tambora, 1816. Le volcan qui a changé le cours de l'histoire
Gillen D'Arcy Wood
Un an après Waterloo, en 1816, le monde est frappé par une catastrophe restée dans les mémoires comme l'" année sans été " ou l'" année du mendiant "... Une misère effroyable s'abat sur l'Europe. Des flots de paysans faméliques, en haillons, abandonnent leurs champs, où les pommes de terre pourrissent, où le blé ne pousse plus.
Que s'est-il passé ? En avril 1815, près de Java, l'éruption cataclysmique du volcan Tambora a projeté dans la stratosphère un voile de poussière qui va filtrer le rayonnement solaire plusieurs années durant. Ignoré des livres d'histoire, ce bouleversement climatique fait des millions de morts. On lui doit aussi de profondes mutations culturelles, dont témoignent les ciels peints par Turner, chargés de poussière volcanique, ou le Frankenstein de Mary Shelley.
L'auteur nous invite à un véritable tour du monde. Au Yunnan, les paysans meurent de faim, vendent leurs enfants et se lancent dans la culture du pavot à opium, moins sensible que le riz aux variations climatiques.
Dans le golfe du Bengale, l'absence de mousson entraîne une mutation redoutable du germe du choléra, dont l'épidémie gagne Moscou, Paris et la Nouvelle-Angleterre. L'Irlande connaît une effroyable famine, suivie d'une épidémie de typhus, qui laisse de marbre le gouvernement britannique. En Suisse, des glaciers avancent avant de fondre brutalement, détruisant des vallées entières. Aux États-Unis, des récoltes misérables provoquent la première grande crise économique, etc.
Ce livre, qui fait le tour d'un événement à l'échelle planétaire, sonne aussi comme un avertissement : ce changement climatique meurtrier n'a pourtant été que de 2 °C...

Nb de pages : 302
Dimensions : * cm
ISBN numérique : 9782348043246
 Gillen D'Arcy Wood
Gillen D'Arcy Wood

Extraits presse 

0016-11-18 - Dominique Borne - Sciences Humaines
Un spécialiste de l'art s'est penché sur l'éruption du volcan Tambora à Java en 1815 qui a eu des répercussions considérables et une influence invisible mais profonde sur l'état du monde. De mémoire agricole européenne, on l'a appelé "l'année sans été" ou encore "l'année du mendiant". Nous sommes en avril 1815, au lendemain des guerres napoléoniennes et le monde ignore qu'il va subir une véritable catastrophe climatique. Le volcan Tambora, près de Java, connait une violente éruption, et même exceptionnelle, aux conséquences incalculables : toute une série d'inondations, famines et épidémies fut provoquée par la cendre crachée haut dans la stratosphère. Cet épais nuage de 150 km3 fit plusieurs fois le tour de la Terre. L'année suivante, les moyennes de température en Europe dégringolèrent de 0,5° à plus de 1°C. Cette éruption historique, plus puissante que celle du Vésuve, a laissé des traces physiques, culturelles et psychologiques. La colère du Tambora ne s'est-elle pas manifestée à la suite du printemps 1815 qui a vu l'épisode des Cent-jours, Waterloo et la chute de Napoléon, le découpage de l'Europe lors du congrès de Vienne ?
2016-08-05 - Les Influences
L'épisode est connu ; son origine volcanique nettement moins. Là réside le travail remarquable de l'historien américain. Rapprocher les événements, établir les " téléconnexions ". Pour cela, il puise dans les sources scientifiques – les premiers relevés météorologiques, les observations des médecins, les carnets de voyageurs -, mais aussi les œuvres des poètes et des peintres (Caspar Friedrich, Constable, Turner...). Il plonge dans le passé lointain, l'éclaire à la lumière des dernières études, observation de volcans récents (Pinatubo, 1991) ou simulations des conséquences de l'éruption de 1815 – la plus importante du millénaire – sur la météorologie mondiale. (...) Ainsi, D'Arcy Wood déterre des épisodes enfouis. En Europe mais plus encore en Asie. Qui se souvient que c'est l'absence de mousson en 1816, puis les pluies diluviennes de 1817 qui ont provoqué la première grande épidémie de choléra en Inde ? L'historien convoque climatologues et biologistes pour pointer du doigt le Tambora. Même diagnostic pour la crise alimentaire qui décima le Yunnan entre 1815 et 1818 et convertit la province chinoise à la culture de l'opium. Jonglant entre les explications agronomiques et sur la culture du riz et les admirables poèmes de Li Yuyang, il offre là quelques pages magnifiques...auxquelles n'ont rien à envier les deux chapitres consacrés aux régimes glaciaires. L'un décrit l'improbable fonte de la banquise arctique – eh oui, il peut faire froid en Europe et chaud au Groenland – et la quête britannique du passage du Nord-Ouest. L'autre, l'apparition d'un barrage de glace dans le Valais puis la débâcle qui submergea la ville de Martigny, à l'origine de milliers de morts et de la théorie moderne de la formation des Alpes. De quoi lancer un sévère avertissement contre " l'hubris technologique " moderne. " Si, au début des années 1800, un changement climatique de trois ans a provoqué de telles destructions et redéfinit les affaires humaines (...), alors, il est impossible d'imaginer les conséquences futures d'un changement climatique de plusieurs décennies. " " L'histoire du Tambora, comme le Frankenstein de Mary Shelley, doivent être pris pour des mises en garde ", poursuit l'historien. Nul doute que le parallèle s'impose. Et dans les deux cas, on garantit les frissons.
2016-08-26 - Nathaniel Herzberg - Le Monde des Livres
Quel rapport entre grande famine en Irlande, l'explosion du marché de l'opium en Chine, la dépression du président Thomas Jefferson (et celle, économique, de son jeune pays), la diminution de la banquise en Arctique, la couleur des ciels dans les tableaux de Turner, la fluctuation des prix des céréales en Europe, l'épidémie de choléra au Bengale et l'élaboration de la première théorie moderne et libérale de l'État ? L'éruption du volcan Tambora le 11 avril 1816 ! Situé sur l'île de Sumbawa, à l'est de Java, dans les Indes néerlandaises, l'explosion de ce " Vésuve oriental " a eu, au-delà de ses victimes locales bien vite oubliées, des conséquences aussi insoupçonnées qu'effroyables sur le climat et, par là, sur l'économie régionale et mondiale mais aussi sur la marche politique du monde. Telle est la thèse – séduisante, argumentée, singulière – de l'historien Gillen D'Arcy Wood dans un essai stimulant de 300 pages dont les développements scientifiques parfois savants n'entravent jamais le plaisir d'une lecture agrémentée par l'irruption de figures artistiques et littéraires comme Constable ou Keats. Car leurs œuvres aussi, souligne D'Arcy Wood, furent " inspirées " par cette catastrophe méconnue. Ainsi, de Frankenstein : " La célèbre créature de Mary Shelley porter la marque des populations européennes affamées et malades au milieu desquelles elle vivant pendant ce terrible été du Tambora ". Qui s'en serait douté ?
2016-08-26 - Jean-Christophe Buisson - Le Figaro Magazine
Raconter cette histoire, c'est également montrer la folie de la géo-ingénierie, cette nouvelle discipline scientifique qui propose de résoudre la crise climatique par la technologie, par exemple en projetant de gigantesques volumes d'aérosols de sulfate dans la stratosphère pour refroidir artificiellement la Terre : avec Tambora, on voit combien, dans un processus climatique, les réactions en chaîne sont immaîtrisables. À travers ce cataclysme vieux de deux cents ans, D'Arcy Wood nous met en garde à propos d'une autre catastrophe, celle à laquelle nous nous exposons en n'endiguant pas le réchauffement climatique. Cette fois, la cause ne pourra être attribuée à l'éruption d'un volcan indonésien – dont les projections disparurent en trois ans – mais bien à l'inconscience humaine.
2016-09-15 - Xavier de La Porte - L'Obs
Les désordres climatiques hantent les hommes depuis longtemps sans qu'ils sachent toujours les comprendre. Ce n'est que très récemment qu'on a ainsi pris conscience des ravages planétaires causés par ce qui fut sans doute la plus grande éruption volcanique des derniers millénaires. Sans un témoignage écrit recueilli par les Britanniques, cet événement majeur tombé dans l'oubli aurait pu être oublié à jamais englouti. C'est l'histoire de ce phénomène mondial que retrace avec brio un professeur à l'université de l'Illinois, faisant appel aussi bien aux écrits littéraires qu'aux études climatologiques les plus pointues. (...) On a fait le lien entre l'éruption cataclysmique de Santorin dans la mer Égée, en 1628 av. JC, la chute de la civilisation minoenne, la légende de l'Atlantide et l'exode des Hébreux hors d'une Égypte frappée par la peste selon le récit biblique. Ce livre d'histoire globale décrit en décryptant avec rigueur un phénomène du même type. Alors que les enjeux climatiques nous interrogent, il nous saisit avec une acuité particulière.
2016-09-22 - Jean-Marc Bastière - Le Figaro littéraire
Quel est le fait historique le plus important du XIXe siècle? Waterloo, l'unité allemande et italienne, la guerre de Sécession? Tout se discute bien sûr, l'histoire n'est pas une science objective. Mais à la lecture de "L'Année sans été de Gillen d'Arcy Wood", il se pourrait bien que le phénomène le plus marquant du siècle soit... l'éruption du Tambora en 1815, un volcan de l'île de Sumbawa en Indonésie.
Ses conséquences ont été si catastrophiques pour le climat de la planète que pendant trois ans des millions de paysans se sont retrouvés en situation de famine, du Yunnan chinois à l'Irlande en passant par la Suisse. Ce volcan, dont l'explosion classée au rang de "méga colossale" selon l'indice d'explosivité volcanique, est sans équivalent dans les annales de l'humanité, surpassé seulement par l'éruption Oruanui (Lac Taupo) en Nouvelle-Zélande il y a 26 500 ans.
L'histoire de cette éruption, dont il reste aujourd'hui un cratère de 6 kilomètres de diamètre qui gronde et sent encore le souffre, est bien connue des volcanologues et des historiens. L'intérêt du livre de D'Arcy Wood, au titre français trop réducteur, est de restituer cette tragédie dans sa dimension planétaire. Car le Tambora ne se limite pas à être la cause de "l'année sans été" de 1816, mais il a durablement marqué les sociétés humaines et contribué à leur transformation. Ce géant indonésien a même influencé les arts, la littérature et les idées scientifiques tout au long du XIXe siècle.
(...) Pour D'Arcy Wood, qui est professeur de littérature, la créature de Frankenstein n'est pas seulement l'envers damné de l'Homme Nouveau des Lumières et de la Révolution, elle est aussi à l'image de ce nouveau pauvre des années 1816, jeté sur les routes, mendiant en guenilles, ayant tout perdu, maison, femme et enfants. Ou de ces petits Suisses des Alpes "à moitié difformes" du fait de la malnutrition, ou encore ces "spectres animés" rencontrés plus tard dans la botte de l'Italie qui ont encore la force de dire dans un souffle: "Nous mourons." En clair, conclut D'Arcy Wood, "les campagnes européennes de 1816 sont devenues une terre de morts-vivants", et les élites, à l'image de Victor Frankenstein, ont démontré à leur égard bien peu de compassion.
De ce tableau sombre émergent aussi quelques idées neuves, notamment en matière de politique sociale, de santé, et du rôle de l'Etat en cas d'urgence. En Suisse, le compte rendu de ces années de disette par l'historien Marc Henrioud montre que les autorités vaudoises étaient parvenues à limiter les dégâts en interdisant les exportations, en pratiquant une politique d'achat de céréales et en faisant pression sur le prix du pain. Protectionnisme ou libre-échange, secours d'urgence, réfugiés climatiques: les questions du monde moderne, jusqu'aux plus récentes, sont nées de la cendre volcanique.
2016-10-07 - Emmanuel Gehrig - Le Temps
Table des matières 

Introduction. Une météo à la Frankenstein
1. La Pompéi de l'Est
Des pluies de cendres
Le royaume d'or de Tambora
Le roi philosophe de Java
2. Le petit âge glaciaire (volcanique)
Les amoureux du volcan
Les années 1810 : les plus froides des années froides
Prendre la mesure du Tambora
3. " Un climat de fin du monde "
Les monstres de Genève
Le premier météorologue
La dernière famine d'Europe
Frankenstein et les réfugiés
" La lumière du soleil était éteinte "
La prophétie de Bologne
4. Mort bleue au Bengale
Les flèches mortelles d'Apollon
L'année sans mousson
Mort sur les
ghats
Choléra et changement climatique
Le choléra se mondialise
Le dernier homme
5. Les sept douleurs du Yunnan
Le Sud du nuage
Des années sans été
La poésie de la famine
La connexion de l'opium
6. Le jardin polaire
Réchauffement global, façon XIXe siècle
Bernard O'Reilly : l'homme oublié
La sonde du capitaine Scoresby
L'homme qui mangea ses bottes
7. Tsunami de glace dans les Alpes
" La race humaine, elle, fuit au loin, apeurée "
Apocalypse dans le val de Bagnes
Une catastrophe, mais pas de catastrophisme
8. L'autre famine irlandaise
" Une saison effroyable et déprimante "
" La terrible réalité de 1817 "
Un pou, deux poux
" La particularité aimable du caractère irlandais "
9. Heures sombres à Monticello
L'" année-1800-où-il-a-gelé-à-en-mourir "
Un Nouveau Monde froid...
Le Tambora et la panique de 1819
Le retour du pessimisme climatique
Épilogue. Et in extremis ego
Remerciements
Bibliographie générale
Bibliographie par chapitres.