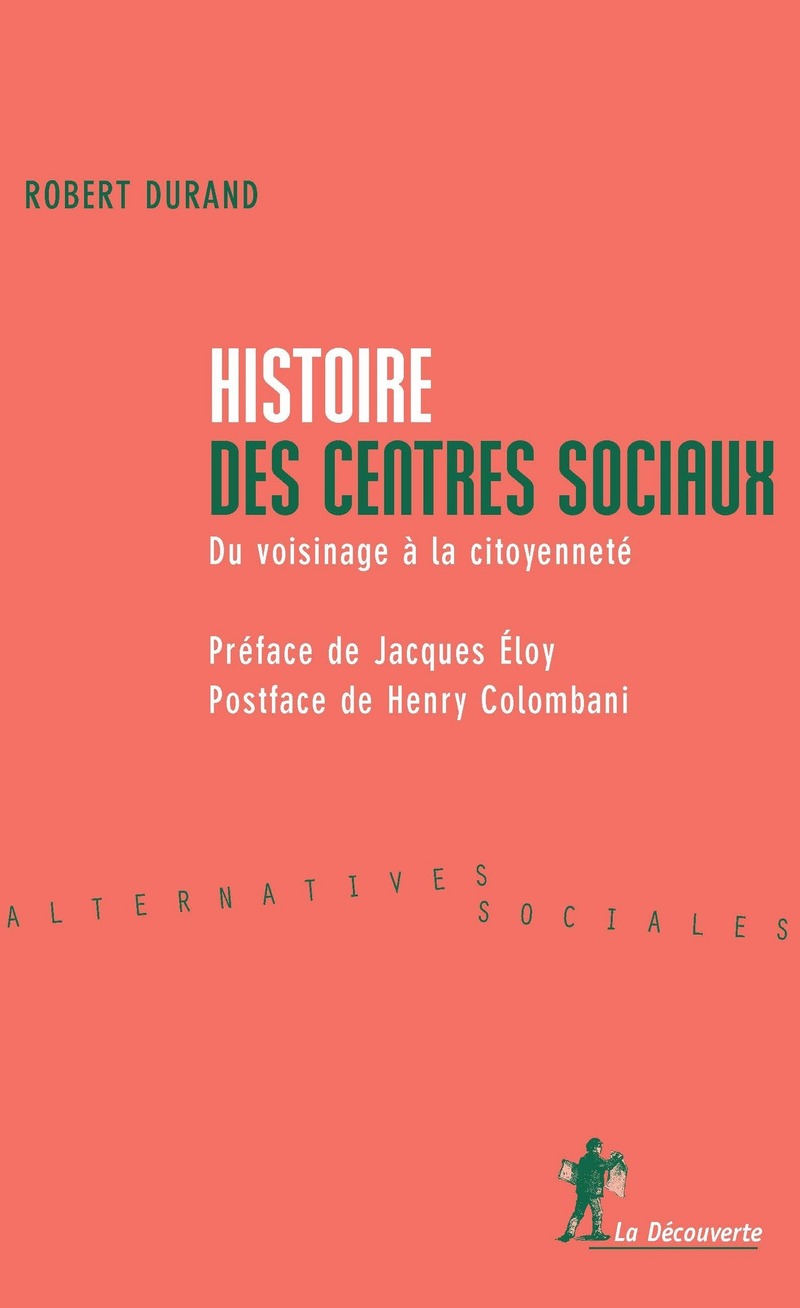Histoire des centres sociaux
Du voisinage à la citoyenneté
Robert Durand
Il existe actuellement en France plus de 2 000 centres sociaux, implantés en majorité dans les communes de banlieue, les grands ensembles et les quartiers périphériques des villes. Ouverts à tous, les centres sociaux demeurent pourtant une réalité encore peu ou mal connue. Afin de combler cette lacune, cet ouvrage propose de rappeler la longue tradition historique dans laquelle ils s'inscrivent sur le plan national.
Il a fallu près d'un siècle pour façonner le centre social tel qu'il existe aujourd'hui et pour qu'il devienne un véritable dispositif d'action, d'animation et d'intervention dans la vie locale. Plus qu'un simple établissement, c'est un équipement polyvalent pour les habitants, leur offrant la possibilité de pratiquer un sport, de s'initier à l'informatique, de cuisiner, de consulter les services sociaux, etc.
Cet ouvrage permet de découvrir comment les centres sociaux ont pu répondre aux problèmes caractéristiques de chaque époque, grâce à l'investissement des acteurs impliqués dans cette aventure : engagement des intervenants bien sûr, mais aussi des habitants des quartiers. Contrairement aux politiques sociales qui proposent généralement un traitement individuel et sectoriel des problèmes, le centre social développe quant à lui une approche collective et globale : c'est pour cette raison qu'il constitue une forme totalement originale de lutte contre l'exclusion. Cette nouvelle édition propose une préface inédite de Jacques Éloy, sociologue universitaire et vice-président de la Fédération des centres sociaux de France (FCSF), et une postface actualisée par Henry Colombani, délégué général adjoint de la FCSF, retraçant les principales évolutions depuis une dizaine d'années et abordant la question du devenir de ces structures. Il s'agit là d'un ouvrage de référence, visant à répondre aux attentes des responsables et professionnels du milieu, mais également de tous ceux qui s'intéressent au travail social, à l'éducation populaire et au développement local.

Nb de pages : 264
Dimensions : * cm
 Robert Durand
Robert Durand

Robert Durand a été conseiller technique à la direction de l'action sociale de la Caisse nationale d'allocations familiales. Il a été également délégué membre du secrétariat national de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Aujourd'hui retraité, il participe à la recherche sur l'histoire sociale.
Extraits presse 

" Ouvrage de référence, ce livre répond aux attentes des professionnels du milieu, mais également à ceux qui s'intéressent au travail social, à l'éducation populaire et au développement local. "
VEI ACTUALITÉ
" Ouverts à tous, les centres sociaux demeurent pourtant une réalité encore peu ou mal connue. Afin de combler cette lacune, cet ouvrage propose de rappeler la longue tradition historique dans laquelle ils s'inscrivent sur le plan national. "
ESPACE SOCIAL EUROPÉEN
" Cet ouvrage de référence découvre néanmoins un pan meconnu de l'histoire du "social". "
XXème SIÈCLE
" C'est un ouvrage précieux car l'auteur, historien, apporte des analyses et de nombreuses informations sur l'évolution des centres sociaux, leur fédération, les congrès qui ont marqué leur histoire, la naissance de la formation à l'animation socio-culturelle. Un ouvrage qui nous rappelle que les premiers centres sociaux étaient souvent dirigés par des assistants de service social. "
LE SOCIOGRAPHE
2025-12-30 - PRESSE
Table des matières 

Préface à la nouvelle édition, par Jacques Éloy
Introduction
1. Le social
L'origine
Le paupérisme
La question sociale
L'émergence
Le social
Clivage entre le social et l'assistance
Un nouveau champ
L'évolution
Une double dérive
La nouvelle assistance
Le travail social
L'aboutissement
Un champ transformé et confirmé
Le social et l'éducation populaire
Un champ autonome mais hétéroclite
Social : un terme ambigu
2. L'invention du centre social
Résoudre la question sociale
Les options fondamentales du centre social
Présence active des habitants
Le voisinage
Le quotidien
Approche et démarche globales
Une spécificité française : la place faite à la famille dans le projet
Le professionnalisme
Au-delà de la question sociale
L'extension au monde rural
Le fédéralisme
La visée ultime
3. Le temps des pionniers (1897-1945)
Le printemps des centres sociaux
Un projet dans l'air du temps ?
L'accueil du projet
Le monde du social
Les pouvoirs publics
L'opinion publique
L'accueil du monde ouvrier
Que conclure ?
Points de repères (1884-1945)
4. Le temps des réalisations (1946-1983)
La reconnaissance officielle
CAF et MSA : les nouveaux promoteurs de centres sociaux
Les années 50 : redécouverte du centre social
Il ne suffit pas de s'équiper
Le groupe de travail de 1969
Un financement spécifique du centre social
Les prestations de service
La fonction coordiantion et animation globale
L'agrément
L'engagement des habitants
Monde ouvrier et nouvelles classes moyennes
Les militants
Des adhérents et un environnement consonant
Les habitants s'approprient le centre social
Une vie fédérale conforme au projet
La structuration du réseau fédéral
L'organisation des instances statutaires des fédération
Les professionnels
De la résidente à l'animateur
Salariés et partenaires
Incertitudes
Point de repères (1946-1983)
5. Le temps des turbulences ( 1984...)
Le social en question
Changement des dynamiques sociales
Mutations du militantisme
Repli domestique ou éparpillement
Relever le défi
La décentralisation
Les lois de décentralisation
La procédure d'agrément décentralisée
La fin de l'aide de l'État
Renforcer le réseau fédéral
Une nouvelle procédure d'agrément : le contrat de projet
La circulaire CNAF du 31 décembre 1984
Le congrès de Bordeaux : 23, 24, 25 novembre 1984
La circulaire CNAF du 31 octobre 1995
Vivre ensemble la citoyenneté
Le congrès de La Rochelle : 10, 11, 12 avril 1992
Retour sur le passé
Vers une nouvelle approche de la citoyenneté
Le centre social, espace de citoyenneté
Points de repères (1984-1996)
Conclusion : à suivre
Postface, par Henry Colombani
Bibliographie.