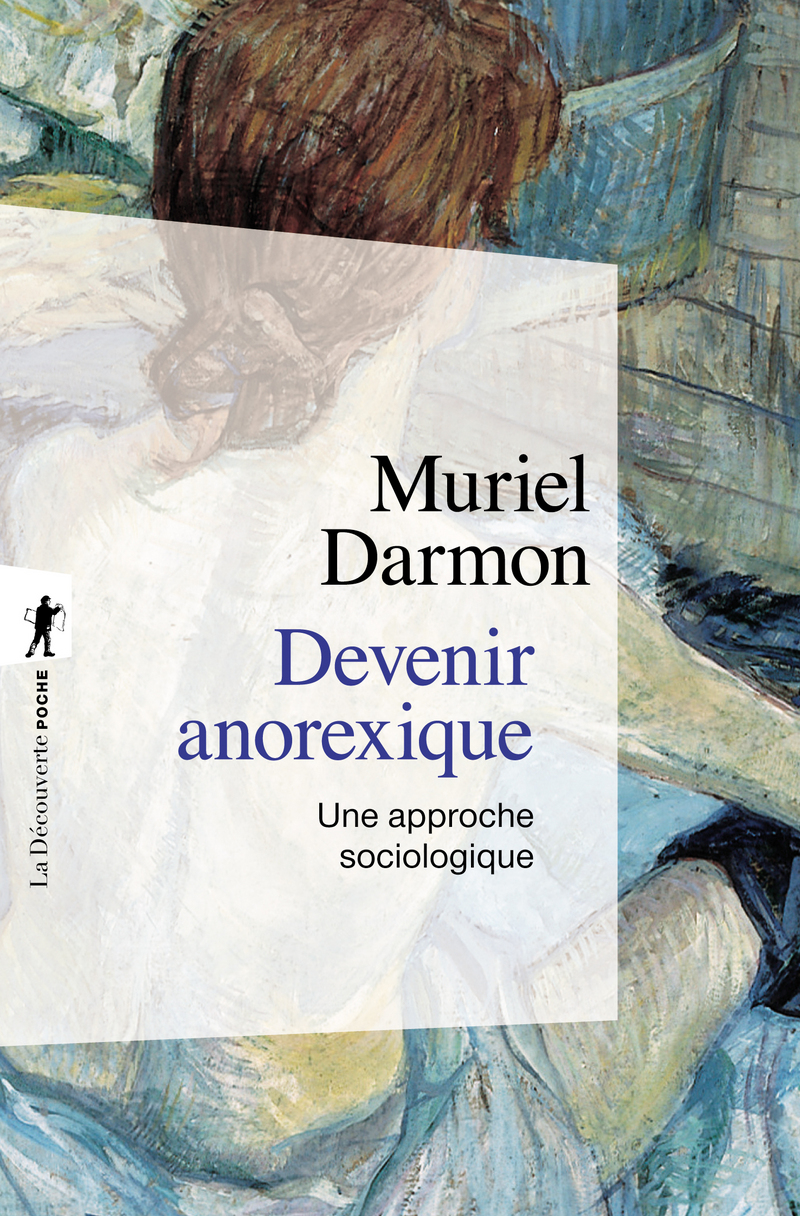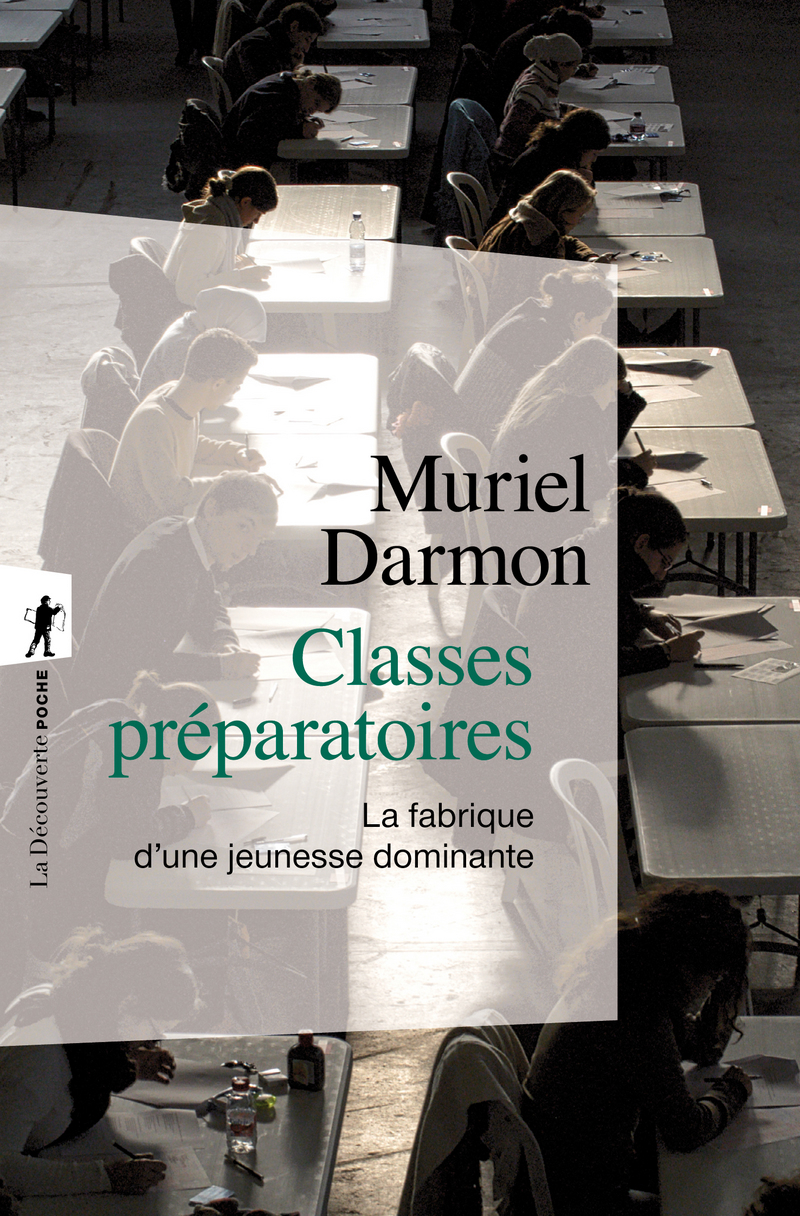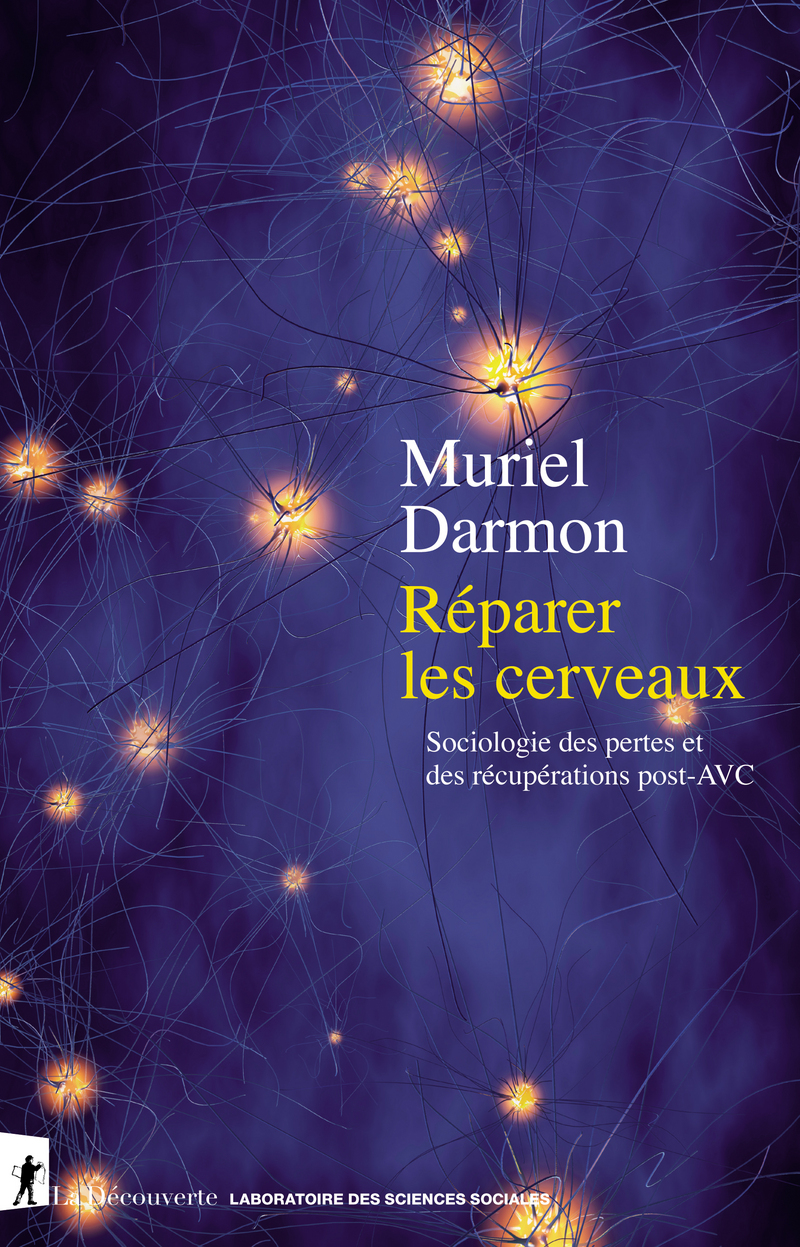Devenir anorexique
Une approche sociologique
Muriel Darmon
Comment devient-on anorexique ? La sociologie a-t-elle quelque chose à dire à ce sujet ? On invoque fréquemment la " dictature de la minceur ", les représentations médiatiques du corps féminin, les transformations des comportements alimentaires, pour expliquer la multiplication des cas d'anorexie chez les adolescentes. Plus généralement, l'anorexie est très souvent étudiée à travers les discours médicaux, psychanalytiques ou journalistiques qui détiennent sur ce sujet une sorte de " monopole de la parole légitime ".
Muriel Darmon a choisi, au contraire, de se tenir au plus près de l'expérience des personnes concernées par la maladie, de leurs propriétés sociales et culturelles, et s'efforce de reconstituer précisément les conduites et les processus qui font que des adolescentes en viennent à être diagnostiquées comme anorexiques. À partir d'entretiens avec des jeunes filles anorexiques hospitalisées ou non, avec leurs enseignants et avec des adolescentes du même âge, elle montre que l'anorexie peut être décrite comme un véritable " travail ", une entreprise de transformation de soi qui requiert des dispositions spécifiques et qui s'organise en différentes phases composant une " carrière " anorexique, depuis l'engagement dans un régime jusqu'aux effets de l'hospitalisation et à la sortie de la maladie.

Nb de pages : 354
Dimensions : 12.5 * 19 cm
ISBN numérique : 9782707170392
 Muriel Darmon
Muriel Darmon


Muriel Darmon, ancienne élève de l'École normale supérieure (Ulm), est sociologue et directrice de recherche au CNRS dans le Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS-EHESS-Paris I). Elle est également l'auteure de Devenir anorexique (La Découverte, 2003, 2008).
Extraits presse 

" Ouvrage remarquable. Enquête aussi solide qu'élégante. "
LE MONDE DES LIVRES
" Un travail surprenant, et disons-le d'emblée, d'une grande rigueur méthodologique et analytique. Un ouvrage passionnant et inédit, au moins dans son approche. Certes, Devenir anorexique relate une recherche complexe, mais le style employé permet une lecture instructive à quiconque s'intéresse à l'anorexie, même s'il n'est pas sociologue. L'écueil de la simple description épidémiologique est évité, pour donner un ouvrage majeur traitant d'un sujet aigu. Un tour de force, on vous dit ! "
PARUTIONS.COM
" Attentive aux exceptions au modèle qu'elle a construit, récusant une corrélation mécanique entre anorexie et position sociale, M. Darmon montre brillamment comment la sociologie peut apporter un regard original sur le "pathologique". Elle ouvre de manière convaincante un nouveau chantier pour la discipline, celui des pratiques de transformations de soi (dont l'anorexie est un cas extrême). "
SCIENCES HUMAINES
" Exploration prenante. "
LE VIF/L'EXPRESS
" Quand Muriel Darmon décide de consacrer sa thèse de sociologie à l'anorexie et qu'elle commence son enquête, elle se heurte parfois à un accueil assez froid: "Vous n'êtes pas une clinicienne, lui signifie une chef de service. La sociologie, ce n'est pas de la clinique. Je ne veux pas de voyeurs dans mon service, pour le dire crûment. La sociologie, c'est l'étude du fait social, la sociologie doit rester à sa place.". Une réticence qui paraît bien injustifiée à la lecture du livre que la sociologue a ensuite fait paraître, une fois sa thèse soutenue. Loin d'empiéter sur les plates-bandes de la psychiatrie ou de la psychologie, Muriel Darmon montre par quelles étapes les adolescentes deviennent anorexiques et de quelle manière leurs habitudes sont le reflet de certains milieux sociaux. Autrement dit, elle ne se penche pas sur les causes de cette pathologie: à la place du "pourquoi", la sociologue s'attache à la question du "comment". "
L'ÉCOLE DES PARENTS
" L'auteur, docteur en sociologie, a tenté, au fil de ses rencontres avec de jeunes anorexiques et leur entourage familial et éducatif, d'appréhender cette pathologie sous l'angle "pratique", décrivant les étapes qui jalonnent une "carrière" d'anorexique. Une approche nouvelle de la maladie que l'auteur décrit avant tout comme une entreprise de transformation de soi qui tourne au tragique. "
LE FIGARO
2026-02-20 - PRESSE
Table des matières 

Remerciements
Introduction
Comment peut-on faire une sociologie de l'anorexie ?
Quelle approche sociologique ?
À quoi peut servir cette sociologie de l'anorexie ?
I. Partir d'un diagnostic
1. Un détour par le XIXe siècle : enjeux historiques
Maladie et diagnostic : les " saintes anorexiques "
L'inscription du diagnostic dans les taxinomies médicales
Sous le regard de la médecine et de la famille
La redistribution des cartes du maigre
2. Une entrée par l'hôpital : enjeux méthodologiques
Construire les corpus d'entretiens
Le diagnostic à l'hôpital H
Le diagnostic à la clinique C
Travailler les situations d'enquête et d'entretien
Des quasi-professionnelles du discours sur soi
Le travail de définition d'une situation d'entretien différente
Repérer le modelage des discours
Les reprises explicites
Des modelages distincts
Des modelages pluriels
Ouvrir une brèche pour la sociologie
Le poids du social
Les modalités d'intégration du social
L'assignation à résidence
II. La carrière anorexique
3. " Transformer les individus en activités "
L'anorexie comme activité
Une " carrière " anorexique
Trois pistes dialectiques
Carrière et trajectoire
Une carrière " déviante "
" Mise entre parenthèses " et " mise en objet " du pathologique
Réintroduire des principes de variations
Une carrière déviante spécifique
4. " Commencer " : s'engager dans une prise en main
Le commencement en questions
Les modalités du récit du commencement
Le commencement : une question de définition
Le commencement : un régime ?
Trois manières de " commencer "
" Commencer " par un régime
Ne pas " commencer " tout de suite par un régime
Ne pas " commencer " seulement par un régime
Se " prendre en main "
Une rupture mise en pratiques
Entrées et sorties de la prise en main
5. " Continuer " (I) : maintenir l'engagement
Le travail sur les techniques
La rationalisation des techniques
Se forger des habitudes
Des tests techniques
Le travail de mesure
La rationalisation de la mesure
L' usage des techniques de mesure
Le goût pour les effets
Le goût pour les sensations physiques
Le goût pour la maigreur
Travail sur le temps et travail du temps
Un régime de vie : le travail sur le temps
Une incorporation de dispositions : le travail du temps
Les sorties de carrière
6. " Continuer " (II) : maintenir l'engagement malgré les alertes et la surveillance
Le circuit des agents et des étiquettes
Les alertes
Le circuit des professionnels
La constitution d'un réseau de surveillance
Les exigences d'arrêt
La surveillance médicale et profane
Pouvoir maintenir l'engagement
Les réactions à la surveillance : de la discrétion au leurre
Les conséquences de l'étiquetage
7. " Être prise en charge " : s'en remettre à l'institution
La " remise en questions " et en réponses de l'identité
La constitution hospitalière d'un groupe déviant
De " lâcher prise " à " se reprendre en main " : le travail sur les dispositions
" Lâcher prise " : arrêter le maintien de l'engagement
Accepter d'être " prise en charge " : la remise de soi
" Se reprendre en main " : le retournement des catégories
III. L'espace social de la carrière anorexique
8. L'espace social de la transformation de soi
Le travail anorexique : des pratiques situées dans l'espace social
Se faire un corps
Se faire une culture
Quelques hypothèses sur le corps et la culture
La tension anorexique : un ethos socialement situé
L'ascétisme
Un ethos du contrôle sur le destin corporel et social
L'importance et la maîtrise des assignations
L'élitisme anorexique : vers l'exceptionnalité sociale
Les " gros " et les " grosses " comme repoussoir social
Le corps comme capital distinctif total
9. L'espace social hospitalier
L'inscription sociale du diagnostic
La " résistance " : une posture située
Camille : la résistance en actes et en discours
Les stratégies de la résistance
Les conditions sociales de possibilité de la résistance
Conclusion.