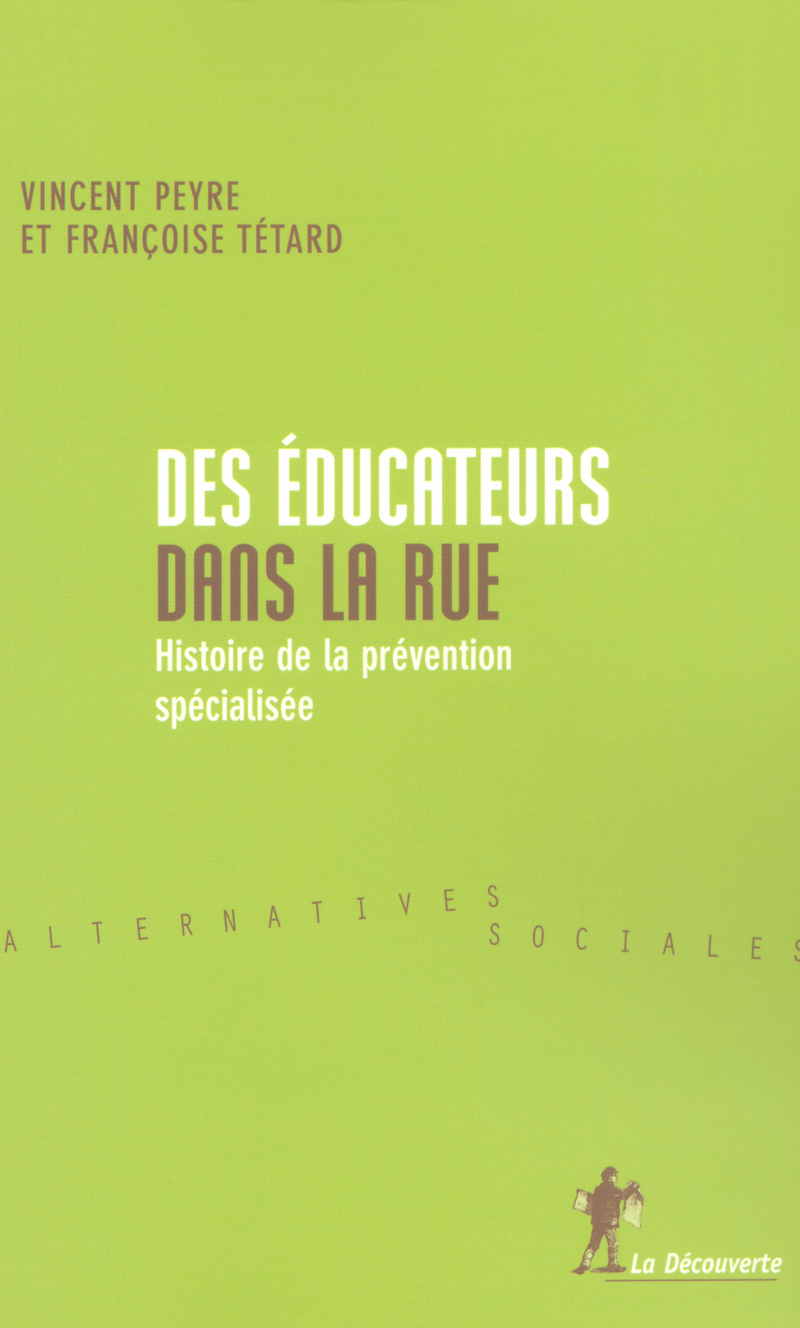Des éducateurs dans la rue
Histoire de la prévention spécialisée
Françoise Tétard, Vincent Peyre
La prévention spécialisée est née au tournant de la Seconde Guerre mondiale, mais la philosophie à laquelle elle se réfère remonte au XIXe siècle. Elle a d'abord été un mouvement en réaction aux modes traditionnels d'intervention auprès des jeunes délinquants et en danger, puis a été progressivement incluse dans la politique de prévention générale conduite par les pouvoirs publics, sans renoncer pour autant à la militance de ses débuts et sans cesser de se percevoir comme autonome. L'histoire de la prévention spécialisée est riche, plurielle, mouvementée. Peu d'ouvrages s'y étaient intéressés jusqu'à présent. Françoise Tétard et Vincent Peyre viennent combler ce manque, en offrant une analyse historique qui fait écho aux préoccupations actuelles de ce secteur professionnel. En effet, l'histoire de la prévention spécialisée est aussi celle d'une société qui ne cesse d'invoquer de manière lancinante sa jeunesse : une jeunesse que tour à tour on veut protéger ou dont on veut se protéger. Les politiques, les médias, parfois même les professionnels, semblent ainsi reproduire en spirale les mêmes discours sur la violence toujours plus grande, toujours plus précoce de ces jeunes délinquants, toujours plus nombreux, qui envahiraient les rues de nos cités. Qu'ils soient dénommés apaches, jeunes voyous, blousons noirs, sauvageons ou encore, plus récemment, racaille...

Nb de pages : 272
Dimensions : * cm
 Françoise Tétard
Françoise Tétard

Françoise Tétard est historienne, ingénieure au CNRS (Centre d'Histoire sociale du XXe siècle).
 Vincent Peyre
Vincent Peyre

Vincent Peyre est sociologue, ancien directeur de recherches au CNRS.
Extraits presse 

" Dans ce passionnant récit, l'historienne et le sociologue retracent le cheminement des fortes personnalités qui ont inventé le métier. "
ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES
" Il était temps qu'un livre fasse l'histoire de cette profession, développée surtout après la Seconde Guerre. Des monographies passionnantes nous entraînent (jusqu'à l'intime: que de mariages !) sous les arcanes d'une histoire généreuse, par des protagonistes qui ont connu l'époque des militants (souvent issus du scoutisme, de Vie Nouvelle), des administrateurs d'associations et de fédérations spécialisées, puis des gens de "métier" avec centre de formation et de recherche (CNRS). "
ESPRIT
" Françoise Tétard et Vincent Peyre nous présentent une vision kaléidoscopique de la prévention spécialisée. Ils choisissent avec bonheur de ne pas se lancer dans la recherche improbable des origines à travers les discours et les usages linguistiques, mais plutôt de suivre à la trace les expériences menées sur le terrain. "
REVUE FRANÇAISE DE PÉDAGOGIE
" Écrit dans un style à la fois simple, direct et agréable, l'ouvrage de Vincent Peyre et de Françoise Tétard permet de mieux comprendre les modes d'institutionnalisation du travail social à travers l'analyse de la structuration de l'un de ses secteurs. Les auteurs dépeignent avec rigueur et sobriété le contexte politique, institutionnel, législatif et intellectuel dans lequel s'institutionnalise le secteur de la prévention spécialisée, en mettant bien en évidence les principales difficultés liées à sa structuration collective. De même, on voit bien apparaître les luttes pour le maintien et le développement du secteur de la prévention, qui souffre, aujourd'hui comme par le passé, de son manque de visibilité et apparaît assez peu autonome et très dépendant des décisions politiques en matière sociale. "
REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE
" Alors que se succèdent depuis plus de vingt ans des séries de dispositifs en faveur des jeunes des quartiers dits "difficiles", la prévention spécialisée, qui constitue pourtant une approche souple et originale, reste méconnue. "Segment mineure des politiques sociales", pour cause de rétivité perdurante à se plier aux injonctions, voire aux tentatives d'instrumentalisation des pouvoirs en place, elle restait aussi méconnue des historiens du travail social. C'est d'ailleurs ni pour les uns ni pour les autres que ses auteurs avouent, en toute fin d'ouvrage, avoir écrit cette histoire, mais "d'abord pour les nouvelles générations d'educ de prév'". Ce public-cible explique sans doute les partis pris d'écriture moins conceptuelle que narrative, moins replacée dans l'histoire du travail social qu'analysée avant tout pour elle-même dans ses individus, ses associations, ses modes d'organisation et ses rapports aux pouvoirs publics. "
LE MOUVEMENT SOCIAL
2026-02-13 - PRESSE
Table des matières 

Préambule
I. L'invention et ses inventeurs (1943-1950)
L'expérience de Lille : une opportunité pédagogique
La Boutique des cheftaines, à Paris, rue de Navarre
La création des Équipes d'amitié par un délégué bénévole à la Liberté surveillée
De Montreuil à Montesson : l'esprit de fronde
Le modèle s'expatrie et se réinvente à Nancy
Haro sur l'internat
À l'origine, quelques hommes et quelques femmes
II. L'enracinement (1950-1957)
Essaimage, la deuxième vague
Le premier salarié des clubs
Retrouvailles à Jambville
Le club des Réglisses recrute
La pédagogie de la Baraque
Les clefs de l'" accrochage "
Salariés et bénévoles d'une même cause
La conscience du " quartier "
Le cercle des pionniers s'élargit
III. L'incitation (1957-1962)
À la recherche d'une " autorité "
La profession de foi des " clubs et équipes de prévention " (21 janvier 1957)
La Sauvegarde donne l'hospitalité, provisoirement
De la quête à la conquête des financements
L'urgence des blousons-noirs
Le loisir comme argument
L'esprit de plate-forme
Tentatives d'école de prévention
IV. Une institutionnalisation progressive
L'installation du comité Pichat (1962-1963)
La recherche de Vaucresson (1959-1964)
De nouvelles associations frappent à la porte
Le rapatriement au ministère de la Santé et l'arrêté de 1972
Les " affaires " de Besançon, Caen et Nantes ou la prévention aux prises avec les tribunaux
Le moment " gauchiste "
À partir de 1971, le Comité national de liaison (CNL)
V. Changement dans la fidélité
La prévention spécialisée, oubliée des dispositifs (1983)
Les actions de préventions : outils ou prétexte ?
La " doxa ", ou comment la prévention spécialisée se définit
Commande publique territoriale et injonction sécuritaire
Mais en fait, prévenir quoi ?
Conclusion
Annexes
Quelques données quantitatives
Associations inscrites sur la liste des clubs et équipes de prévention (1967)
Textes législatifis et réglementaires
Sigles et abréviations
Bibliographie.