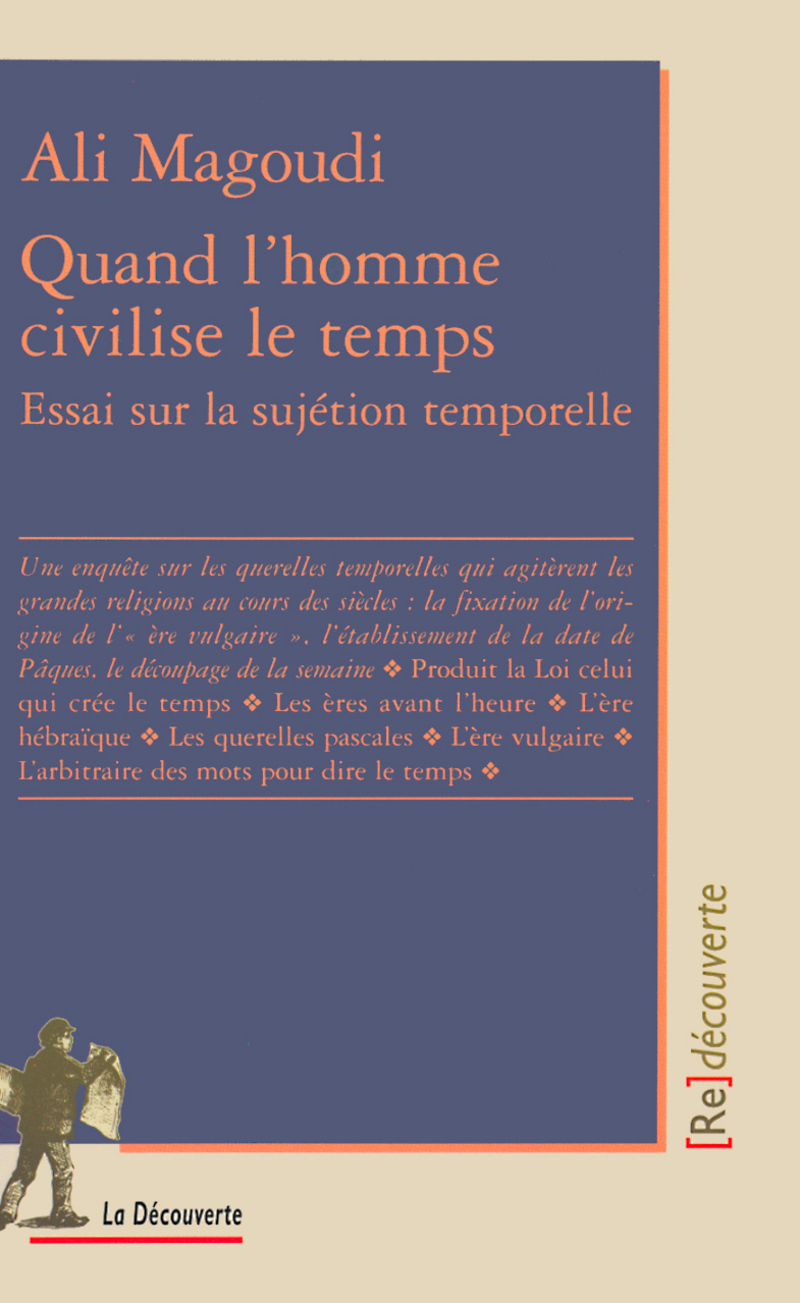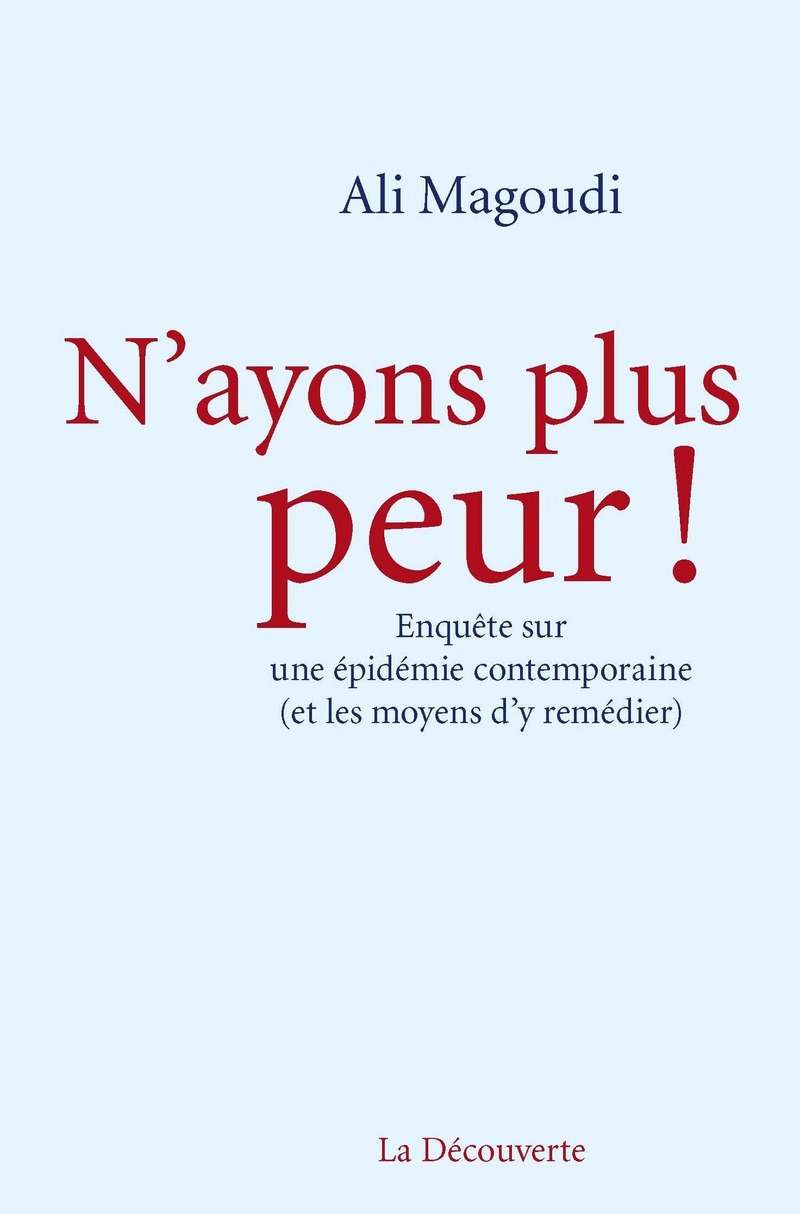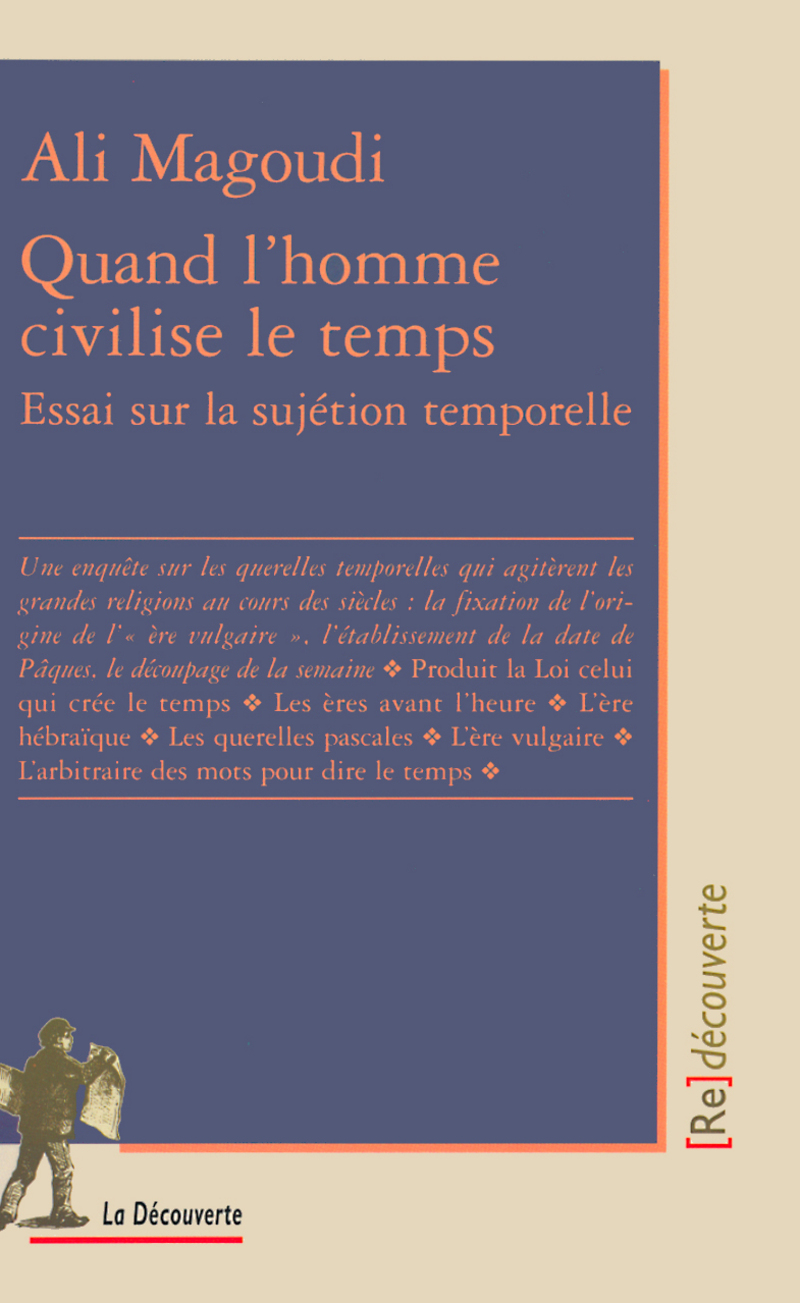Quand l'homme civilise le temps
Essai sur la sujétion temporelle
Ali Magoudi
En apparence, rien n'est plus " naturel " que les systèmes de mesure du temps : le décompte des jours à partir de l'an 1 de l'ère chrétienne, l'année de 365 jours en douze mois, la semaine de sept jours... Et pourtant... Pourquoi le calendrier révolutionnaire de 1793 ne parvint-il pas à s'imposer ? Pourquoi les bolcheviks russes échouèrent-ils à instaurer la semaine de cinq jours ? En tentant de répondre à ces questions, l'auteur propose une enquête passionnante sur les querelles temporelles qui agitèrent les grandes religions au cours des siècles : la fixation de l'origine de l'" ère vulgaire ", l'établissement de la date de Pâques, le découpage de la semaine. Pour Ali Magoudi, s'il n'existe pas d'ordonnancement laïc du temps, si tous les systèmes de " comput temporel " se rattachent in fine à la religion, c'est parce que les mots pour " dire le temps " constituent une institution politique fondamentale intimement liée aux dogmes symboliques.

 Ali Magoudi
Ali Magoudi


Ali Magoudi, psychanalyste, est l'auteur de nombreux ouvrages, dont un roman autobiographique (Un sujet français, Albin Michel, 2011), qui a figuré sur la liste du prix Goncourt et a reçu le prix Ève Delacroix de l'Académie française.
Table des matières 

Introduction : le temps de l'Autre
Le temps, concept politique qui s'ignore
Le temps, l'Autre et la causalité temporelle
L'Autre, la division du sujet et la temporalité
De l'exogamie familiale à l'endogamie de " clan "
1. Produit la loi celui qui crée le temps
La nomenclature calendaire d'après régicide
Le culte décadaire
La fête finale
Fonder le temps aux origines : l'indispensable constitution de l'Autre
Le pouvoir de diviser en cause ?
2. Les Ères avant l'heure, Mythologie et temps
Mythologie et temps des olympiades
Célébrants et célébrés s'opposent structurellement face à la loi temporelle
L'homogénéité mythologique du temps des olympiades
Le temps de l'Autre romain
De l'indiction à la mémoire dogmatique
Le temps révolutionnaire à l'aune du temps mythologique
3. L'Ère hébraïque répond au défi du temps des origines
Aux origines du pouvoir ; fonder et diviser
Actualité du pouvoir politique de diviser
4. Les querelles pascales, prototype de la sujétion temporelle
La première des grandes controverses de l'Église primitive : la querelle des quartodécimans
Les bases théologiques de la discorde temporelle
Petit historique de la querelle des quartodécimans
Caractéristiques du calendrier hébraïque du point de vue pascal
Complications apparues avec l'émergence d'un comput exclusivement chrétien
Mouvements d'inscription, d'effacement et d'autorité mis en œuvre sous couvert de disputes arithmétiques
Grégoire XIII et la seconde grande vague de dissension autour du comput pascal
Les limites géographico-rituelles de la réforme grégorienne
Les trois temps nécessaires à l'installation d'un nouveau comput
Les querelles pascales comme prototype dogmatique de l'assujettissement temporel
5. L' Ère vulgaire incarne le temps éponyme
L'histoire se fait mythologie quand son discours devient objet de vérité
Effets des cycles pascals sur l'invention de la chaîne symbolique christologique originaire
Exemple premier : l'audace prématurée de Victorius d'Aquitaine
Échantillon second : la très sainte mais néanmoins macabre table de Cyrille
Modèle troisième : l'inaugurale Argumenta Pascalia de Denys le Petit
L'âge de l'ère vulgaire
Pourquoi avoir circonscrit le trou noir de l'origine du Christ dans la mémoire du temps ?
6. L'arbitraire des mots pour dire le temps : un exemple, la semaine
La semaine juive
La semaine hellénistique
La diffusion chrétienne de la semaine judéo-hellénistique
Conclusion : qui fait la loi ?
L'hypothèse temporelle
La théorie freudienne et le temps
Laïcité et mythe fondateur
Définition de la laïcité
Les limites de la laïcité
Bibliographie.